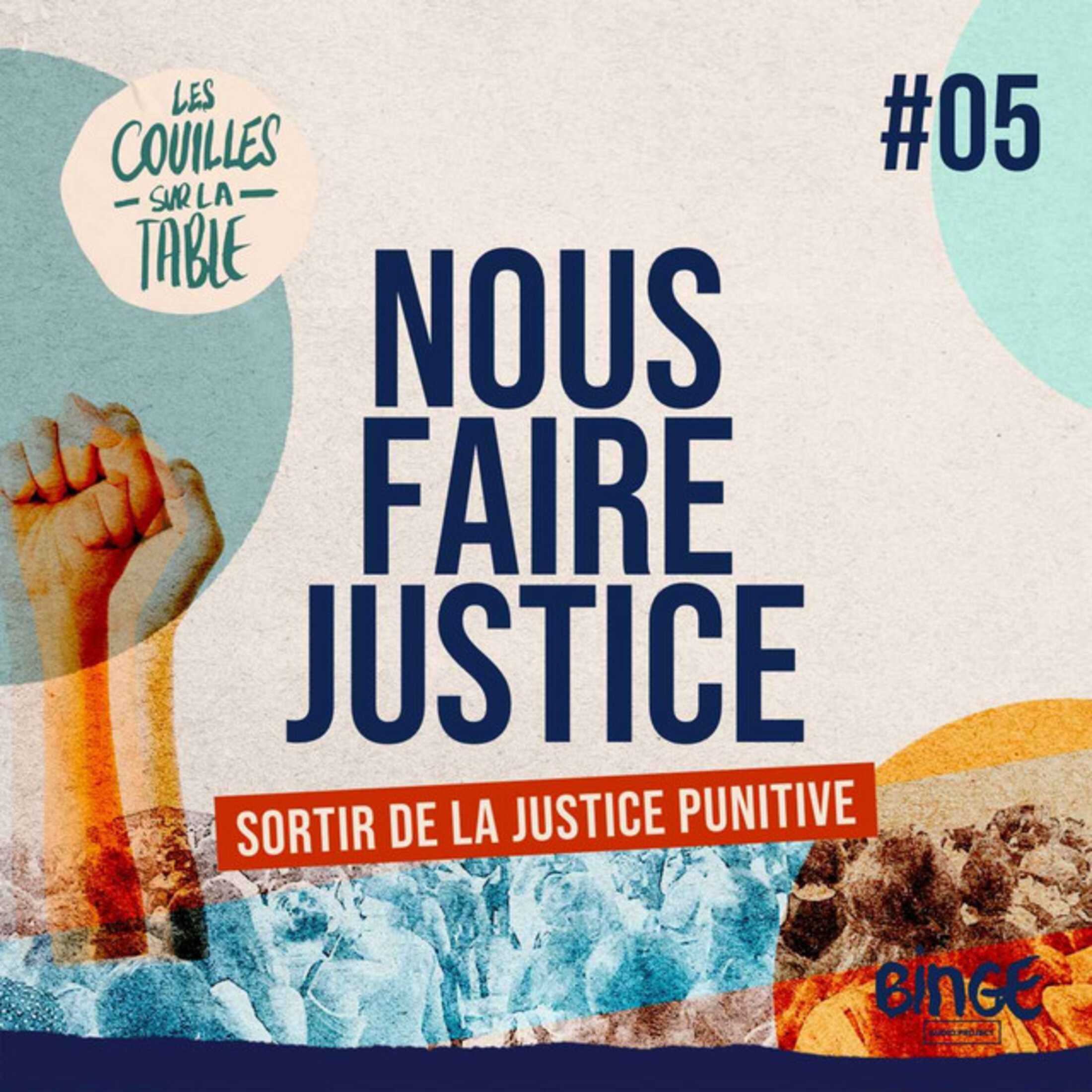Réflexion sur le mur dans lequel nous fonçons.
Compte-rendu de l’ouvrage d’Elsa Deck Marsault : « Faire justice », éditions la Fabrique
1. Au tribunal de la morale féministe
L’autrice nous invite dès le premier chapitre à reconnaître et à identifier la violence « dans nos milieux ». Ces milieux, ce sont les espaces queers, féministes et militants. Ces milieux, ce sont ceux où l’on se retrouve pour lutter et pour se sentir avec des « pairs ». Ces milieux, qu’on nous promet « safe » et « déconstruit » sont eux aussi traversés par la violence de ses membres – la nôtre. Nous protégeons un trésor, celui de nos retrouvailles et de nos discriminations communes. Nous sommes ici pour bien des raisons, et souvent avec nos failles à vifs. Mais un groupe suggère des places, des rôles et des règles. Pour protéger notre trésor, nos règles sont à la hauteur de ce précieux : urgentes et vives. Nous protégeons les murailles, dressées bien hautes pour conserver notre paix. Nos soldats de l’extérieur traquent les intrus, les ennemis. Traquons-nous toujours à l’extérieur de nos murailles ? Ne sommes-nous pas tous et toutes traqué-es aussi de l’intérieur… de peur qu’un cheval de Troie n’ait passé le portail ? Chacun-e, vestale (gardienne/esclave ? des temples et du feu sacré en Grèce antique) de notre projet, de notre morale et de notre communauté. Nous sommes tout à la fois : gardien-ne et suspect-e. Nous nous enchaînons, par urgence de vivre, à notre trésor et nous en devenons esclave. Cette question d’emprise à sa propre communauté est décrite dans les chapitres qui suivent.
Nous tou-tes, donc, agissons avec nos règles et nos « nouveaux » codes tel un « tribunal populaire ». Mais dans ce « nous » sommes-nous tou-tes à la même place ? Un petit groupe semble se former pour induire et guider ce procès militant. Avons-nous bien regardé les intentions de nos magistrat-es ? Pourquoi luttons-nous à ce point pour la pureté de notre trésor ? Pourquoi n’acceptons-nous qu’aucun vent ne l’effleure ? Qu’avons-nous à y perdre ou à y gagner ? Et ces ennemis contre lesquels nous nous battions… n’avons-nous pas pris leur costume et leurs armes ? au nom d’une cause « plus juste » dirons-nous… ?
Identifier l’ennemi, lutter contre et trouver les mesures à mettre en place… C’est ce qu’Elsa Deck Marsault décrit comme « la justice punitive » : exercer une sanction sur l’auteur/trice d’une infraction. L’autrice propose l’idée selon laquelle, tout comme l’ensemble de la société, les milieux féministes et queers agissent selon cette justice punitive. Trésor, murailles, gardien-nes, ennemis/danger … Nous exigeons une certaine langue (inclusive, un vocabulaire choisi, …), nous bannissons des membres lorsqu’ils ont eu des comportements jugés « problématiques », nous identifions les « toxiques », nous dénonçons les personnes accusées sous le terme « agresseurs », nous recadrons… nous encadrons.
Critiquer une communauté et un mouvement auquel on appartient, et d’autant plus sur des sujets qui font l’objet de beaucoup de critiques extérieures, est une prise de risque. L’autrice les note : réappropriation des critiques pour contrer le féminisme, rejet du mouvement, … mais elle choisit aussi de ne pas se taire malgré cette difficulté. Marcher à contre-courant de sa propre communauté, n’est souvent acclamé qu’une fois toutes les tempêtes passées. Entre temps, c’est être seule. Mais il faut « nous donner une chance de faire mieux » (p.17).
2. Être ou ne pas être « déconstruit », est-ce vraiment la question ?
A propos de cette « langue militante », combien de fois ai-je entendu des gens dire qu’iels n’osaient pas prendre la parole de peur de « faire un pet de travers ». Cette idée selon laquelle l’espace est tout à fait bienveillant ne transparaît visiblement pas de la même façon pour tout le monde. Wendy Brown, nous dit l’autrice, décrit le moralisme progressiste comme une militance fondée sur des interdits individuels : la langue militante, l’utilisation de TW, être ou ne pas être safe, … Ce qui est critiqué ici c’est l’individualisation des rapports de pouvoir. C’est-à-dire qu’estimer que le comportement d’une personne doit être d’une certaine (bonne) façon afin de casser un rapport de force dans le lien aux autres. C’est lutter contre l’invisibilisation de certains groupes de personnes, en exigeant une hygiène langagière spécifique, corriger une personne en demandant une appellation dite inclusive : « toutes les personnes ayant un utérus peuvent accéder à l’IVG » au lieu de « toutes les femmes peuvent accéder à l’IVG », « touste » vs « tous », …
Wendy Brown dénonce cette utilisation perçue comme progressiste, d’une gauche déconstruite et militante, comme une recherche d’une morale exhaustive. Elle parle donc de « moralisme progressiste » : il faut dire… et ne pas dire…, sinon tu es « non déconstruit », « dominant », … Elsa Deck Marsault évoque une « personnalisation de l’ennemi ». En gardant cet axe d’analyse selon lequel nous serions ancré dans un système punitif (une victime et un agresseur à condamner), nous cherchons un ennemi palpable dans nos comportements (physiques, langagiers, vestimentaires, …) : qui dit transsexuel et non personne trans, qui porte un polo bleu marine et un pull noué sur les épaules, qui mégenre les personnes, qui dit les femmes sans préciser si elles sont cis ou trans, qui dit lgbt et non lgbtqia+, … ? Nous traquons les failles chez chacun-e à l’intérieur ou l’extérieur de la communauté, nous traquons les marques de cet « ennemi » à combattre chez chaque personne. Cette traque chez l’individu tend à invisibiliser les mécanismes généraux qui créent les rapports de pouvoir. En cherchant chez chacun-e, nous oublions de chercher plus loin, plus haut. Mais cet ennemi abstrait est difficile à critiquer, puisque justement… à qui s’adresser ? où et sur qui passer notre besoin de militance, notre colère ? Alors, il est tellement plus facile de faire « à sa porte », autour de soi, plutôt que d’avoir l’impression de se battre contre des moulins à vents … Mais finalement nous luttons contre nous-même et nos coéquipier-ères (actuel et à venir… peut-être si chacun-e se sent accueilli-es avec « bienveillance »). Quelle bienveillance ? De quelle bienveillance sommes-nous capables ? Quelle est notre flexibilité et notre capacité d’inclusion et d’ouverture ?
« La résistance à l’oppression est en quelque sorte réduite à la transformation de soi et à la réflexivité » (p27)
3. Ensemble dans un bateau qui coule (ou pas)
On l’a dit la justice punitive dans les milieux queers et féministes est utilisée pour « protéger » le mouvement tant de ses membres que de l’extérieur. Chacun-e est jaugé-e à l’aune de ses capacités à manier les codes du groupe. Une longue critique est faite sur la pratique des « call out » (dénonciation publique) comme étant l’illustration parfaite de cette logique de condamnation et d’individualisation de l’objet de lutte. « Call out » qui tente de répondre aux manques de moyens et à la temporalité de la justice d’Etat.
Elsa Deck Marsault nous invite à remettre en question le groupe où a eu lieu la dissonance/le conflit. Elle propose une responsabilisation partagée du conflit plutôt qu’un procès pour trouver une « juste » condamnation/punition. Cette remise en question a pour but de comprendre les règles du groupe qui ont rendu possible ce conflit. Qu’est-ce qui rend possible les violences sexistes dans notre société ? plutôt que… Qui produit les violences sexistes dans notre société ? Ce retournement de projecteur sur une même situation (les violences sexistes) permet ce qu’on nomme une justice transformatrice. L’objectif n’est pas d’exclure l’auteur de ces violences, et de l’identifier comme coupable. Cette désignation d’un coupable individuel répond à un ensemble d’émotions dont celle de la colère. Mais la réponse à la colère issue d’une injustice, peut se faire autrement que par une logique violence-punition. Proposer une réponse transformatrice, plutôt que punitive, à la production de ces violences permet de mettre en lumière les failles du groupe. Mais cette réflexivité doit être collective et il ne s’agit pas d’estimer que c’est aux « victimes » de trouver ces moyens de transformation. Les victimes de ces violences doivent être reçues par le groupe et accompagner dans leurs réparations. Mais si la seule réponse aux « auteurs » est celle d’une condamnation, d’une exclusion, d’une incarcération pénitentiaire ou autre… Le groupe n’a pas fait son travail, le groupe a trouvé un coupable idéal pour ne pas assumer ses failles. Ce coupable idéal devient alors le chaudron parfait dans lequel nous pouvons déverser l’ensemble de nos souffrances. Nous devons travailler à la reconnaissance des émotions liées aux violences pour ne pas se laisser dicter par celles-ci.
4. L’égalité n’est-elle pas indécente ?
Nous évoquions quelques lignes plus haut les raisons (1.) pour lesquelles nous faisons, et nous avons besoin, de faire communauté. Chacun-e doit pouvoir trouver un groupe de pair-es où le confort et la confiance sont réciproques. Ce groupe devient alors un refuge privilégié pour l’individu. Parfois même il est le premier lieu (voire l’unique) de socialité. Nous y plaçons une adhésion et une confiance aveugle – par nécessité affective. Cette adhésion intime au groupe masque notre esprit critique par un agrégat émotionnel liant appartenance, sécurité, reconnaissance, solidarité, … Et c’est au nom de notre adhésion que nous défendons notre communauté, quel qu’en soit les moyens. Nous la défendons pour conserver notre sécurité affective. A court termes il semble plus efficace de la défendre par l’exclusion des ennemis. Nous créons une « non-mixite safe ». Néanmoins ce court terme répond à l’urgence émotionnelle et ne répond pas aux besoins sociétaux. Nous souhaitons une société meilleure mais nous dressons des remparts entre « les déconstruits » et les autres. Nous marchons avec nos entre-soi pour faire face à nos insécurités affectives. Ce paradoxe semble irrésolvable puisque nous y sommes, dans cette justice punitive, par insécurité affective… mais pour sortir durablement de ce trouble socioaffectif, nous devons agir par la transformation et non par la punition/exclusion.
Nous devrions accepter de nous asseoir à la table de nos bourreaux. Nous devrions considérer notre espace de sécurité comme étant lui aussi auteur de violences. Nous devrions briser notre confort pour penser une transformation sociale, sans hiérarchie de lutte, sans hiérarchisation des victimes identifiées, … Nous devrions, malgré tout ce flot émotionnel d’urgence, faire preuve de sang froid et de pragmatisme pour accompagner l’ensemble des acteur/trices d’un conflit vers le changement. Le projet me paraît presque indécent et pourtant…
Autrice : Romane Faure-Mary
@romane.faure-mary.autrice
23/11/2023, Lyon
"FAIRE JUSTICE, moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes." Elsa Deck Marsault, ed. La Fabrique

Agrandissement : Illustration 1

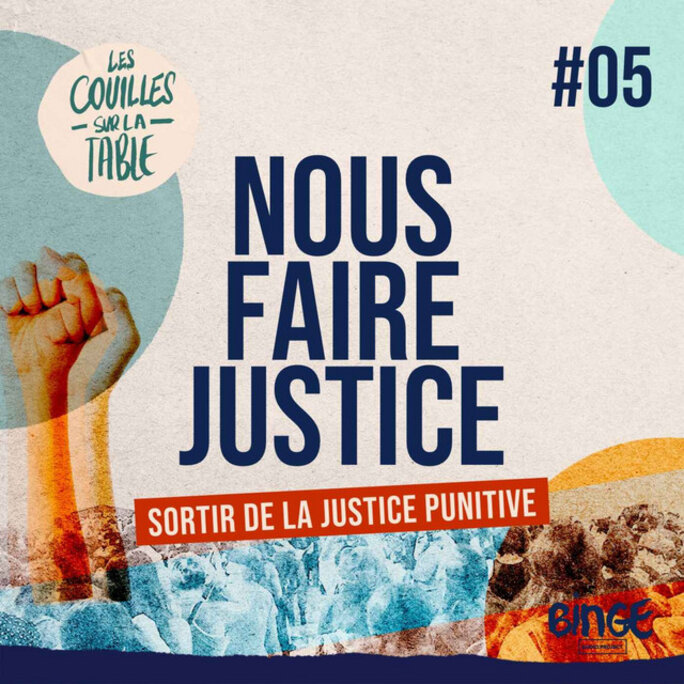
Agrandissement : Illustration 2