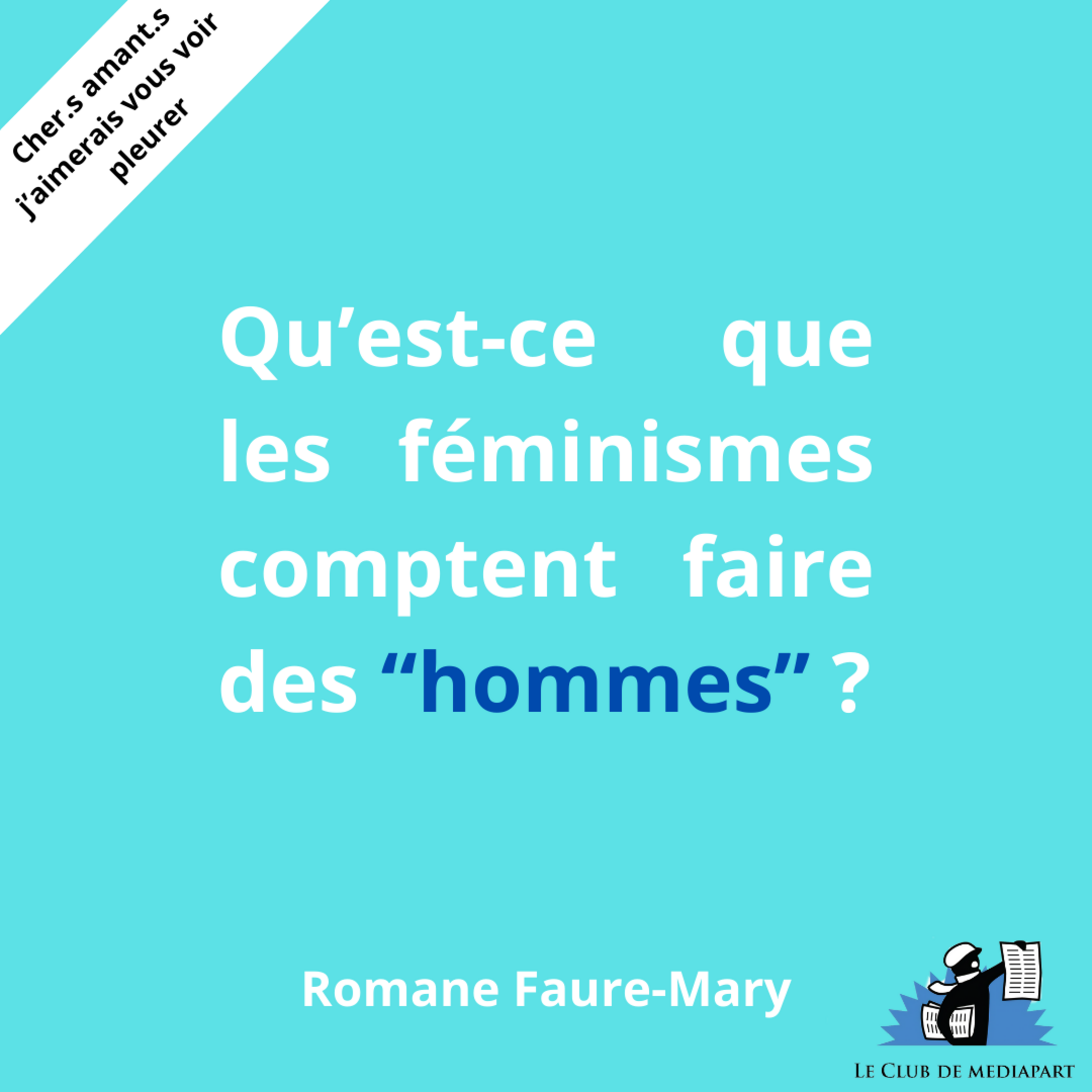« De nos jours, je m’étonne que les femmes engagées politiquement dans le féminisme aient si peu à dire sur les hommes et la masculinité. Les premiers écrits du féminisme radical ont permis à la colère, la rage et même la haine envers les hommes de s’exprimer, mais aucune solution conséquente n’y était proposée pour dissiper ces sentiments, pour imaginer une culture de la réconciliation, où les femmes et les hommes pourraient se rencontrer afin de trouver un territoire d’ententes déchaîner leur rage et leur haine envers les hommes, il ne nous a pas permis de donner du sens au fait d’aimer les hommes au sein d’une culture patriarcale, ni de savoir comment nous pourrions exprimer cet amour sans craindre l’exploitation et l’oppression. »
( bell hooks "la volonté de changer, les hommes, les féminismes et l'amour")
Bell hooks dans son livre « la volonté de changer » formule une question que je comprends de cette façon : qu’est-ce que le féminisme compte faire « des hommes » ? Et il me semble que c’est une question qui dérange à tout les étages. Qu’elle met au jour une complexité vertigineuse et que nos luttes sociales ont du mal à les absorber.
Le sort des « hommes » dans la lutte féministe me semble à quadruple tranchants ! C’est une dénonciation très forte des milieux masculinistes et des incells. Le féminisme est perçu comme une chasse « à l’homme », une mise à l’écart de tout un groupe, avec parfois la perception que cet autre groupe « les femmes » souhaite renverser le pouvoir, pour s’en accaparer.
Les incells vivent comme un traumatisme le rejet dont ils seraient l’objet. Les femmes les rejetteraient par principe, et ce serait l’avancée du féminisme qui amènerait cet isolement masculin, cette perte de repère sans solutions pour eux. La gymnastique de pensée pourrait-elle aller jusqu’à imaginer que le « manque de réponse » concrète à la réponse du sort des hommes, créerait le masculinisme, par extension ? Que des cendres de nos luttes et de nos avancées, c’est la haine de l’autre qui s’est embrasée.
Si c’était effectivement le cas, faudrait-il pour autant condamner la lutte d’origine (contre la domination masculine) au nom de ses possibles conséquences ? Comment pouvons-nous les prévenir ces conséquences (gender gap, sentiment de rejet de la part des hommes, masculinismes et anti-feminismes) ?
Comment peut-on expliquer que les adolescent-es d’aujourd’hui avancent dans une plus grande polarité qu’auparavant ? Les adolescentes défendent davantage les enjeux intersectionnels et féministes tandis que les adolescents véhiculent de plus en plus des discours traditionalistes. Qu’est-ce que nous n’avons pas vu venir ?
Les influenceurs masculinistes sont très présent auprès des adolescents et jeunes adultes. Leur discours est aguicheur et attise l’attention par la réponse simple à des questions omniprésentes. Depuis de nombreuses années, désormais, nous tapons dans Google les questions qui nous hantent. Quelles entrées sortent à des questions telles que : comment séduire ? c’est quoi le sexe ? Mais le féminisme aussi répond à ces questions.
Pourquoi alors n’arrivons-nous pas à atteindre les garçons et les hommes ? Est-ce que la communication est ciblée pour une seule catégorie de personne (les personnes sexisées : femmes, minorités de genre) ? Doit-on développer une stratégie de communication ciblée pour la catégorie dominante (les hommes et les garçons cisgenres) pour éviter que cela reste l’apanage des groupes sexistes ?
Mais pour mettre en place une communication ciblée, il faut percevoir et comprendre ce groupe cible. Il faut pouvoir le décrire et l’analyser finement, identifier le maximum de comportements et en faire une sociologie précise. Cette mise en place est un travail conséquent, et il a un coût. Le coût de la recherche et de l’énergie déployée. Ce coût est-il au détriment de la compréhension d’un groupe opprimé ? Faudrait-il une répartition budgétaire pour permettre ce travail sur les masculinités ?
Il me semble que le problème est ici. Etudier les masculinités, chacun s’y accorde plus ou moins, mais revoir les priorités et redistribuer les moyens de la recherche pour privilégier une étude « sur les hommes » ? Je crois que c’est ici que la lutte féministe coince. Il semble, pour beaucoup, inadmissible de repenser cette répartition budgétaire. Il n’y a déjà pas suffisamment de moyens pour prendre soin des victimes de ce sexisme, il semble immoral d’en retirer davantage pour s’inquiéter de ceux que l’on perçoit comme les acteurs de ce sexisme (les hommes).
Difficile, en ces termes, de défendre une autre alternative, sous peine de frôler avec un discours antiféministe. L’impasse semble insurmontable.
L’intensité et l’urgence de notre colère (celle des personnes qui ont conscience du sexisme qu’iels subissent) est légitime. Cette légitimité est de trop nombreuses fois remise en cause, politiquement, médiatiquement et dans nos intimités également. On nous somme « d’hystérie » et d’exagération. On nous matraque que l’égalité est « déjà là » (droit de vote et lois contre les violences sexistes et sexuelles).
Ma réflexion ne vient pas questionner cette légitimité, elle vient questionner les réponses que nous arrivons à donner pour lutter contre le patriarcat. Je crois que la colère n’est pas une réponse. La colère est une émotion, un moteur pour répondre. Je fais le vœu que nous arrivions à unir nos forces motrices pour construire une réponse efficace.
Et dans « efficace » je veux dire : qui s’adresse aux concernés à savoir les hommes puisqu’ils sont, tout comme les personnes sexisées, acteurs du patriarcat. Nous en sommes acteur-ices, quel que soit notre place dominante ou dominée, nous entrons dans le jeu du patriarcat par le simple fait que nous ne pouvons pas exister en dehors de ce système/cis-tème. Nous nous positionnons par rapport à lui, mais il nous pré-existe !
Néanmoins, la différence notoire est que les hommes cis-genres, tout en étant acteur, bénéficient de façon majoritaire des privilèges que créent le patriarcat. Bien sûr ils n’en retirent pas que des bénéfices (cf. incapacité à l’intelligence émotionnelle[13]) mais, outre le fait que très peu d’hommes ont conscience de ce qu’ils perdent dans ce cis-tème patriarcale, ils jouissent et se vantent de privilèges qui nous écrasent (politiquement, économiquement, sexuellement, professionnellement, …).
Nous devons travailler à qu’est-ce que ça signifie : s’adresser aux hommes cisgenres ? Il est vrai que cela implique une sociolinguistique et une rhétorique du discours qui vont probablement nous hérisser. Adresser un discours pour qu’il soit assimilable par notre « cible », c’est se mettre à la place de, intégrer ses codes et les réutiliser pour les modifier petit à petit… Arriver face à un groupe opposé à notre vision des choses et lui exposer nos propos, avec nos codes, c’est à coup sûr inefficace.
Nous devons nous positionner juste à côté de leurs positions, à 1 centimètre d’abord puis quand ce centimètre sera acquis, on continuera notre marathon … Notre colère et l’urgence de la situation (féminicides et autres violences de genre) rend cette stratégie des centimètres émotionnellement invivable… je le reconnais. Mais à tête froide, je me demande si une autre est possible sans craindre des back-clashs monstrueux (masculinismes, montées de l’extrême droite, …).
A tête froide cela ne veut pas dire, que la colère ne m’habite pas ni que l’urgence je ne la ressens pas. Je n’en peux plus de cette masculinité qui se permet la violence criante, ni celle qui l’exerce en silence au creux de l’intime. Je n’en peux plus de cette masculinité qui essaie de comprendre, de s’éduquer mais qui manifestement n’y arrive pas (pas suffisamment, pas assez vite – à mon goût) et trébuche, sur nous. Ce n’est pas sur le tapis qu’ils se cassent la gueule, c’est sur nous – leurs partenaires.
C’est nous qui applaudissons leurs intérêts pour le féminisme mais c’est nous aussi qui allons chez le psy gérer les aléas de leur rechute toxique. Et quelque fois, ils sont navrés de ne pas y arriver et j’ai la naïveté (?) de leur prêter cette humanité… navrés d’avoir crié, navrés d’avoir négocié, navrés de nous culpabiliser, navrés d’avoir cassé la vaisselle, navrés d’avoir tapé dans le mûrs, navrés de nous avoir fait peur, navrés d’une main au cul possessive ou d’un baiser forcé pour rassurer leur égo séducteur.
Je les plains, je plains leur bêtise et j’en suis même atterrée… pour autant je n’ai pas envie de jeter l’éponge (enfin si ! mais j’aimerais qu’on puisse alterner nos burn-out féministes, se relayer dans l’énergie à mettre dans cette lutte efficace contre le patriarcat). J’aimerais que la misandrie (que je comprends) ne réduise pas nos capacités à agir pour une vie vivable et plurielle (avec tous les genres), sans avoir besoin de s’exclure du monde pour survivre.
Article 1 d'une série "cher-s amant-s, j'aimerais vous voir pleurer"
Autrice : Romane Faure-Mary
@romane.fauremary.autrice
Bibliographie
ABBEY, Camille. « L’amour après #MeToo : un manuel pour une séduction féministe ». Missives (blog), 11 mai 2019. https://www.lesmissives.fr/index.php/2019/05/11/lamour-apres-metoo-un-manuel-pour-une-seduction-feministe/.
CALLEBAUT, Daniel. « OCEANIUMS, A Biomimetic Generation of Floating and Sustainable Stadiums ». VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURES. Consulté le 24 juillet 2024. https://vincent.callebaut.org/object/220901_oceaniums/oceaniums/projects.
collectiffeministe. « Pour une séduction féministe! » GARCES, le collectif féministe (blog), 15 novembre 2013. https://collectiffeministe.wordpress.com/2013/11/15/pour-une-seduction-feministe/.
CORMONT, Alexandre. « Les 9 secrets pour séduire une femme et la rendre accro ! », 22 avril 2024. https://www.alexandrecormont.com/comment-seduire/comment-la-seduire/seduire-une-femme-2/.
DDP, Tiffany de. « Comment Séduire Une Femme Féministe : Mes 3 Conseils ». Dragueur de Paris, 17 juin 2021. https://www.dragueurdeparis.com/comment-seduire-une-femme-feministe/.
Denis, Emma. « Les coachs en séduction sur YouTube : mise en discours des masculinités ». université grenoble alpes, 2022. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03826691.
Fontenaille, Raphaëlle. « Militant cherche posture : Francis Dupuis-Déri, Les hommes et le féminisme. Faux amis, poseurs ou alliés ?, Textuel, 2023, 190 p., 17,90 € ». Revue Projet, 2024.
France Inter. « Les cités flottantes, utopie ou réalité ? Y aura-t-il un peuple de l’eau ? », 18 janvier 2024. https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/zoom-zoom-zen/zoom-zoom-zen-du-jeudi-18-janvier-2024-9799674.
Gourarier, Mélanie. Alpha mâle, séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes. Seuil., 2017.
Greco, Luca. « Les recherches linguistiques sur le genre : un état de l’art ». Langage et société 148, no 2 (2014): 11‑29. https://doi.org/10.3917/ls.148.0011.
Harmange, Pauline. « Pourquoi haïr les hommes ? : La misandrie comme autodéfense féministe ». Revue du Crieur, 2020.
« hce_-_rapport_annuel_2024_sur_l_etat_du_sexisme_en_france.pdf ». Consulté le 24 juillet 2024. https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_-_rapport_annuel_2024_sur_l_etat_du_sexisme_en_france.pdf.
Hooks, Bell. La volonté de changer: les hommes, la masculinité et l’amour. Éditions divergences, 2021.
Jacquemart, Alban. « L’engagement féministe des hommes, entre contestation et reproduction du genre ». Cahiers du Genre, 2013.
Le HuffPost. « Le grand flou du budget dédié aux droits des femmes », 3 septembre 2019. https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/grenelle-des-violences-conjugales-le-grand-flou-du-budget_150840.html.
Lola. « [Communiqué de presse] La Fondation des Femmes lance un fonds d’urgence ». Fondation des Femmes, 1 septembre 2023. https://fondationdesfemmes.org/communiques-de-presse/communique-de-presse-fonds-urgence-associations/.
Meyer, Michel. « Chapitre IV. Rhétorique et argumentation : la loi fondamentale d’unification des champs », 4e éd.:51‑69. Que sais-je ? Paris cedex 14: Presses Universitaires de France, 2020. https://www.cairn.info/la-rhetorique--9782715404199-p-51.htm.
Paichard, Léo. « La diffusion d’une idéologie radicale par un mouvement d’extrême droite. Étude de l’association « Égalité et Réconciliation » », 9 septembre 2015, 213.
Pennec, Blandine. « Stratégies discursives implicites et manipulation ». In Parole et pouvoir 2 : Enjeux politiques et identitaires, édité par Martine Schuwer, 101‑17. Interférences. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2005. https://doi.org/10.4000/books.pur.31015.
Raibaud, Yves. « Penser le masculin dans une perspective féministe ». Pessac, 2013. https://hal.science/hal-00950140/file/Penser_le_masculin_dans_une_perspective_fA_ministe.pdf.
Ronsin, Louis. « Analyse sémiologique du discours des coachs en séduction sur YouTube : de la fabrication d’un éthos de leader à la commercialisation d’une idéologie : quand la fabrique du réel permet la prise d’influence ». sorbonne université, 2022. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04023542.
Scott, Joan Wallach. « L’énigme de l’égalité ». Cahiers du Genre 33, no 2 (2002): 17‑41. https://doi.org/10.3917/cdge.033.0017.
Thomas. « Faut-il être féministe pour séduire une femme en 2024 ? » Séducteur Moderne | Conseils en séduction et comparaison de sites de rencontre (blog), 7 janvier 2022. https://seducteurmoderne.com/conseils/seduction/feministe/.
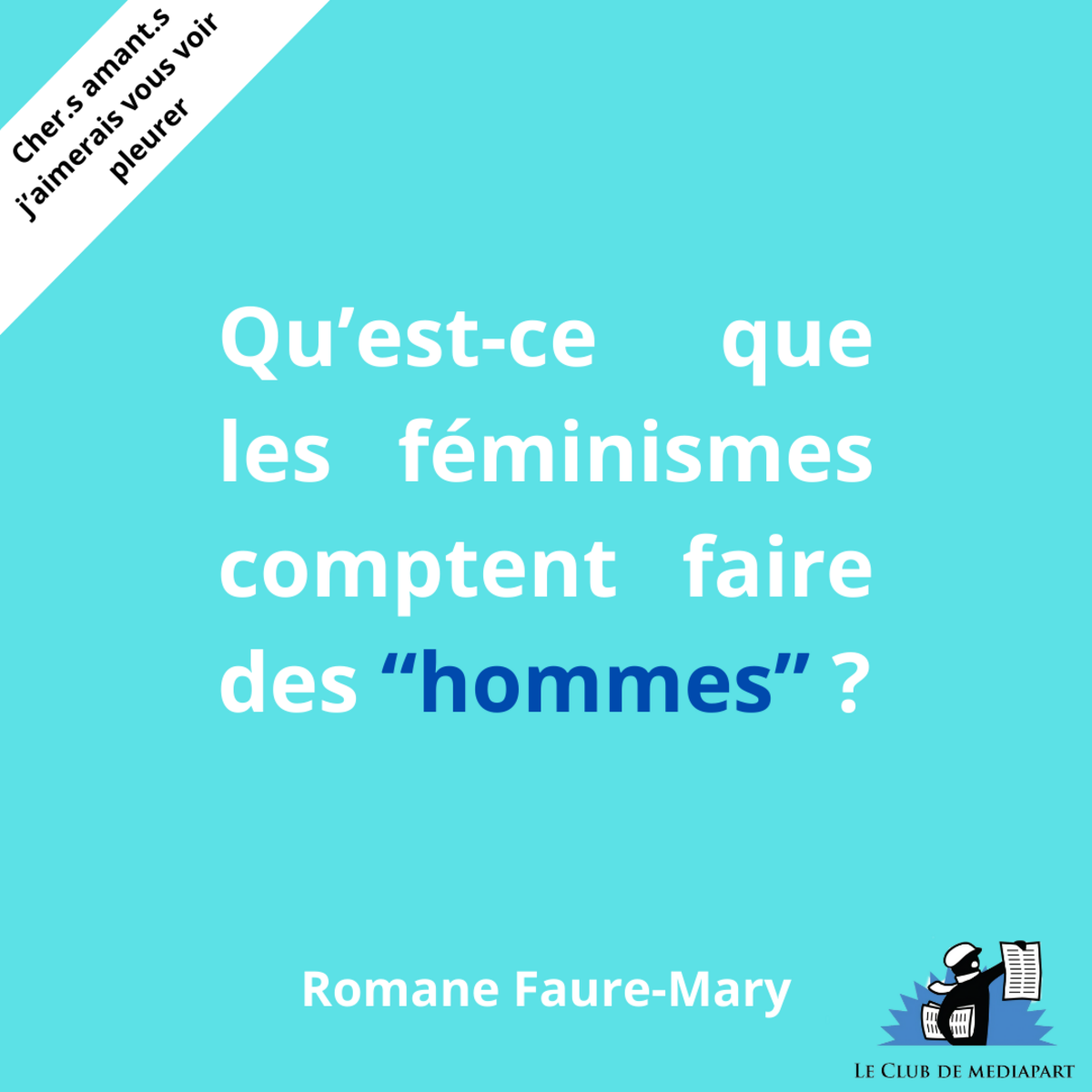
Agrandissement : Illustration 1