Ces derniers mois ont vu se succéder des manifestations de policiers, organisées à travers tout le pays, faisant suite tantôt aux accusations de « violences policières » visant à dénoncer les abus commis par certains policiers ou gendarmes dans l’emploi de la force publique [1], tantôt aux violences dont les forces de sécurité de l’Etat peuvent elles-mêmes être victime dans l’exercice de leur fonction [2], tantôt à l’occasion de revendications sociales adressées à une autorité… incompétente [3].
Si de tels rassemblements revendicatifs ne posent en eux-mêmes pas de difficultés particulières [4], encore convient-il qu’ils se déroulent conformément à la réglementation déontologique particulièrement exigeante en la matière, dans la mesure où elle s’adresse aux dépositaires de l’autorité publique, dotés à ce titre du monopole d'usage de la violence légitime.
Cela signifie que ces agents ne peuvent pas manifester n’importe comment, à n’importe quel moment, et a fortiori à n’importe quel endroit [5].
S’agissant spécialement des policiers, deux dispositions méritent d’être rappelées :
- l’article R. 434-29 du Code de la sécurité intérieure :
« Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.
Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression » ;
- l’article 113-10 du Règlement général d’emploi de la police nationale (arrêté du 6 juin 2006) :
« [Les policiers] s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent ».
En résumé :
- les policiers, comme tous fonctionnaires, sont astreints à une obligation de neutralité et doivent, à ce titre, s’abstenir de manifester, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, leurs opinions religieuses, politiques ou philosophiques ;
- en dehors de leur service, ils recouvrent une certaine liberté d’expression dans les limites du respect du devoir de réserve [6] et de la loyauté due aux institutions de la République, et s’abstiennent par conséquent de tout agissement ou parole susceptible de porter la déconsidération sur la police nationale.
A la lumière de ces règles et principes, un survol des actualités des derniers mois ou dernières années relatives aux manifestations de policiers (v. notamment les notes citées en bas de page) permettra de constater assez vite que le cadre déontologique qui vient d’être explicité n’est que trop peu respecté [7].
Des policiers ont en effet – notamment au mois de décembre 2020 – pu manifester, dans les quatre coins de la France, munis de leur brassard et ou uniforme, de leur véhicule de service assorti, pour certains, d’un gyrophare en état de marche, ou encore de leur arme de service apparente.

Agrandissement : Illustration 1

Est-il besoin de préciser qu’une telle façon de manifester se situe aux antipodes des règles déontologiques exposées en amont ? En effet, loin de se délester des attributs de sa fonction, cette façon de protester peut s’apparenter alors à un usage illégitime de la liberté de manifestation confinant – au moins sur le plan symbolique – à un « coup de force ».
Ce qui ne saurait être admis dans aucun Etat de droit démocratique.
Le phénomène est d’autant plus préoccupant lorsqu’il a lieu aux abords immédiats d’enceintes de justice [8] et plus largement des institutions de la République.
Face à ces écarts ou violations manifestes de la réglementation applicable, l’on ne peut que déplorer une certaine inertie du pouvoir politique et de la hiérarchie administrative en l’absence de rappel solennel des obligations statutaires s'imposant aux forces de sécurité de l’Etat, et de l’engagement d’une quelconque action disciplinaire visant à sanctionner le respect de celles-ci [9].
La réaction la plus récente à de telles dérives remontant, à notre connaissance, à un communiqué de presse du 18 octobre 2016 du Directeur général de la Police nationale, Jean-Marc Falcone, diffusé suite à des manifestations de policiers (dont certains étaient en position de service et dotés de leur uniformes et véhicules de service) intervenues dans la nuit du 17 au 18 octobre 2016 à Paris et en Ile-de-France quelques jours après l’attaque de Viry-Châtillon.
Le haut responsable avait alors dénoncé un comportement « inacceptable » et des modalités de l’expression publique de policiers « contraires à leur obligations statutaires » et émis l’avertissement suivant :
« Les policiers en effet ne peuvent outrepasser les devoirs que leur impose leur statut et qui fondent la légitimité de l’accomplissement de leurs missions de police au service de l’ordre public et de la loi républicaine.
Par ce comportement, ils fragilisent la Police nationale et fragilisent aussi chaque policier ».

Agrandissement : Illustration 2
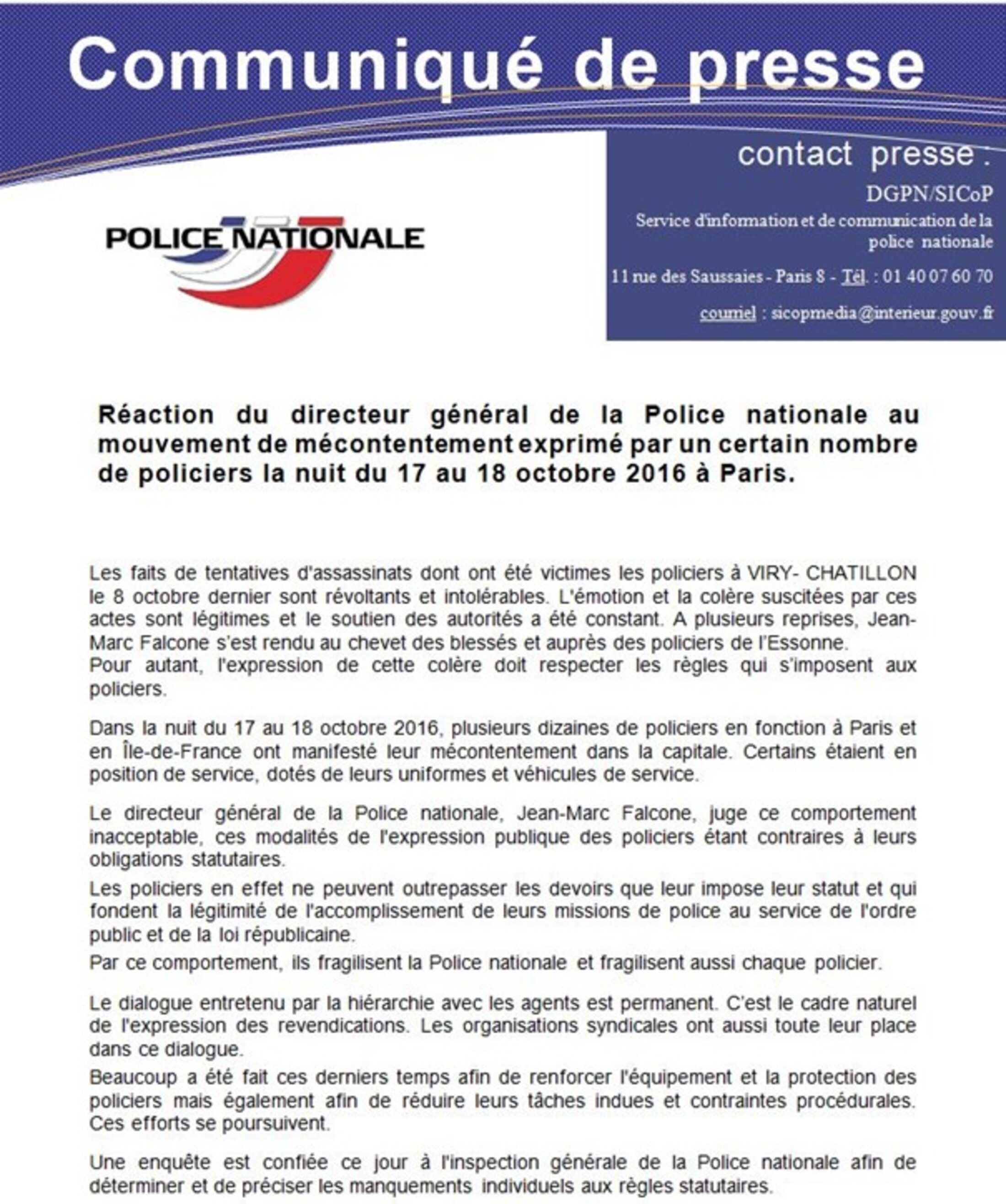
En conclusion, les développements qui précèdent n’ont pas pour objet de dénier leur liberté de manifestation aux policiers, qui peuvent légitimement en faire usage pour rendre public leur mécontentement au sujet de leurs conditions de travail et notamment des risques psycho-sociaux auxquels ils doivent faire face dans l’exercice de leur profession [10].
Bien au contraire, la liberté de manifester des policiers est une liberté qui leur est reconnue et garantie, le cas échéant par la justice [11], en leur qualité de citoyen.
Cette liberté ne va toutefois pas sans une responsabilité particulière au regard de la nature même de leurs fonction et prérogative au sein d’une société démocratique, et de la confiance que la société est en droit de placer dans sa force publique.
[1] Voir notamment les manifestations qui ont émaillé le mois de décembre 2020 en réaction aux propos du chef de l’Etat prononcés sur le média Brut à ce sujet, ou encore celle qui s’est déroulée le 17 décembre 2020 devant le Tribunal judiciaire de Tours après qu’un policier a été condamné pour des faits de violences volontaires sans ITT par personne dépositaire de l’autorité publique à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction d’exercice professionnel pendant 18 mois.
[2] L’on pense ici évidemment aux manifestations ayant fait suite à l’attaque aux cocktails molotov dont ont été victimes des policiers le 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon et qui se sont poursuivies tout le long de la procédure judiciaire jusqu’à la décision rendue le 17 avril dernier à hauteur d’appel par la Cour d’assises des mineurs de Paris.
[3] Manifestation bruyante de policiers près du domicile de la maire de Rennes : Nathalie Appéré réagit (France Bleue, 18 décembre 2020)
[4] On rappellera à cet égard que les fonctionnaires actifs de la police nationale (art. L. 411-4 du Code de la sécurité intérieure) ainsi que les gendarmes (art. L. 4121-4 du Code de la défense) ne disposent pas du droit de grève.
[5] Sans évoquer les règles relatives à la déclaration préalable des manifestations et à leur déroulement (art. L. 211-12 du Code de la sécurité intérieure) ou encore celles afférentes au respect du couvre-feu en période d’état d’urgence sanitaire.
[6] Comme le rappelle le site service-public.fr, ce devoir ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion est reconnue aux agents publics), mais leur mode d'expression, et s’applique pendant et en dehors du temps de service.
[7] Même si des divergences existent entre les différents syndicats de police sur le respect de la déontologie ainsi que cela a pu être observé dernièrement à Angers.
[8] A cet égard, même exempte de tout attribut lié à la fonction de policier, il nous semble qu’une manifestation de policiers aux abords directs d’un palais de justice – de surcroît lorsqu’une affaire impliquant un policier y est ou y a été jugée – ne nous paraît pas moins problématique du point de vue de la loyauté due aux institutions de la République et plus largement du respect de la séparation des pouvoirs. Peut être utilement lu à ce sujet le communiqué de presse publié le 18 décembre 2020 par Christophe Régnard, président du Tribunal judicaire de Tours, suite à une manifestation de policiers organisée en réaction à un jugement condamnant un policier pour des faits de violences (v. note de bas de page n° 1) ; communiqué dont voici un extrait : « En démocratie, la Justice se rend dans les prétoires, et non dans les rues. Elle doit pouvoir passer sereinement sans pressions d’où qu’elles viennent. Le respect des procédures destinées à protéger les citoyens s’impose à tous, et sans doute plus qu’à tous autres, aux forces de sécurité intérieure ». A cet égard, peut en outre être mentionné, en sus des obligations statutaires des policiers, l'article 434-25 du Code pénal qui érige en délit punissable d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende " le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance ".
[9] Cela n’a pas toujours été le cas, si l’on songe à la réaction du pouvoir politique suite aux manifestations du 3 juin 1983, qui ont vu de nombreux policiers être sanctionnés, le préfet de police présenter sa démission et le directeur général de la police nationale être démis de ses fonctions. S’agissant de l’actuel préfet de police de Paris, l’absence de réaction de sa part peut se comprendre au regard des écarts avec la déontologie qui ont pu être les siens (cf. notamment les propos suivants qu’il avait tenus, le 16 novembre 2019, à l’encontre d’une manifestante « gilet jaune » pacifique, en violation de ses obligations de neutralité et de réserve : « nous ne sommes pas dans le même camp, Madame ! »).
[10] En 2019, 59 policiers se sont suicidés (question parlementaire n° 17202 de M. Roger Karoutchi, JO Sénat, 9juillet 2020, page 3141).
[11] Voir notamment CE, 26 juillet 1985, Gandossi, n° 64024 ; ou encore TA Montpellier 2001, 4 juillet 2001, n° 96-4132 ; TA Toulouse, 3 décembre 1998, n° 97-0082.



