
Dès la lecture de la quatrième de couverture et de la préface signée par l’inénarrable Mustapha Benfodil (1), les questions affluent, avant même d’aborder la première nouvelle. Page après page, des réponses émergent, incertaines peut-être, mais assez tangibles pour éclairer ce qui se joue en arrière-plan du livre. De là, plusieurs pistes de lecture se dégagent.
L’œil de la cinéaste qu’est Sarah Kechemir a-t-il influencé sa plume, rendant son écriture plus imagée ? La réponse est oui. Ihe (2) et cela se perçoit dans plusieurs « séquences » du recueil. À plusieurs reprises, le lecteur est invité à ressentir et à imaginer les péripéties des personnages. L’autrice a voulu créer à chaque fois une émotion symbolique, en peignant avec les mots. Et ce n’est pas de l’abstrait. L’écrivaine ne cherche pas à brouiller la vision. Les fresques de Sarah Kechemir sont figuratives, probablement pour représenter les situations telles qu’elles sont, tout en y ajoutant (souvent) une intensité nouvelle. Fait étonnant, malgré son regard de cinéaste, l’écrivaine n’évoque le 7ᵉ art qu’à une seule reprise, en citant « Édouard aux mains d’argent ». Une sobriété qui semble moins relever de l’oubli que d’un choix conscient, celui de se positionner avant tout comme autrice, et non comme réalisatrice.
Le recueil est-il un manifeste qui défend le féminisme ? Féminin, oui. Féministe, sur les bords, sans doute. Mais de là à parler de manifeste, c’est aller un peu loin.
Le livre est-il contre le patriarcat ? Non, malgré quelques nuances qui laissent parfois imaginer, à certains passages, que l’autrice se retient.
L’écriture est-elle inclusive ? Certes, le livre est porté par une sensibilité féminine, mais sans recours à l’écriture inclusive. Néanmoins il faut noter qu’il y a presque invisibilisation de l’homme, du « mâle ». « La vie au-dedans » est un recueil kaléidoscopique où chaque nouvelle est un fragment d’une fresque.
L’écriture est-elle féminine ? Là, pas d’hésitation la réponse est OUI et OUI. Il y a une intimité entre l’émotion et le texte, où la sensibilité s’impose comme la clé de lecture essentielle de l’œuvre.
S’agit-il d’un appel à investir des espaces traditionnellement réservés aux hommes ? Oui, et même lorsque le sujet est inexistant dans l’histoire de la nouvelle, l’écrivaine y lance, subtilement, quelques flèches.
Le livre peut-il être considéré comme un ouvrage algéro-algérien ? Oui, sans aucune hésitation. L’une des meilleures illustrations en est le glossaire placé à la fin. Il est venu « alléger » la lecture pour ceux qui n’auraient pas pu comprendre des passages écrits en derdja et en arabe classique, avec des lettres latines ou caractères arabes. L’ancrage algérien du recueil s’exprime aussi par ses décors. Les récits se déroulent entre Alger, où vit l’écrivaine, Oran, sa ville natale et d’enfance, et d’autres espaces non nommés mais reconnaissables, tous profondément algériens.
Bien sûr, le livre de Sarah Kechemir ne se réduit pas à une simple succession de questions et de réponses. Au-delà de ces pistes, une dimension plus symbolique retient l’attention.
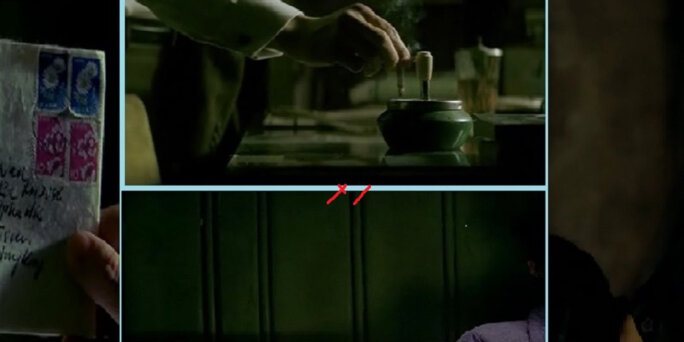
Agrandissement : Illustration 2

Nûn
Parmi les fils qui traversent ce recueil, celui du nûn (ن) retient l’attention. Sur les neuf nouvelles, cinq tournent autour de prénoms qui commencent par cette lettre, comme un signe discret.
Faut-il y voir une résonance spirituelle ? Rien ne l’indique explicitement. Et pourtant, l’ombre d’une référence soufie plane peut-être, subtile, cachée entre les lignes, comme une vibration intime que l’autrice aurait préférée muette.
Néanmoins, qu’il s’agisse d’un choix conscient ou non, le nûn (ن) dépasse la simple fonction de lettre. Dans la langue arabe, sa forme arrondie, semblable à un berceau, est traditionnellement associée au féminin. Et ce n’est sans doute pas un hasard si plusieurs héroïnes du recueil (Nawel, Nadera, Naïma, Noor et Nadia) en portent l’empreinte.
Les ombres du passé
Le féminin, dans le recueil, n’est pas détaché du contexte historique. Il dialogue avec la mémoire nationale, notamment celle de la décennie noire, racontée ici autrement.
Cette période, Sarah Kechemir la revisite à travers les yeux d’une petite fille, dans « Le rossignol ne chantera plus », où l’on perçoit un vécu intime, presque tactile. Une forme de témoignage enveloppé de sensations. Le texte dit combien les perceptions d’une tragédie peuvent varier selon le moment, l’âge ou la conscience de celle qui la traverse.
L’autrice revient sur la même période à la fin du recueil. Dans « Les naufragés du Cap », elle aborde à nouveau les années 90, avec le terrorisme en toile de fond. Sous une apparente nostalgie, le récit révèle les blessures et les dégâts collatéraux laissés par cette décennie sombre. De fil en fil, entre mémoire intime et mémoire nationale, le recueil finit par tisser une trame intérieure où tout se répond.
Au fond, c’est peut-être cela, « La vie au-dedans », une métempsychose de la mémoire, où le passé retrouve vie sous la plume du présent.
Toutefois, on sent que Sarah Kechemir n’a pas tout dit. Qu’elle s’est contenue, volontairement. Derrière chaque nouvelle, un espace vide subsiste, comme une promesse non tenue, un récit à poursuivre.
Le peuple demande plus.
Salim KOUDIL
(1) Journaliste, écrivain, homme de théâtre
(2) Oui



