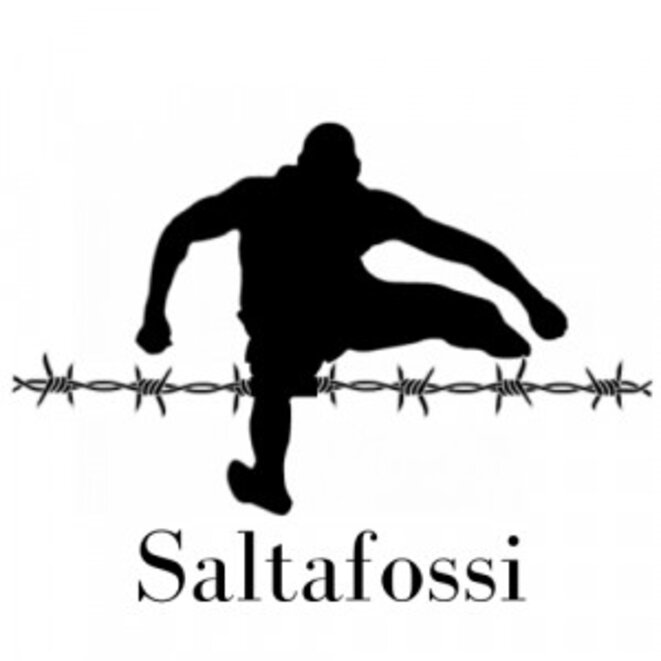De l’extérieur, on devine très peu de choses. Les portes de l’ancienne école rue Erlanger, Paris 16ème, restent fermées la plupart du temps, pour des raisons de sécurité. Mais à l’intérieur, environ 600 jeunes exilés remplissent le lieu de vie depuis début avril. Accompagnés par plusieurs associations (Utopia 56, les Midis du MIE, la Timmy, Médecins du monde…) la majorité des jeunes sont en attente de se voir reconnaître leur minorité et d’obtenir le suivi accordé aux mineurs isolés.
« Tout le monde ici a demandé d’être reconnu mineur, et on a été refusé, lance Abed*, un jeune Conakryka. Et on est tous en recours auprès du juge, on va être reconnus, alors pourquoi faire ça ? »
Marwan*, lui aussi provenant de la Guinée Conakry, détaille son expérience : « Pour voir si t’es mineur, ils te posent quelques questions et c’est tout. Il n’y a rien d’autre. » Marwan est arrivé à l’école début mai, avant il dormait à la rue à Crimée, dans le 19ème arrondissement. « J’attends mon recours chez le juge, on va voir. »
« Même si t'as tous les documents du monde, ils te réfusent. »
Les entretiens sur la minorité sont tenus à Paris par la Demie (Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers), un dispositif de la Croix Rouge. « C’est des entretiens le plus souvent menés par des non-spécialistes, parfois par une seule personne, précise Paul Alauzy, chef de mission chez Médecins du Monde à Paris. Il faut s’imaginer qu’on décortique le parcours de vie de ces jeunes, et que le plus souvent à la fin on leur dit : ‘on ne te croît pas’. » Une situation résumée lapidairement par Abed : « Même si t’as tous les documents du monde, il te refusent. Wallah pourquoi ils font ça je ne sais pas, ils nous mènent en rond c’est parce que ça leur est profitable. »
Une fois l’entretien fixé, les services de l’État sont tenus d’héberger les jeunes. Peut-être une raison de délais d’entretien plutôt expéditifs et de délais de recours plutôt longs : des 4 mois maximum à Paris, aux 6 mois à Bobigny, aux 14 mois à Evry, par exemple. Un rapport de la défenseure des droits de février 2022 détaille les limites du système concernant les mineurs isolés, et demande une meilleure prise en charge et accompagnement des jeunes. Elle demande notamment la mise en place d’une présomption de minorité dès qu’une personne isolée se déclare mineure d’âge. La zone grise dans laquelle se retrouvent nombre de mineurs isolés les rend vulnérables et sujets à des situations extrêmement difficiles, comme la vie à la rue. D’où l’action menée par Utopia56 et les autres associations.
L’ancienne école du 16ème arrondissement a été occupée à partir du 4 avril, d’abord par 200 jeunes environ, puis le nombre d’occupants a rapidement augmenté. « Nous accueillons une vingtaine de jeunes par jour, détaille Yann Manzi, directeur général d’Utopia56. La situation est en train de devenir ingérable. »Sans eau courante ni électricité, l’occupation est pour le moins inconfortable. « Je suis fatigué partout dans le corps, se plaint en anglais Mounir*, arrivé en France il y a 5 mois depuis le Liberia. C’est difficile, vraiment difficile. » Le jeune a fait le voyage avec son oncle à travers le Maroc, puis l’Espagne. Il est, comme les autres, en attente du recours chez le juge.
Par manque de places, plusieurs dizaines de tentes sont apprêtés dans la cour de l’école. Quelques dessins décorent les murs de la court, avec les portraits des jeunes, leurs noms, les drapeaux de leurs pays, parfois leurs rêves. « Je suis parti même si ma famille n’était pas d’accord, avec mon cousin, raconte Abed. Tu sais les rêves d’un jeune… Encore maintenant c’est difficile avec mon père. Ma mère, elle, elle m’aide comme elle peut. » Le jeune Conakryka est désemparé face à l’accueil de la France. « On pense que ça va aller mieux, mais non. Ce n’est vraiment pas possible de laisser les gens dormir dehors. »

Agrandissement : Illustration 1

Une occupation difficile à tenir
Dans l’école, l’organisation est difficile, avec un manque chronique de bénévoles pour assurer la distribution de repas, l’accueil de nouveaux venus, l’orientation des jeunes pour les recours ou auprès d’autres associations. « Il y a beaucoup de bénévoles et de solidaires autour de l’école, se réjouit Karine, du collectif Solidarité Migrants Wilson. On se relaie et on vient quand on peut. » Entre un jus de fruits et un gâteaux distribué, la femme explique son engagement. « J’aime les collectifs, je trouve que c’est pas aussi cadré qu’une association, chacun.e y met sa patte comme iel peut. »
Pendant le mois d’avril, Médecins du monde assurait une présence hebdomadaire pour garantir les soins de ceux qui en avaient besoin. « On était là tous les mercredis, avec trois médecins et un psychiatre spécialisé, rembobine Paul Alauzy, chargé de projet chez Médecins du Monde. Mais on est une association militante, et on a plutôt le rôle de faire intervenir le droit commun, donc notre place a été prise rapidement par la Croix Rouge. »
Depuis le début de l’occupation, les jeunes présents augmentent en nombre et les tensions se cumulent. Début mai, l’organisation change et les jeunes sont priés de partir au matin, à 10 heures, pour ne revenir que le soir, aux alentours de 18 heures. Une décision qui fait débat. « Ils ferment l’école parce qu’on est trop et on fait des palabres, se plaint Abed. Mais c’est normal quand il y a trop de monde. » Les jeunes passent leurs journées dans d’autres associations, le plus souvent au nord de Paris. « Moi je vais souvent jouer au foot, explique Mounir. Je monte à porte de Clignancourt. »
Chaque sortie est source de stress pour les jeunes, qui risquent d’être contrôlés par la police et de subir des agressions. « Il ne faut pas sortir à plus de deux ou trois, Abed raconte sa stratégie. Sinon t’es trop visible. Je cherche toujours à être tranquille quand je sors. » Les journées de vadrouille provoquent parfois des tensions avec les bénévoles. « L’autre jour je suis rentré ici fatigué, j’avais passé une mauvaise journée. À la porte, la dame m’a demandé de sourire, se plaint Marwan. Ou bien on nous demande de dire merci et s’il vous plaît quand on nous donne à manger. » Une forme d’infantilisation pour les jeunes, qui expriment d’autres soucis. « Quand tu passe la journée dehors, tu vois les problèmes et t’es tendu, tu ne penses pas à ça. Tu penses à la gentillesse quand t’as le ventre plein et pas de soucis. » À l’approche de 10 heures, les bénévoles font le tour de l’école pour s’assurer que tout le monde est sorti, et dire aux restants de partir.
« On se pose la question de ce qu'on va faire, de ce que va faire l'État »
Pour Yann Manzi, la situation est difficilement gérable.« On a beaucoup de bénévoles, mais ce n’est pas assez, et il ne sont pas forcement formés. Tout le monde est fatigué, et la situation devient très tendue. On se pose la question de ce qu’on va faire, et de ce que va faire l’État. »
Pour Utopia56, l’ouverture de l’école est une action de mise à l’abri et en même temps un playdoier. « On veut que l’État prenne en charge l’accueil de ces jeunes, comme il est censé le faire », élabore Yann Manzi.
Mais la non-réponse des autorités met l’association en difficulté. Le lundi 12 juin, une audition a eu lieu en référé contre l’association. La Mairie de Paris demande l’évacuation des jeunes de l’école. « On se retrouve entre l’enclume et le marteau, sauf que le marteau s’approche de plus en plus. On dit à l’État : n’attendez pas un drame avant d’agir. » Le jugement sera rendu vraisemblablement fin juin, mais le directeur général d’Utopia56 doute que l’occupation pourra tenir jusqu’à cette date. « On ne sait pas si on va arriver à rester ou partir, ce qui serait dramatique pour nous et pour les jeunes. »
Le résultat du jugement déterminera l’avenir des jeunes. Les options ne sont pas très nombreuses : soit un relogement, soit une évacuation « sèche et violente, comme on en a déjà vécues », se désespère Yann Manzi. Le relogement en question pourrait impliquer des déplacements des jeunes en région, suivant la nouvelle politique de l’État à l’approche des JO de Paris en 2024. La préfecture de police de Paris déclare avoir ouvert une enquête, le 16 mai, pour une manifestations non déclarées de l’extrême droite aux abords de l’école. Elle souligne que la présence de policiers dans le secteur est renforcée et que l’éventuelle mise à l’abri des jeunes suite au procès appartient à la préfecture de l’Île-de-France. Cette dernière n’a pas souhaité répondre à mes questions, tout comme Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge de la protection des réfugiés.

Agrandissement : Illustration 2

« C'est seulement la solidarité citoyenne qui nous sortira de cette situation »
La stratégie de l’association trouve ses limites dans le rapport avec les autorités, qui lui opposent un dialogue de sourds et poussent à bout ses possibilités limitées. « Utopia56 maintien la politique de la chaise vide, développe Paul Alauzy, le chargé de projet de Médecins du Monde. Ils veulent montrer que l’État ne remplit pas ses fonctions. Mais concrètement, après le procès les jeunes auront au mieux une mise à l’abri standard, pas adaptée à leur situation spécifique. » Comment sortir de l’impasse ? Yann Manzi a une idée : « C’est seulement la solidarité citoyenne qui nous sortira de cette situation. »
Pour le salarié de Médecins du Monde, l’enjeu dépasse la situation actuelle de l’école. « Il y a une vraie politique de maltraitance des migrants mise en place par l’État. Si le protocole était un protocole d’accueil, on prendrait soin des gens. » Le résultat ? Des personnes en grande détresse. « Les mineurs ont un réseau d’associations qui les prennent en charge assez bien, continue l’associatif. Il est rare d’en trouver sur les campements, par exemple, et quand ça arrive on les renvoie tout de suite vers ceux qui les suivent comme Utopia 56 ou les Midis du Mie. »
Mais l’expérience de la rue guette toujours les jeunes exilés. « Pourquoi en France t’arrive et il te font dormir dehors ? Questionne Abed. Moi quand je vais dans les rues, à Paris, j’en vois plein qui deviennent fous. Tu dors à la rue, tu fais des mauvaises rencontres, tu commence à prendre de la drogue… Mais c’est pas leur choix de faire ça. » Le constat est partagé par Medecins du Monde : « Les jeunes ont déjà beaucoup de détresse psychologique, des histoires terribles dans leurs voyages, témoigne Paul Alauzy. Et en plus les raisons des départs sont souvent liées au deuil. » L’association proposait des entretien psychologiques lorsqu’elle intervenait dans l’école.
À cette situation difficile s’est ajoutée la menace de l’extrême droite. Depuis l’occupation de l’ancienne école, les manifestations se sont multipliées. Némésis, les Natifs, Damien Rieu… Nombre de groupuscules et d’influenceurs de toutes les nuances du brun ont saisi l’occasion pour montrer leur présence dans les médias, avec des rassemblements, des collages, des posts sur les réseaux sociaux. « Ils font leur com’, s’agace Yann Manzi, le directeur général d’Utopia 56. Ils se servent de cet endroit pour balancer leurs saloperie. C’est très violent, rien que leur présence est violente. » Le cadre du chic 16ème arrondissement n’aide sûrement pas, et les jeunes subissent des attaques presque quotidiennement. « Il faut imaginer au niveau psychologique ce que ça représente, alerte Paul Alauzy, le coordinateur de médecins du monde. Surtout pour ces jeunes sans protections et avec un parcours aussi difficile. » De leur côté, certains jeunes affichent une certaine braverie. « Moi, j’ai traversé la Lybie, tu sais comment ça se passe là bas, t’es menacé avec les armes dans la rue, tu es mis en prison pour rien, assure Abed. Ces gens là, ils ne sont même pas armées. Ils ne me font pas peur. »
Mais la menace est bien réelle : « Nous sommes en contact direct avec la police, garantit Yann Manzi, le directeur général d’Utopia 56. Dès qu’on a un problème, ils ont dit qu’ils arriveraient. Mais on est abandonnés à la merci de l’extrême droite par l’État. » L’extrême droite ajoute un élément de stress et tension dont les habitants de l’école n’ont vraiment pas besoin. Les jeunes ne sont pas venus pour être des marionnettes politiques. Arrivés en France pour y habiter et vivre, ils se retrouvent pris dans des enjeux politiques qui les dépassent, des débats dont ils ne sont pas acteurs mais objets. Ils renonceraient volontiers à l’attention qui les entoure. Même lorsqu’elle arrive des médias, parfois. « Photos, photos, tu me demandes des photos mais moi je veux juste manger et sortir », a réagi vivement un jeune lorsque je demandais si ça ne le dérangeait pas que je photographie la table.
*Ces prénoms ont été modifiés
Cet article est paru dans la newsletter Saltafossi, en mai 2023