En France, le maintien de l'ordre est mal codifié. Les libertés de protester ne sont pas protégées par le conseil constitutionnel (contrairement à l'Allemagne) et il n'existe pas de doctrine au sens fort du terme ; seulement des instructions, ici ou là.
De sorte que ce n'est pas la loi, mais les instructions politiques de l'heure qui priment totalement, avec les aberrations que l'on a pu constater (arrestations pour rien, humiliations, nasses illégales). Je reviens sur ces éléments successivement.
D'abord, l'insuffisante protection légale. Le droit à manifester devrait être inscrit dans la constitution, et ne pas être une tolérance de l'administration à partir de critères flous. Cette tradition remonte à Clemenceau, ministre de l’Intérieur de 1906 à 1909.
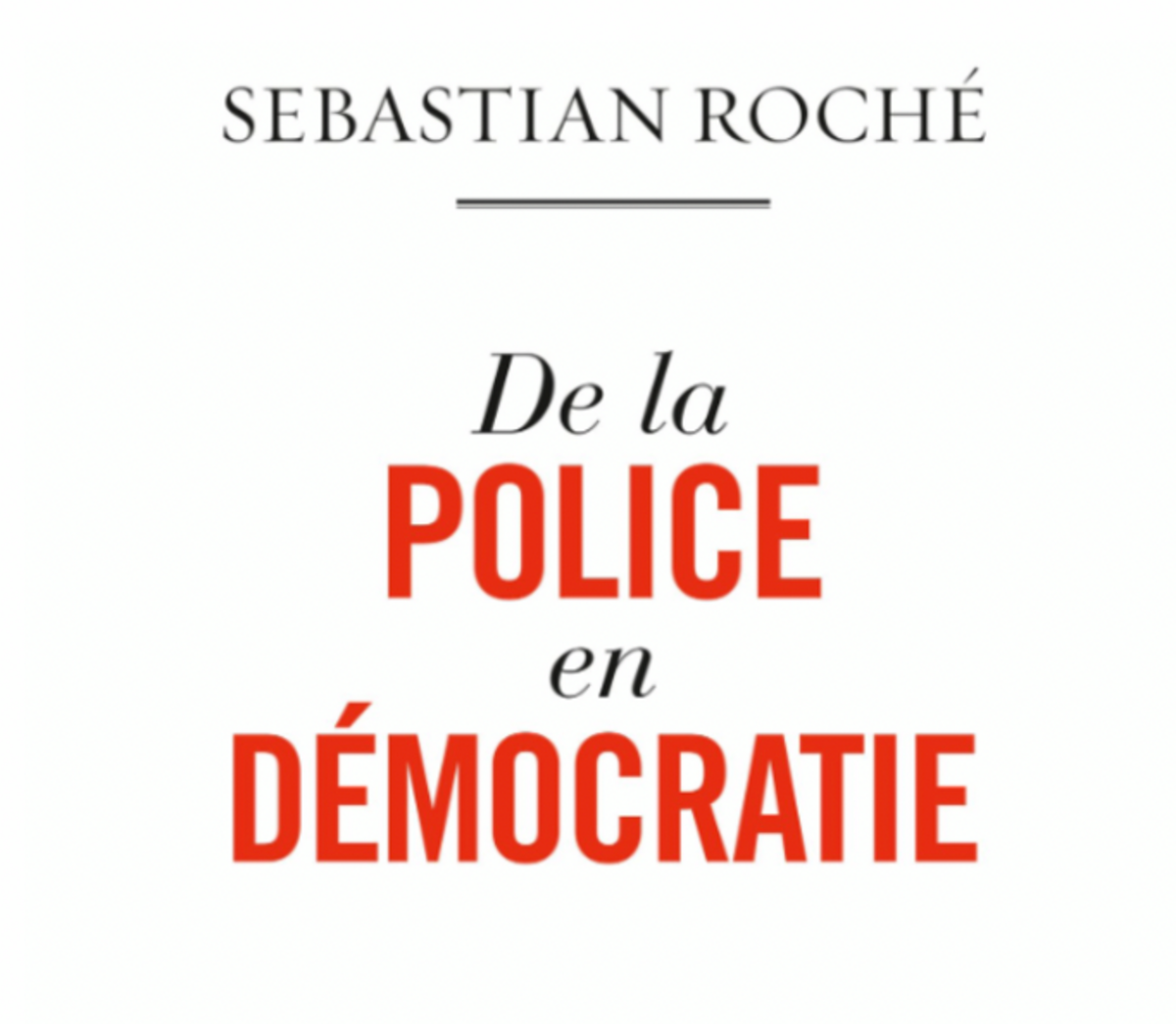
Agrandissement : Illustration 1
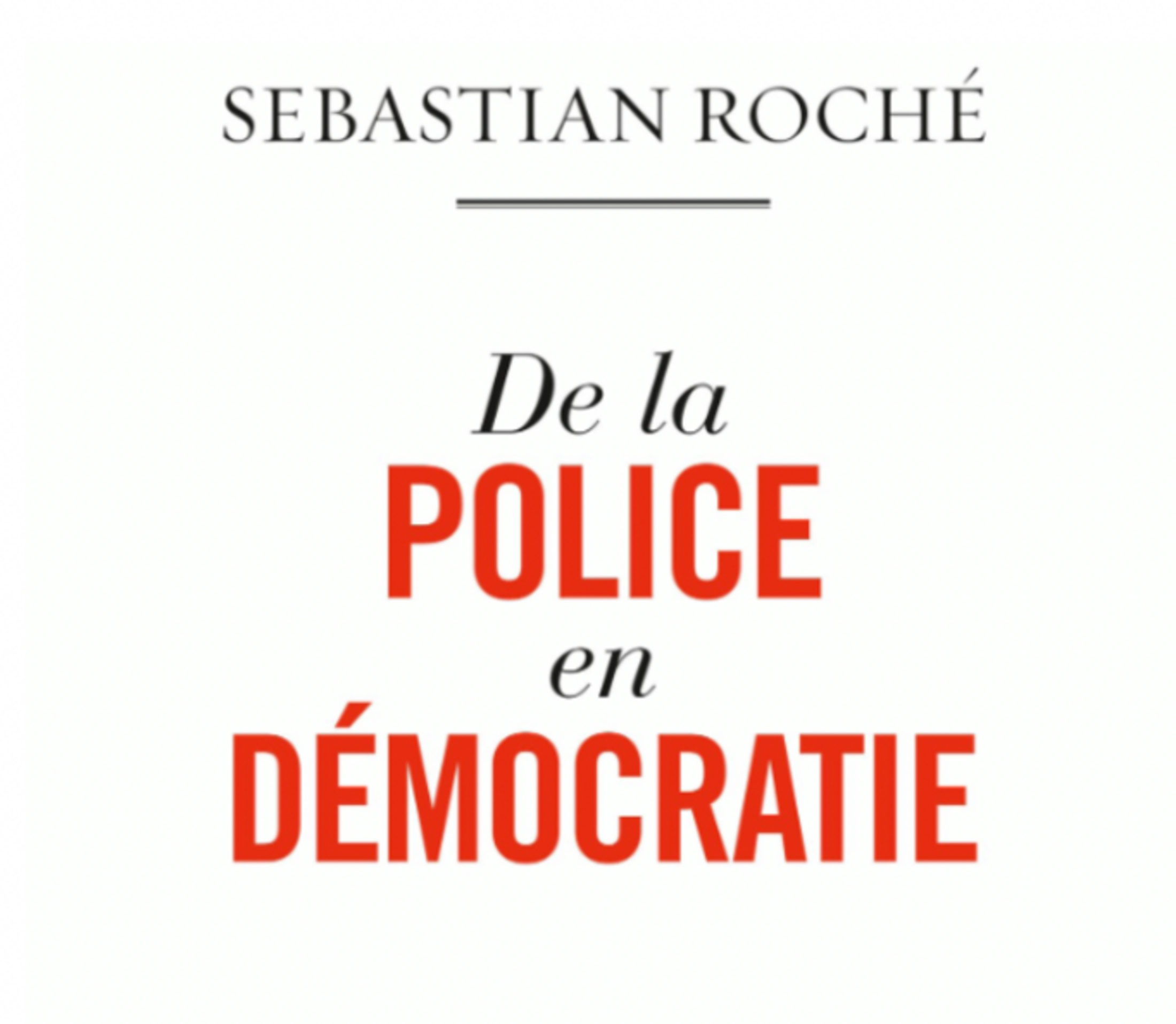
Ensuite, le conseil constitutionnel français protège mal les libertés fondamentales face à la police, et aucun arrêt majeur en ce sens ne semble exister (les juristes me contrediront si besoin). Voir cette interview de Laureline Fontaine (voir ici également).
Elle conclut : « On ne peut pas compter sur le Conseil constitutionnel pour améliorer le niveau de protection de nos droits et libertés » ; « Ce contre-pouvoir n’est réel que s’il remplit certaines conditions. Il doit être avant tout indépendant des pouvoirs qu’il contrôle, ce qui n’est pas le cas. » ; « Ces influences sont d’autant plus importantes que les moyens du Conseil sont relativement faibles comparé à ceux des cours constitutionnelles ou suprêmes étrangères »
C'est un peu embêtant. Par contraste, voir l'Allemagne (et ces perspectives historiques d'Aurore Gaillet) : « Face aux limites des outils de la démocratie représentative classique, faire une place à l’expression de la "culture de la protestation" ».
La codification détaillée au plan des moyens à déplacer en situation en France n'existe que dans l'instruction de 1930 de la gendarmerie nationale, à l'époque partie intégrante du ministère des Armées.
Mais celle-ci liste les grands principes d'un côté, et les pratiques de l'autre ; et les deux restent mal articulés. Je ne connais pas de document comparable côté police.
Les principes sont placés sous une règle d’or : éviter « les conflits brutaux et sanglants ». Cette ligne rouge a été souvent respectée, avec des exceptions spectaculaires cependant, même pendant les périodes républicaines (on pense à 1961 et 1962 en particulier).
Leur but est « d’assurer la liberté et la tranquillité des citoyens », en évitant tout acte qui « pourrait être perçu comme une provocation, un acte de brutalité ou un abus de pouvoir ». « Beaucoup de fermeté, tempérée par le doigté » ; « discipline » sont les qualités attendues. Mais, cela reste insuffisant.
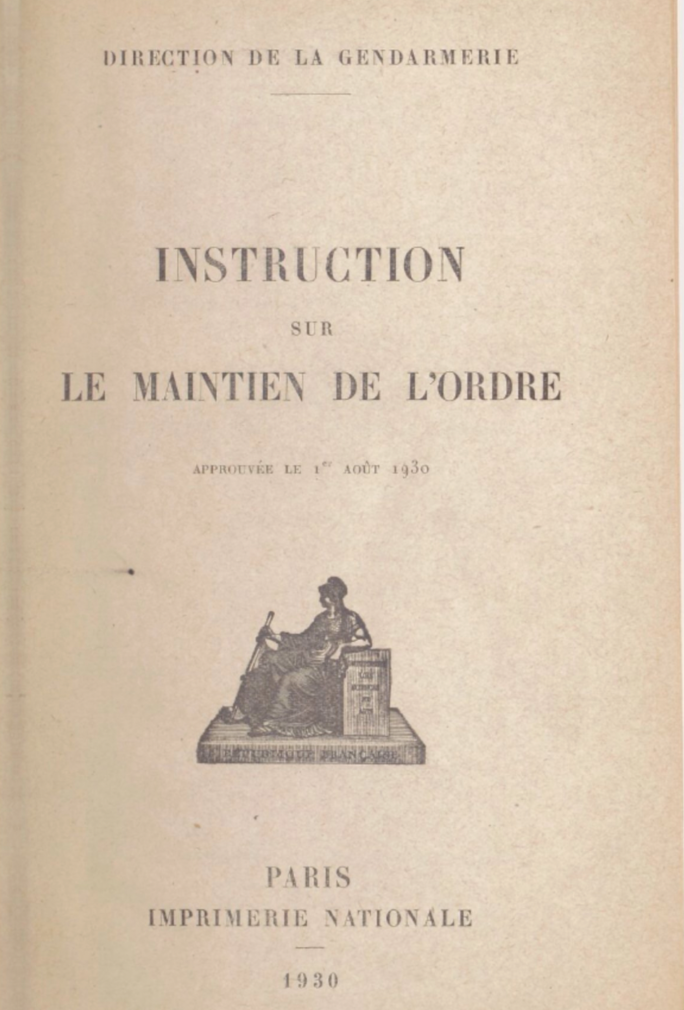
Agrandissement : Illustration 2
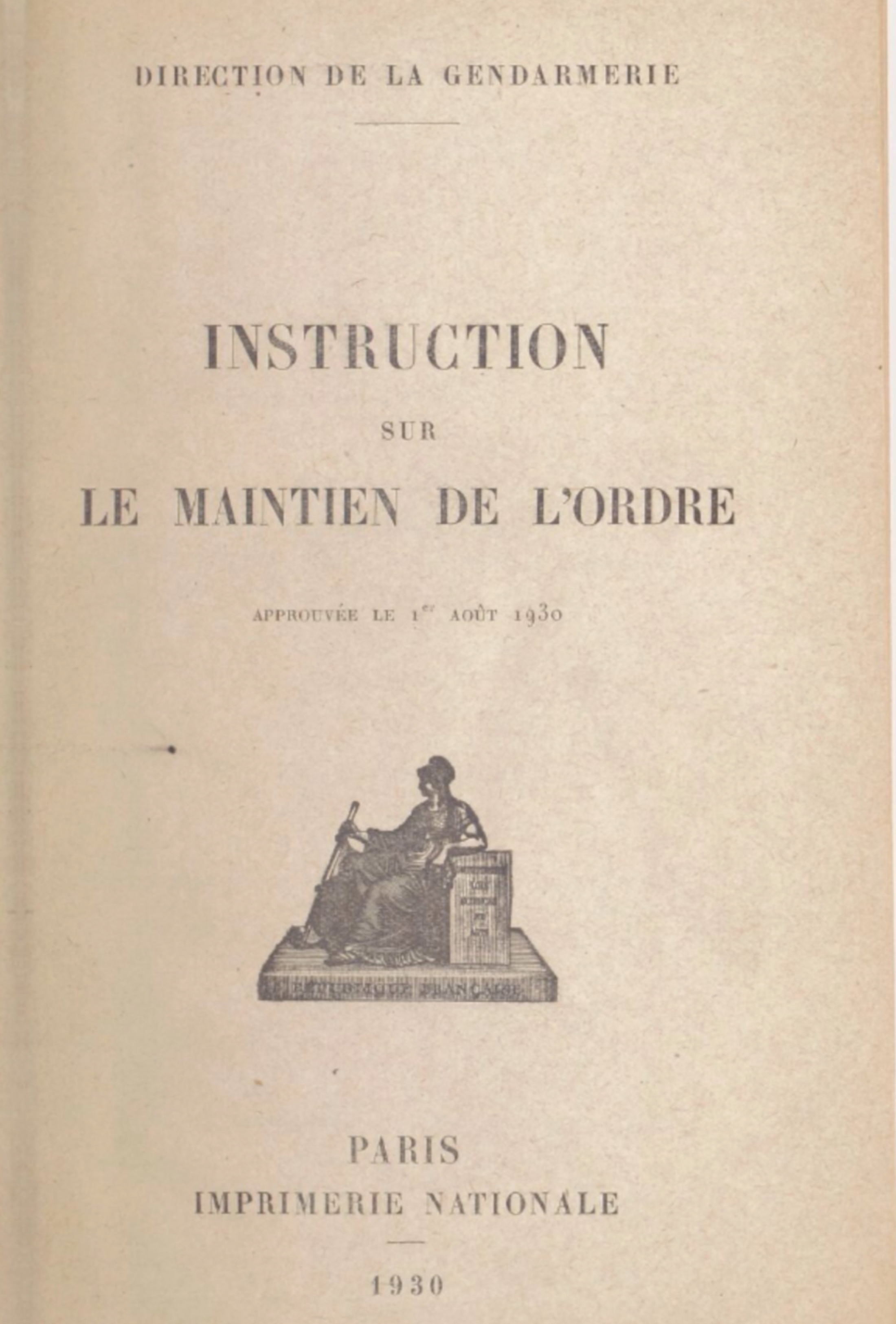
Ce vide de codification explique le fait que le SNMO, schéma national du maintien de l'ordre, a été élaboré après la crise des gilets jaunes. Publié en décembre 200.
Mais, sans véritable consultation élargie de la société civile, des médecins ou d'autres ONG, certes il affirme à nouveau les droits de l'Homme comme préalable, mais sans les intégrer aux pratiques de manière précise. Les principes affichés "Principe 3: l'exigence renouvelée de professionnalisation des unités du maintien de l'ordre", "Principe 4: le développement de l'information vers le public" , "Principe 5: la meilleure prise en compte de la présence des journalistes", ou encore "Principe 6: la nécessite permanente d'une capacité d'interpellation ciblée" n'ont pas été appliqué de manière homogène. Les témoignages du faible professionnalisme et de la violation de ces principes sont nombreux. Journalistes menacés ou frappés en dépit de leur brassard, insuffisante information du public dans un brouhaha rendant inaudibles les sommations (pour peu qu'elles aient eu lieu). Plusieurs mesures d'humiliation collective on été filmées.
Ce qu'on appelle la judiciarisation (rechercher les responsabilités individuelles), censée être guidée par le "Principe 8: l'adaptation de la judiciarisation dans la prise en compte des fauteurs de troubles" a été dirigée par d'autres impératifs. Ainsi, 292 interpellations suivant la préfecture de police de Paris mais 283 sortent totalement libres. Des interviews réalisés par BFM auprès des personnes "libérées" confirment en effet que ces manifestants arrêtés au même moment l'ont été avec des motifs imaginaires et différents.
Dans la même logique, la journaliste de Le Media a été libérée sans poursuite, après tout de même près de 40 heures de garde-à-vue (ce qui suppose qu'un a procureur a accordé une prolongation de garde à vue). Ces arrestations massives relèvent plus d'un politique policière d’intimidation que de maintien de l’ordre dans un cadre légal et suivant les principes annoncés.
La faible responsabilité des agents vis-à-vis de leurs actes (illustrée par le fait que la hiérarchie de la police ne fait pas porter le RIO aux agents de manière systématique, et qu'il est trop petit pour être lu la nuit et de loin...), et des contrôleurs (voir la réticence des procureurs à le faire pour les violences, et les décisions d'autorisations de GAV ne débouchant pas sur un déferrement), les instructions ministérielles de faire des interpellations dans des volumes importants (car sinon comment comprendre ces nombres élevés ?), combinée à la présence d'armes multiples (chimiques avec les gaz, « moins mortelles » avec les LBD et grenades explosives à effet de souffle) contrairement aux démocraties approfondies, explique la mauvaise police de gestion des foules en France.
Ces pratiques ont des conséquences immédiates de mécontentement et de frustrations, mais chez les jeunes, elles ont des effets durables : exposés à des pratiques arbitraires et violentes, ils croient moins dans les principes démocratiques, et tendent à se détourner de l'idée qu'ils appartiennent à la nation française, comme je l'ai détaillé dans La Nation inachevée. la jeunesse face à la police et l'école (Grasset). Ces effets de long terme ne doivent pas être négligés : ils alimentent une crise démocratique, certes plus large et plus profonde. De gardiens des institutions, la police, mal dirigée et mal pratiquée, se mue en force qui en sape les fondements.
Le maintien de l'ordre à la française, c'est en somme trop de politique, et pas assez de loi.



