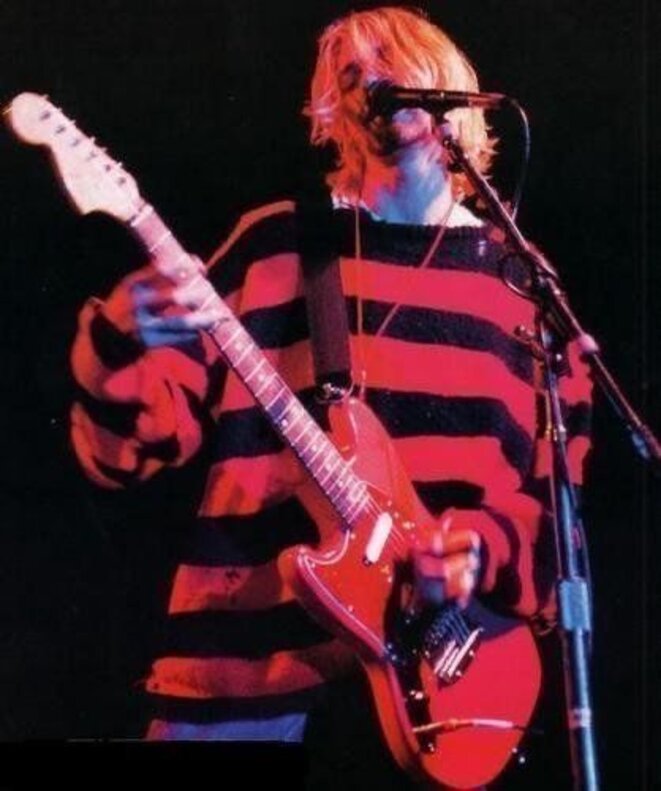Avant tout Qu'est-ce que le suicide ? Par définition, le suicide est "un acte de se donner volontairement la mort." ou encore d'agir en faveur d'une autodestruction. Il est tres present dans la litterature, comme le theatre ou les romans, où le héros meurt dans une fin tragique, comme Roméo et Juliette, J'irais cracher sur vos tombes, Juste la fin du monde, Madame Bovary, Therese Raquin, Antigone, Phedre, et bien plus encore... et dans la philosophie. Nous avons pu approfondir la question des raisons, des types, et différentes opinions se sont esquissées alors la question se pose : le suicide pourrait-il être une forme d’émancipation ou une condamnation ?
Oui, pour le philosophe stoïcien "Sénèque", le suicide peut être libérateur et émancipateur. C'est en particulier dans ses "Lettres à Lucilius" qu'il aborde le sujet, notamment sur la mort volontaire. On peut y lire : "C’est la marque d’un grand homme que de choisir sa mort, et de s’en faire un destin." Par là, on peut comprendre que l'individu ne subit pas la mort mais la choisit. Il le considère comme un acte digne car il reste maître de lui-même tout au long de sa vie, jusqu'au choix de se donner la mort, d'où l'appellation "grand Homme". Le suicide serait un choix serein et non pas une réaction impulsive pour le considérer libérateur. Effectivement, nous pouvons faire le choix de nous suicider par impulsion, mais d’après Sénèque nous serions alors soumis à nos passions, et ce serait une fuite d'une souffrance que l'on n'arrive pas à surmonter. Pour expliquer les deux situations, nous prendrons deux exemples : nous les analyserons à travers la pensée de Sénèque : Sisyphe, dans le mythe de Sisyphe, est un mythe "absurde", sa vie n'a pas de sens, c'est un homme condamné par les dieux à rouler un rocher jusqu'en haut d'une montagne. Il devra reproduire cette tâche sans fin, à l'infini. La réalité est que la vie de Sisyphe est dépourvue de sens, c'est une existence absurde. En tant qu'homme sage, s'il avait poussé sa réflexion, Sisyphe aurait pu penser à se donner la mort, une mort libératrice, non pas de la souffrance et de la difficulté à reproduire cet acte à l'infini, mais libératrice de l'existence absurde. Sa liberté serait de fuir l'humiliation et l'absurde à travers un destin qu'il se créera : la mort par le suicide. Or, si nous prenons l'exemple du personnage de Sayori dans le jeu vidéo Doki Doki Literature Club, elle se serait suicidée à cause de sa dépression, qui serait une vision émotionnelle et non pas rationnelle, un suicide "non réfléchi" mais soumis aux émotions de Sayori, donc impulsif, et donc un suicide non pas émancipateur mais condamnant son existence par une "fin tragique".
Le suicide serait alors libérateur mais en rassemblant des conditions "sages" comme le refus de l'absurdité de la vie. Cependant, la vie est en elle-même absurde, car elle est dépourvue d'objectif clair. C'est à l'homme de s'en donner pour fuir la question de l'utilité de ses objectifs et du sens réel de son existence en dehors des distractions qu'il se donne.
Mais l'absurdité nous laisse-t-elle le droit de recourir à la mort ? Le suicide, c'est renier sa propre existence, c'est un rejet de sa vie, tourner le dos au poids de l'existence, mais se suicider est-ce vraiment une libération de ce poids ? Telle est la question fondamentale de la philosophie selon Albert Camus. D'après lui, il faut rejeter non pas la vie, mais le suicide. De manière "claire", la vie en elle-même est absurde, elle n'a aucun sens. Il y a, comme Camus le remarquera, un décalage entre notre quête de sens et l'absurdité de la vie. Si la vie n'a pas de sens, alors à quoi bon continuer ? Si l'univers tout entier n'a aucun but, si chaque acte quotidien est dépourvu de sens, à quoi cela pourrait-il bien servir ?
Pour les croyants, on pourrait dire que la vie est plus simple, d'une manière simpliste, car pour les trois religions monothéistes principales, si les croyants "travaillent leur foi" et se soumettent à l'autorité d'un dieu tout-puissant, ils espèrent en retour être épargnés de l'enfer et se retrouver au paradis. La vie n'est pas absurde pour eux, car le sens donné par les religions est le suivant : servir Dieu, l'adorer, et répandre l'amour et la paix. On pourrait se demander aussi si les religions ne sont pas juste une création de l'homme pour se donner un but et échapper à ses angoisses existentialistes. Ces questionnements peuvent intervenir dans le domaine du suicide, car le suicide, dans les trois religions, est condamné, et bien souvent les défunts qui ont eu recours au suicide n'ont même pas le droit à des funérailles "religieuses". Mais l'homme n'aurait pas alors juste inventé les religions pour se distraire du non-sens de la vie, il aurait aussi, en suivant cette logique, créé toutes sortes d'autres distractions telles que l'art, le sport, etc.
Mais nous pouvons aussi nous demander : est-ce que l'absurdité tue réellement ? D'un côté, Camus appelle à la révolte, en nous disant qu'il faut imaginer "Sisyphe heureux" dans son essai Le mythe de Sisyphe. Comment pourrait-on imaginer Sisyphe heureux ? Tout est dans la révolte de Camus. La révolte, c'est dire non à la mort et à la souffrance de l'absurde, mais plutôt aller vers l'acceptation. L'acceptation, mais pas seulement : il faut surmonter l'absurde et se donner soi-même un sens, une quête, un but. Il ne faut pas s'arrêter de vivre à cause d'une crise existentielle... Il faut continuer de tout ressentir, d'être heureux, de tomber amoureux, et tout simplement de vivre sa vie.
Refuser le suicide philosophique par la volonté de vivre. On peut l'aimer et en jouir sans chercher de sens plus profond et supérieur. C'est une volonté lucide et non pas une résignation. C'est plutôt l'acceptation qu'il n'y ait pas toujours de réponse à ses questionnements.
Comme dernière interrogation, on pourrait se poser la question de l'individualité du suicide. Est-ce un fait uniquement personnel ? Émile Durkheim répondrait que non, que c'est un fait social, donc que les causes d'un suicide viennent de la société. Durkheim, avec son essai Le Suicide, est un incontournable sur ce sujet. Il attire l'attention sur les chiffres et les tendances des différents groupes sociaux par rapport aux suicides et bouleverse les théories basées uniquement sur la biologie et la psycho.
Il classe les suicides en 4 groupes : Le suicide égoïste, qui concerne les individus "exclus" de la société ; le suicide altruiste, quand la personne pense aux autres plus qu'à elle-même, comme un soldat qui se "sacrifie" pour la patrie par exemple ; puis le suicide fataliste, quand la société étouffe l'être, par exemple les esclaves qui se suicident ; et enfin le suicide anomique, quand la régulation sociale s'effondre, une sorte de crise existentielle quand on vit un changement trop brutal. Alors pour ce sociologue theoricien du lien entre le suicide et la société, il dirait probablement que le suicide ni ne libere ni ne condamne mais temoigne seulement d’un desequilibre dans le lien social et revele un symptome d’un mal etre de la societé.
Les suicides témoignent effectivement d’un mal-être profond et d’une fracture de l’être en société. Les tendances varient en fonction de l’environnement des différents individus et de leur “force mentale”. On ne peut pas dire que l’acte en lui-même est une condamnation car il permet de libérer certains individus de leurs souffrances et du poids de l’existence. À l’échelle individuelle on pourrait trouver cela “inoffensif” sans réellement réfléchir à l’impact sur l’entourage de la personne, mais il faut voir cela d’une manière plus large à l’échelle de la société. S’il y a un individu qui prend la décision de se donner la mort, il faut remettre en question l’environnement social et toutes les raisons qui l’y ont conduit. Et surtout que la société connaît en ce moment de nombreuses régressions autant au niveau démocratique, qu’économique ou encore de récession (backlash) au niveau des différentes égalités entre les sexes et droits LGBT, on pourrait s’attendre à une légère augmentation de suicides pour les prochaines années, par peur des autres et la fracture interne que l’on connaît, ou encore des avancées technologiques, la peur des robots, et bien d’autres angoisses.
Mais même si on passe au nihilisme et au pessimisme, que l'on ne voit plus d'espoir en l’humain, en ouvrant les yeux sur le fait qu'il n'y aura jamais la fin de la famine dans le monde ou d’être enfin réellement tous égaux ou d'autres principes de ce genre, la vie vaut d'être vécue. S'il y a un objectif qui s'écroule, il faut un plan B, et ainsi de suite. Il y a trop de raisons de survivre et de vouloir continuer. Si un espoir s’évanouit ou que des problèmes personnels prennent le dessus, il faut se dire que tout est passager. Il y a mille autres choses à expérimenter, à connaître, à sentir, à vivre, tellement de choses devant lesquelles être heureux, tant d'autres à aimer et bien plus encore ! Le suicide est envisageable mais n'est rien comparé à la liberté que nous laisse la vie et à la diversité des choix qu'elle propose. Le suicide restera toujours une option, même si le geste en lui-même reste très dur à accomplir. C'est la peur de la mort et des autres qu'il faut parvenir à rejeter, et non pas se poser la question de l'émancipation ou non que nous procure le suicide, pour enfin être réellement libre..