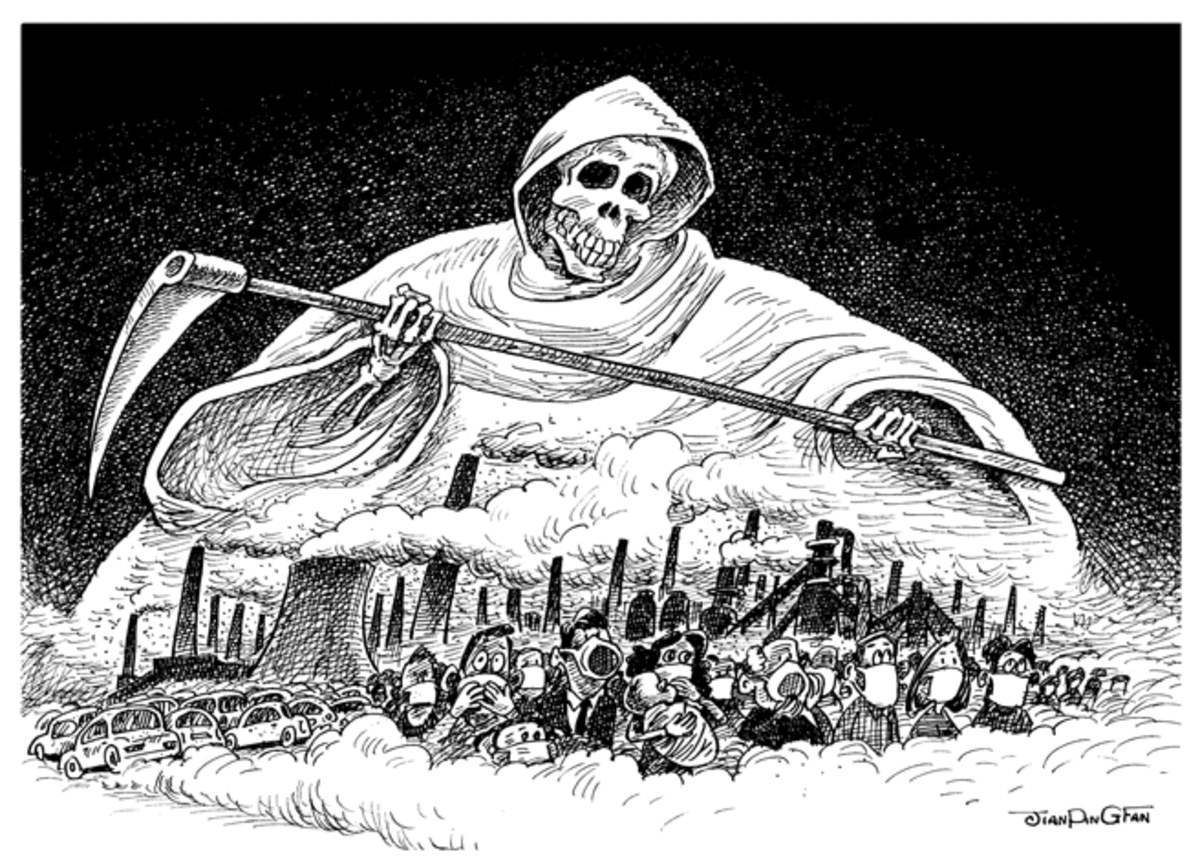
Agrandissement : Illustration 1

(PAR AUTEUR : NOM CONNU DE LA REDACTON DE L’1DEX MAG)
Monsieur le Conseiller d’Etat,
Depuis que la Confédération a tiré la sonnette d’alarme en 2011, en découvrant des sols pollués au mercure dans le Haut-Valais, une avalanche de questions, de peurs, d’appréhensions ont traversé l’esprit des citoyennes et citoyens valaisans. Durant ces six dernières années, des dizaines d’interventions parlementaires ont questionné le Gouvernement, afin d’obtenir des éclaircissements sur le passé industriel. Les journalistes à leur tour ont retourné le malade dans tous les sens. Malgré cette énergie déployée, certaines interrogations restent sans réponse.
D’ou vient le mercure valaisan? Qui est l’autorité de surveillance des rejets industriels? Avait-on le droit de faire ces rejets à l’époque? Quelle est l’importance de cette pollution? Jusqu’à quelle époque cette pollution s’est-t-elle répandue? L’Etat était-il au courant? A-t-il manqué à son devoir de protection du citoyen? Pourquoi la pollution au mercure n’est-elle pas inscrite dans le cadastre des sites pollués? Qui va payer l’assainissement?
Début 2017, Maître Fanti, préposé à la protection des données du Valais, découvre un rapport qui répondrait à ces questions. Sa non-publication met le feu aux poudres: ce rapport, une simple investigation historique, ne pourrait pas être publié car il mettrait en péril l’anonymat de certaines personnes dans ce dossier. Une boîte de Pandore?
En l’absence de ces précieuses indications – que Maître Fanti obtiendra peut-être – nous allons tout de même ausculter le malade, et en dresser l’anamnèse la plus complète possible. Nous allons essayer de reconstituer ce puzzle, dont les pièces sont éparpillées un peu partout, et que personne, jusque-là, n’a tenté de rassembler, si ce n’est, peut-être, les auteurs de ce rapport secret. Nous allons tenter, par devoir civique, de répondre aux questions que peuvent et doivent se poser les citoyennes et citoyens de ce canton.
En premier lieu, il convient de s’interroger sur l’origine du mercure valaisan
Le mercure est un métal lourd, liquide à température ambiante. Son utilisation est sévèrement réglementée, voire interdite. Le mercure a longtemps été utilisé dans les thermomètres et les amalgames dentaires. Lonza AG s’est servie de grandes quantités de mercure comme catalyseur lors de la production de substances telles que l’acétaldéhyde, le chlorure de vinyle et le chlore gazeux. CIMO, à Monthey a également longtemps utilisé du mercure.
Selon Jean-Luc Loizeau, chargé de cours et de recherche depuis 1999 à l’institut Forel de l’Université de Genève et limnogéologue, il y a eu une augmentation des concentrations de mercure dans le lac Léman, et ce à partir du XXe siècle. Ainsi, on dénombre deux pollutions importantes dans le lac Léman: plusieurs dizaines de tonnes se sont déposées dans les années 1945-1950, et trois en 1971. Les sources sont probablement le site chimique de Viège et le site chimique de Monthey. Les deux entreprises impliquées semblent donc être Lonza et CIMO.
Récemment, des investigations effectuées dans le cadre de la construction de l’autoroute A9 ont mis en évidence une pollution par le mercure de divers sols dans la plaine du Rhône, entre Viège et Nidergesteln. Cette pollution trouve son «origine» dans l’épandage, à partir des années 1930, de boues et sédiments contaminés du Grossgrundkanal[1]. Or, sachant que Lonza affirme en 2014 avoir déversé 50 tonnes de mercure dans le Grossgrundkanal, et que, sans le savoir et surtout sans en connaître les conséquences, les paysans ont dragué les terres de ce canal pour fertiliser leurs champs, il ne semble dès lors pas très difficile d’établir l’origine du mercure dans ce dossier.
En effet, dans une interview accordée à la RTS le 21 février 2014, Lonza affirme avoir acheté 350 tonnes de mercure entre 1939 et 1973. Sur ces 350 tonnes, une cinquantaine de tonnes environ ont été déversées dans le Grossgrundkanal. La même quantité se serait évaporée dans l’atmosphère. Enfin, 71 tonnes se sont retrouvées sur le site Lonza, 112 tonnes ont été déposées dans des décharges en Valais ou à l’étranger et 40 tonnes ont été recyclées et vendues par Lonza. Restent encore 27 tonnes dont l’entreprise ignore ce qu’elles sont devenues.
Maintenant que nous connaissons l’origine du mercure, il convient de s’interroger sur cette pratique des usines de jeter du mercure dans les eaux: était-ce autorisé ou non?
A partir de 1972, la loi sur la protection des eaux est restrictive et possède un caractère punitif. Avant cette période, il existe un flou juridique qui empêche de se déterminer clairement si oui ou non la loi est restrictive.
La loi sur la pêche, édictée en 1888, marque la première étape de la protection des eaux. En 1953, un arrêté fédéral introduit dans la Constitution la protection des eaux contre la pollution et en 1957, la première loi fédérale entre en vigueur.
En 1972, la loi évolue et devient plus restrictive. En outre, la loi contient désormais un certain nombre de normes de comportement clairement définies qui, sous la forme d’obligations et d’interdictions, concernent tout un chacun. Celui qui contrevient à ces dispositions peut encourir des peines relativement sévères: s’il a agi intentionnellement, il pourra être puni de l’emprisonnement jusqu’à trois ans (art. 37). De plus, la loi prévoit à l’article 36 que toute altération des eaux engage la responsabilité non seulement civile, mais également causale de l’auteur de la pollution, indépendamment de la faute qu’il a commise.
En 1976 interviendra l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le déversement des eaux usées, outil de lutte contre la pollution des eaux. En 1984, l’intitative populaire pour la sauvegarde de nos eaux est lancée. La Loi sur les Eaux va alors naître et entrer en vigueur en 1992. En 1998, enfin, une nouvelle ordonnance sur la protection des eaux entre en vigueur, laquelle donnera réellement des outils concrets aux cantons pour protéger les cours d’eau.
Il semblerait donc que jusqu’en 1972, le Canton ne possédait que très peu d’outils pour protéger l’environnement et que ce n’est qu’après cette date qu’il pouvait réellement agir. Lonza ayant déversé son mercure dans le Grossgrundkanal jusqu’en 1973, il semblerait donc que l’entreprise chimique ait respecté la loi jusqu’à cette date. Il reste pourtant une inconnue: où sont donc les 27 tonnes de mercure dont Lonza a perdu la trace?
Monsieur le Conseiller d’Etat, je vous propose ici l’explication de l’usage qui a été fait des 27 tonnes restantes, grâce à une discussion avec un éminent chimiste, lequel a eu la chance ou la malchance de voir se dérouler ces événements sous ses yeux, et la bonté de m’éclairer
Dès 1995, un entrepreneur privé proposa à Lonza, par l’intermédiaire du sous-directeur de Lonza de l’époque, de traiter les déchets de la déconstruction partielle du site de l’usine Lonza, contaminé avec de fortes concentrations en mercure, en créant pour ce faire une nouvelle entreprise, Bio-Dépollution SA. Cette activité s’étant révélée par la suite très dangereuse pour l’environnement, le sous-directeur de Lonza de l’époque a refusé que l’installation de traitement soit montée à Viège. D’entente avec le directeur de CIMO, cette dernière a vu finalement le jour sur le site chimique CIMO à Monthey, car ce site utilise aussi l’électrode au mercure pour produire du chlore et produit donc des déchets mercuriens.
Bio-Dépollution SA devait donc d’abord traiter les déchets au mercure de Lonza et, par la suite, si tout se passait bien, les déchets de CIMO. Le príncipe de traitement utilisait la chaleur pour évaporer le mercure et les gaz devaient être ainsi lavés. Malheureusement, cette usine n’a jamais fonctionné correctement.
Après quelques mois d’essais négatifs, et de pollution active des alentours, Bio-Dépollution SA a été déplacée à Yverdon, avec l’approbation du gouvernement vaudois.
L’usine d’Yverdon, à l’instar de celle de Monthey autrefois, a dysfonctionné et pollué le sol vaudois durant deux ans. Elle a finalement été fermée suite à la visite d’un expert, venu inspecter le site parce que les travailleurs de cette usine présentaient dans leurs urines des concentrations de mercure plusieurs fois supérieures à la normale. L’expert a pu également constater que tous les terrains situés aux alentours de l’usine étaient gravement pollués au mercure.
Bio-Dépollution SA a été mise en faillite. La justice vaudoise a condamné son directeur. Michel Pont, dans un article publié dans Le Temps, le 4 décembre 1998, révèle qu’une expertise a démontré que l’Etat de Vaud avait manqué de réactivité, car les liens intimes qu’il entretenait avec les gens de cette société l’ont empêché de réagir.
Quel lien avec le mercure valaisan, me direz-vous?
A cette époque, le sous-directeur de Lonza siégeait notamment au CREALP[2]. Il entretenait donc des liens privilégiés avec les sphères dirigeantes du canton du Valais, en particulier avec le Chef du Service de la protection de l’environnement valaisan.
Or c’est bien le sous-directeur de Lonza que Bio-Dépollution SA a contacté afin que Lonza utilise son installation pour éliminer le mercure. Et c’est bien suite à cela qu’une quantité importante de déchets mercuriels a été transportée depuis Viège jusqu’à Monthey, puis de Monthey à Yverdon. Ainsi, Lonza a participé à la pollution d’Yverdon et de ses alentours, et ceci en pleine connaissance de cause puisque les effets désastreux de la technique utilisée par Bio-Dépollution SA étaient connus. Ainsi la Lonza, a caché l’impact ignoble du mercure sur les travailleurs de l’usine et les habitants de la région.
Les 27 tonnes de mercure perdues par la Lonza seraient-t-elles parties chez Bio-Dépollution SA, et donc en territoire vaudois? Voilà une question qu’il faudrait poser à la Lonza.
Maintenant que nous avons une hypothèse pour les 27 tonnes restantes, il nous faut encore nous interroger sur le rôle de l’autorité de surveillance en charge de la protection de l’environnement
D’après l’Ordonnance sur les sites pollués, le Canton est l’autorité de surveillance et doit à travers le Service de la protection de l’environnement (SPE), exécuter la loi.
Pourtant, force est de constater que la pollution au mercure n’est pas inscrite dans le cadastre des sites pollués avant 2011. Le Service de la protection de l’environnement semble avoir oublié ce site lors de la création de ce cadastre.
Le cadastre des sites pollués est une carte disponible sur le site du Canton, laquelle situe les parcelles polluées. Elle permet ainsi au contribuable de connaître les zones polluées ou non. Le rôle du Canton et du SPE est donc de publier une carte complète pour informer correctement le citoyen: personne ne veut acheter un terrain qui est pollué pour construire sa maison.
Ce cadastre a été créé par le canton du Valais entre 2001 et 2003, et a coûté au contribuable la somme de 588’884 francs. Le canton du Valais étant un des cantons les plus industrialisés de Suisse, il possède donc un nombre considérable de sites pollués. L’obligation de créer ce cadastre découle de la publication de l’ordonnance sur les sites pollués (1998), mais ce cadastre ne contenait à l’époque aucune information sur la pollution au mercure dans le Haut-Valais avant que celle-ci ne soit découverte suite aux travaux de l’autoroute, réalisés par la Confédération en 2011.
On peut oublier un site, toutefois il est étonnant que le Canton “oublie” de signaler aux Valaisans une si importante pollution.
Une dernière question qu’il faut maintenant se poser, et vous poser, Monsieur le Conseiller d’Etat, c’est la question relative au porte-monnaie: qui va payer, des responsables ou les simples citoyens?
Pour les terrains assainis pendant les travaux de construction de l’autoroute, c’est le citoyen qui aura été sollicité sans seulement qu’il ne le sache. En effet, dans le cadre des travaux de l’A9, réalisés par l’Office de construction des routes nationales (OCRN) entre Viège et Niedergesteln, les coûts liés à l’excavation et l’élimination des terres polluées au mercure ont été financés par l’A9, c’est-à-dire en l’occurence par la Confédération et l’Etat du Valais. Plus de 13 millions de francs suisses, d’après l’estimation du SPE, datant de 2013, ont ainsi été dépensés.
La part de la Lonza, quant à elle, s’éléverait à plusieurs centaines de millions de francs. Mais à ce jour, aucune répartition claire n’a été rendue publique.
Monsieur le Conseiller d’Etat, je souhaiterais que les citoyennes et citoyens de notre canton puissent obtenir des réponses aux questions suivantes:
- Qu’est-il réellement advenu des 27 tonnes de mercure pour lesquelles Lonza à ce jour ne donne aucune explication, sans compter les 50 tonnes qui se seraient évanouies dans l’atmosphère?
- Pourquoi, alors que la Loi sur les Eaux semble avoir un effet restrictif depuis 1972 déjà, le canton du Valais semble n’avoir jamais empêché la pollution engendrée par l’activité de Lonza, qui a clairement pollué les sols valaisan et vaudois jusqu’à la fin des années 90, ainsi que le démontre l’affaire Bio-Dépollution SA?
- Pourquoi les sites pollués n’ont-ils pas immédiatement été inscrits au cadastre des sites pollués, créé en 2002, alors que l’ancien sous-directeur de Lonza siégeait dans des organes étatiques? Pourquoi ne l’ont-ils été qu’en 2011, année à partir de laquelle les travaux de l’A9 ont révélé au grand jour l’importance de la pollution au mercure?
- Pourquoi le canton du Valais, contrairement à l’Etat de Vaud, n’a-t-il jamais condamné les pollueurs, à savoir Lonza comme Bio-Dépollution SA ou CIMO, alors que la loi de 1972 donne à l’Etat le pouvoir et le devoir de punir tout pollueur? alors que l’on sait que Bio-Dépollution SA a pollué les sols valaisan et vaudois en tentant d’éliminer le mercure industriel de manière illégale, entre 1995 et 1997?
- L’Etat du Valais a-t-il protégé les intérêts de Lonza et de son ancien sous-directeur, clairement impliqué dans ce dossier?
- Pourquoi le grand public ne peut-il avoir accès au rapport qui traite de ce dossier? Est-ce l’ancien sous-directeur de Lonza dont on protège l’anonymat? ou est-ce plutôt la ramification qui le relie à l’origine de la pollution et à l’Etat du Valais qu’on cherche à cacher?
- Qui va prendre en charge les dommages subis par les Hauts-Valaisans qui ont cultivé leurs patates dans des champs pollués et ont ainsi ingéré sans le savoir des quantités importantes de mercure? Qui va prendre en charge la perte subie par les Hauts-Valaisans dont le terrain sur lequel ils ont construit leur maison est désormais enregistré au cadastre des sites pollués, ce qui les dévalue fortement et engendre ainsi une perte financière importante?
Qui va payer, Monsieur le Conseiller d’Etat? Qui va payer sur le plan juridique? Qui va payer sur le plan financier, et selon quelle répartition?
Dans l’attente d’une réponse claire à toutes ces questions durant votre mandat, dans l’espoir que vous réaliserez l’importance de faire la lumière sur un dossier que l’on ne peut enfouir plus longtemps, je vous présente, Monsieur le Conseiller d’Etat, mes salutations les meilleures.
[1] Le Grossgrundkanal est un canal qui s’écoule à proximité du site chimique de Lonza, utilisé à l’époque comme exutoire pour les eaux usées. Il se jette dans le Rhône.
[2] Centre de recherche pour l’environnement alpin, fondé par l’Etat du Valais et la Ville de Sion.
Première parution : 1dex.ch



