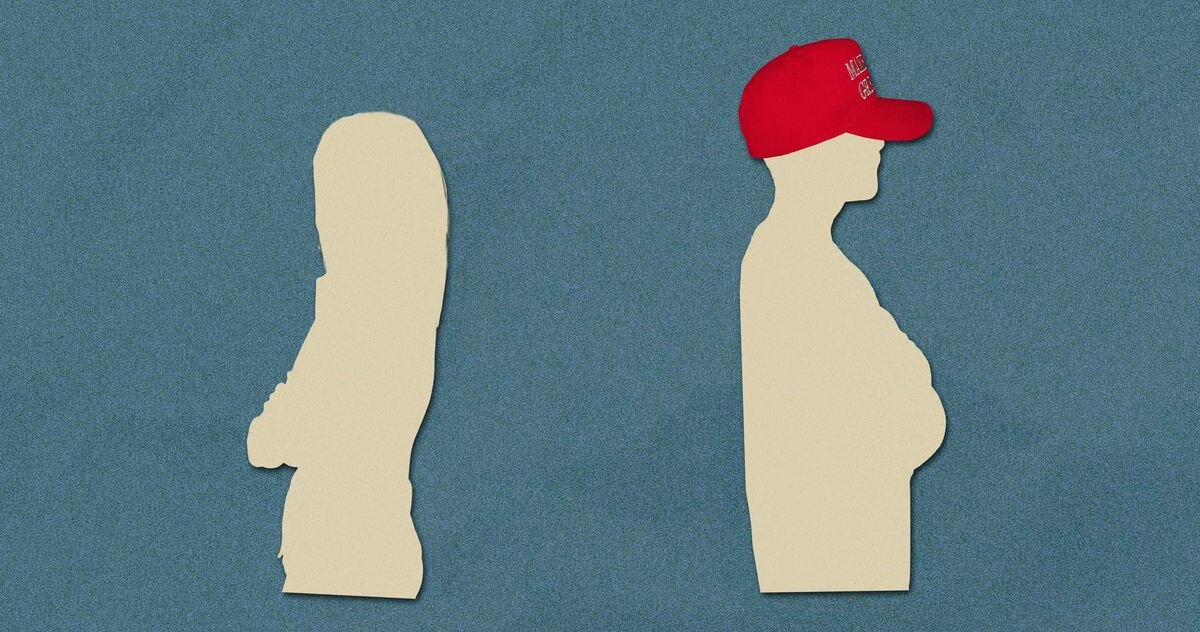
Agrandissement : Illustration 1
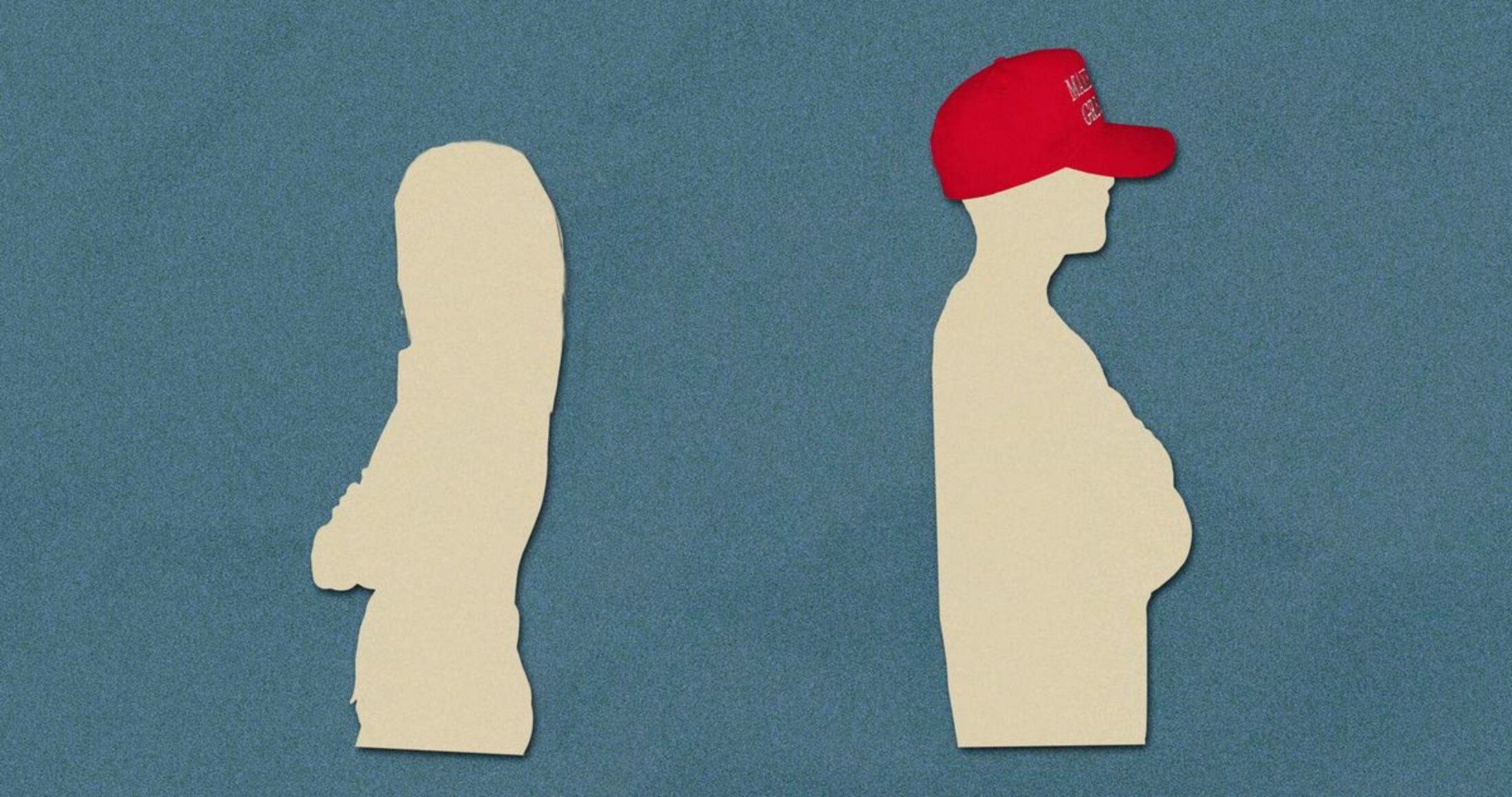
Depuis la fin des années 60, des associations et collectifs du milieu radical masculiniste des “pères enragés” (lié aux traditionalistes) ont structuré une action politique autour d’un objectif précis : imposer la résidence alternée de l'enfant comme principe législatif automatique, applicable dès qu’un parent en instance de séparation en fait la demande, quel que soit le contexte relationnel, conflictuel ou judiciaire.
Chaque année ou presque, des propositions de loi reprenant cette revendication sont déposées, souvent portées par des élus centristes, séduits par un langage dépolitisant et faussement égalitaire. Ces projets sont systématiquement critiqués par les instances consultatives, les magistrats et les associations de défense des droits des femmes et de l’enfance, car ils vont à l’encontre du principe d’égalité réelle. Loin d’assurer une coparentalité harmonieuse, ils risquent d’aggraver la précarité des mères, de renforcer les mécanismes de contrôle post-séparation, et de mettre en danger les enfants exposés à des contextes de violences familiales.
Ce lobbying intensif fait auprès des élu.e.s peut être analysée à l’aune du concept de « guerre des normes » (normfare), tel que défini par Amélie Férey, politiste et chercheuse française spécialisée dans l’analyse des mécanismes d’influence :
« l’ensemble des actions non violentes menées par un acteur pour imposer sa propre norme en discréditant celle de son adversaire, par un usage stratégique du droit, des émotions ou du langage, dans une logique de captation morale. »
Les mobilisations pour les « droits des pères » relèvent de ce registre : elles utilisent un vocabulaire emprunté aux luttes féministes (égalité, coparentalité, droits de l’enfant), pour disqualifier les peu, et récentes, normes protectrices (prise en compte des violences en cas de séparation) et les faire passer pour discriminatoires à l’égard des pères. Ce faisant, elles participent à une forme de contre-offensive normative antiféministe, cherchant à déplacer le curseur du droit vers une stricte égalité d'accès à l'enfant, sans considération pour les rapports de pouvoir, les inégalités matérielles ou les risques concrets.
Les travaux d’Ariane Fillod-Chabaud, Édouard Leport et Gwenola Sueur, entre autres, montrent que ce recours au langage égalitaire est à la fois stratégique et dépolitisant. Il vise à réintroduire une domination masculine sous couvert d’un rééquilibrage symbolique, en invisibilisant les réalités de la précarité, de la violence conjugale, ou du travail éducatif non partagé.
Pourtant, les données sociales sont claires : selon l’INSEE, 35 % des enfants vivant en famille monoparentale, très majoritairement avec leur mère, vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % en moyenne. Ce taux monte à 45 % lorsque la mère est sans emploi stable. Dans ces conditions, l’imposition d’une résidence alternée automatique constituerait une contrainte judiciaire et logistique supplémentaire pour les femmes les plus vulnérables, sans améliorer la situation des enfants. Elle répond à une logique de rétablissement du pouvoir paternel plutôt qu’à une préoccupation réelle pour le bien-être de l’enfant.
1. Des justifications fallacieuse, parfois puisées chez les christofascistes US.
Ce qui suit est une analyse critique de l’Exposé des motifs accompagnant le dernier projet de loi visant à instaurer une résidence alternée imposée en cas de désaccord entre parents sur la résidence des enfants.
En droit français, l’Exposé des motifs sert à présenter « de manière simple et concise les raisons pour lesquelles le texte est proposé, l’esprit dont il procède, les objectifs qu’il se fixe et les modifications qu’il apporte au droit existant ». Il constitue un élément des travaux préparatoires auquel le juge peut se référer pour éclairer l’intention du législateur. À ce titre, il est censé fournir une base factuelle rigoureuse.
Or, dans le cas de ce projet de loi, l’exposé des motifs s’éloigne radicalement de cette exigence de rigueur. Il accumule affirmations vagues, chiffres décontextualisés, et omissions graves — notamment en ce qui concerne les violences conjugales, la précarité maternelle et les inégalités structurelles après séparation. Ce texte constitue un cas emblématique de désinformation genrée, où l’usage stratégique de l’égalité sert à légitimer une offensive normative portée par des réseaux masculinistes radicaux, bien identifiés, visant à renforcer la domination masculine dans l’espace post-conjugal.
Fact-check : "En 2016, seulement 12 % des enfants de parents séparés vivaient en résidence alternée, contre une majorité de 76 % résidant exclusivement chez leur mère."
Ces données sont issues de l’INSEE (2020, sur données 2016), alors qu'un jeu de données plus récent (2023), placent le nombre d'enfants en résidence alternée à 14%. Les 73% concernent les enfants résidants chez l'un des parents, pères et mères confondus. Hormis ces imprécisions stratégiques, ces chiffres ne permettent pas de conclure à une injustice ou à une préférence arbitraire des juges pour les mères. En réalité, l’INSEE explique que cette répartition résulte d’accords parentaux dans la majorité des cas, et que la résidence alternée est plus fréquente dans les foyers aisés, urbains et diplômés. Le choix de la résidence principale chez la mère peut aussi s’expliquer par l’éloignement géographique du père, son désengagement, ou des violences passées.
Ce que ce type de présentation omet totalement, c’est de citer les rapports faisant état de la fixation de la résidence des enfants par un.e juge. Une vaste étude, datant de 2013 et demandée par les associations des pères enragées elles-mêmes, souligne que les décisions judiciaires refusant la résidence alternée à un père qui la demande sont ultra-minoritaires. Dans seulement 2,6 % de l’ensemble des séparations, la résidence alternée est demandée par le père, refusée par la justice, et la résidence est fixée chez la mère contre la demande paternelle.
Enfin, une partie non négligeable des situations de résidence exclusive chez la mère ne découle pas d’un désaccord parental, mais de l’absence d’implication du père dans la procédure. Le rapport du ministère de la Justice de 2013 montre que dans environ 8 % des séparations, le père ne comparaît pas à l’audience, ne fait aucune proposition de résidence et ne présente pas d’observations.
Il n’y a donc pas de discrimination d’ordre systémique à l’égard des pères.
Fact-check: “Les chiffres sont édifiants : 85 % des détenus et 63 % des mineurs suicidaires ont été privés d’un parent dans leur enfance ; 90 % des sans‑abri ont grandi sans père”
Ce qui est surtout édifiant, est le fait que des élu.e.s ont signé une proposition de loi qui mobilise des statistiques, non-sourcées, et copiés collées depuis des sites christofascistes américains pour justifier un changement législatif en France. Car, ces chiffres apparaissent principalement dans des publications nord-américaines conservatrices ou religieuses, notamment la Heritage Foundation (exemple ici), Think Tank nationaliste chrétien au coeur de la politique trumpienne, ou encore de sites comme All Pro Dad et la National Fatherhood Initiative. On y lit, sans méthodologie explicite : « 90 % of all homeless and runaway children are from fatherless homes, 85 % of all children who exhibit behavioral disorders come from fatherless homes, 63 % of youth suicides are from fatherless homes… »
Le fait qu'exactement les mêmes chiffres, fictifs, promus par l'extrême-droite trumpiste se retrouvent mobilisées dans l’exposé des motifs d’une proposition de loi française démontre le caractère transnationale de l'assaut masculiniste des milieux radicaux dit des pères enragés.
En France, aucune étude scientifique ne permet de confirmer ces données. Les facteurs expliquant la détention, les conduites suicidaires des mineurs ou le sans-abrisme sont bien plus complexes, et relèvent de facteurs sociaux et structurels multiples. Concernant la détention, les études pénitentiaires montrent que de nombreux détenus ont connu une enfance marquée par des ruptures affectives, des violences, la pauvreté ou des placements, mais l’absence du père n’est jamais isolée comme facteur explicatif unique. De même, les recherches sur le suicide chez les jeunes (INED, DREES) soulignent l’importance des troubles psychiques, du harcèlement, des violences sexuelles, de l’isolement ou des inégalités sociales, sans établir de lien systématique avec la structure familiale.
Par ailleurs, l’enquête INSEE-DREES de 2012 sur les sans-domicile montre que les parcours sont souvent liés à des ruptures institutionnelles, des sorties de placement, des violences subies, des troubles de santé mentale ou des échecs économiques répétés. Là encore, aucune donnée ne permet d'affirmer que l'absence du père serait en soi une cause déterminante, ni même un facteur prépondérant.
Ce type d’argumentaire repose sur un biais de confirmation idéologique : il utilise des chiffres spectaculaires pour suggérer un lien de causalité mécanique entre monoparentalité maternelle et pathologies sociales, sans tenir compte des conditions socio-économiques, du rôle de l'État, du sexisme, ou des inégalités structurelles. En France, 35 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté — non pas parce qu’ils n’ont pas de père, mais parce que leurs mères assument seules l’éducation, souvent avec des ressources insuffisantes, entre autres à cause du non-partage, à taux d’effort égal, des charges liées à l’entretien et l’éducation des enfants.
En réalité, ces chiffres servent avant tout à culpabiliser les mères, à délégitimer la monoparentalité des femmes et à occulter les responsabilités concrètes de nombreux pères absents ou désengagés. Ils sont l’instrument d’une rhétorique de la restauration patriarcale, qui présente l’égalité parentale comme un impératif moral, tout en refusant d’analyser les asymétries concrètes qui pèsent sur les trajectoires des familles après séparation.
Fact-check: “les enfants de familles monoparentales présentent un taux de redoublement de 24 %, contre 9 % pour ceux en résidence alternée”
L’affirmation selon laquelle les enfants de familles monoparentales présenteraient un taux de redoublement de 24 %, contre 9 % pour ceux en résidence alternée, circule dans certains discours pro-résidence alternée, mais ne repose sur aucune étude officielle clairement identifiée. S’il est vrai que des écarts de réussite scolaire existent selon les configurations familiales, les enquêtes de l’INED et de l’INSEE montrent que ces différences s’expliquent en grande partie par les inégalités sociales et non par le seul mode de garde.
Les enfants en résidence alternée sont plus souvent issus de familles aisées, diplômées, géographiquement proches, avec des parents en emploi stable et capables de coopération post-séparation — autant de facteurs protecteurs pour la scolarité. À l’inverse, la monoparentalité est fréquemment liée à une précarité économique accrue et à une charge éducative déséquilibrée, en particulier pour les mères. Il est donc erroné et réducteur de conclure que la résidence alternée garantirait la réussite scolaire : elle est surtout le reflet de conditions déjà favorables, et non leur cause.
Fact-check: “Les enfants privés d’un parent sont exposés à 11 fois plus d’actes de violence scolaire.”
L’affirmation selon laquelle « on constate 11 fois plus d’actes de violence chez les enfants élevés en l’absence d’un des deux parents » apparaît pour la première fois dans l’exposé des motifs de la Proposition de loi n° 478 (16ᵉ législature) de 2022 à l’Assemblée nationale, puis reprise dans la Proposition de loi n° 819 en 2025, sans référence à une source précise dans les textes législatifs.
Cette affirmation ne repose sur aucune étude scientifique identifiable, ni dans la littérature académique, ni dans les rapports institutionnels français ou internationaux. Elle ne figure dans aucune source méthodologiquement validée.
Tout indique qu’elle a été introduite directement dans l’argumentaire de certaines propositions de loi récentes, puis relayée dans des discours militants ou politiques, sans aucune vérification ni référence vérifiable.
Il s’agit là d’un exemple classique de statistique choc sans fondement empirique, mobilisée pour frapper les esprits et orienter le débat public, au détriment de la rigueur factuelle. Ce type d’argument contribue à alimenter une rhétorique émotionnelle plutôt qu’à éclairer objectivement la réalité des situations familiales.
Comme plusieurs autres chiffres sensationnalistes repris dans les deux propositions de loi, celle-ci illustre par ailleurs un phénomène de copié-collé législatif, où le contenu de l’exposé des motifs est recyclé d’une législature à l’autre, sans mise à jour des sources, sans examen critique, et sans prise en compte des remarques formulées précédemment par les institutions consultatives ou les chercheurs. Le texte de 2025 reprend presque mot pour mot l’argumentaire de 2022, y compris ses approximations, ses omissions (notamment sur les violences faites aux femmes et aux enfants), et ses chiffres non sourcés.
Ce recyclage démontre non seulement un manque de rigueur dans l’élaboration législative, mais aussi une volonté stratégique d’ancrer dans le débat public des normes pseudo-égalitaires, via la répétition mécanique d’arguments non vérifiés.
Fact-check: “à la majorité, 40 % des enfants de parents séparés ne voient plus leur père”
Cette affirmation est régulièrement reprise dans des discours militants favorables à la résidence alternée automatique. Pourtant, elle repose sur une interprétation trompeuse et décontextualisée des données produites par l’INED.
La source généralement mobilisée est l’enquête Erfi 2005 (Étude des relations familiales et intergénérations), qui observe l’évolution des liens entre enfants et parents après une séparation. Or, cette enquête ne montre absolument pas que 40 % des enfants majeurs coupent tout lien avec leur père dès la majorité. Elle indique en réalité que ce taux augmente progressivement avec l’âge, et qu’il atteint environ 30 % chez les personnes âgées de 30 à 34 ans qui ont grandi avec des parents séparés — ce qui est très différent. Ce chiffre reflète une variété de parcours de vie : éloignement géographique, absence de relation préexistante, décès, conflits anciens, ou encore désengagement volontaire du parent.
Chez les enfants mineurs, le taux d’absence de contact avec le père après séparation est estimé à environ 10 % (INED, Régnier-Loilier, 2013). Cela signifie que la majorité des pères restent en contact régulier avec leurs enfants.
L’utilisation du chiffre de 40 % comme une statistique concernant "les enfants" est donc une manipulation par décalage d’échelle : elle consiste à présenter comme une conséquence directe du mode de garde infantile une situation mesurée plusieurs décennies plus tard, dans un contexte de vie adulte, souvent marqué par d’autres déterminants (mobilité, conflits anciens, choix individuels…).
Cette instrumentalisation vise à suggérer que la résidence exclusive entraînerait mécaniquement une rupture de lien parental, alors que les données disponibles montrent des trajectoires diversifiées, complexes, et non déterminées uniquement par la configuration de résidence dans l’enfance.
3. L’oubli délibéré des violences conjugales
Le texte n’évoque la question des violences que de façon expéditive et périphérique, en affirmant simplement que « les cas de violences domestiques continueront d’être examinés par le juge ». Cette mention minimaliste est gravement insuffisante au regard de l’ampleur du problème. Selon l’enquête Virage menée par l’INED (2016), plus de 60 % des mères isolées ayant quitté leur conjoint l’ont fait à la suite de violences conjugales — physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles. Ces violences ne concernent pas uniquement la relation de couple : près de la moitié des enfants concernés sont eux-mêmes co-victimes ou témoins directs, ce qui constitue une forme reconnue de maltraitance.
Dans ce contexte, toute mesure visant à généraliser la résidence alternée sans évaluation systématique des risques expose directement les mères et les enfants à un danger grave. C’est précisément ce qu’a pointé en 2020 le GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes), organe de suivi de la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe. Alors que l’exposé des motifs érige la Belgique comme exemple de réussite en matière de résidence alternée imposée, dans son rapport d’évaluation sur la Belgique, le GREVIO a fermement condamné l’instauration d’une présomption légale de résidence alternée, en soulignant l’insuffisance des garanties offertes aux victimes de violences conjugales et l’incapacité des juges à y déroger dans les faits. Ce précédent met en garde contre une tendance à traiter la garde partagée comme neutre ou égalitaire, alors qu’elle peut en réalité perpétuer des mécanismes de contrôle post-séparation, très fréquents dans les situations de violences.
La France, en tant qu’État signataire de la Convention d’Istanbul, s’est engagée à protéger les femmes et les enfants contre les violences domestiques, y compris dans le cadre des procédures civiles, comme les décisions de garde. Instaurer une présomption de résidence alternée, même "réfragable", irait à l’encontre de ces engagements, en banalisant les risques et en faisant peser la charge de la preuve sur la victime — souvent isolée, sans avocat, sous emprise ou contrainte économique. Ignorer ce point, ou le reléguer en note de bas de page, revient à mettre en péril les principes fondamentaux de la protection des victimes, en prétendant faire primer les « droits des pères », dans un contexte ou il n’existe pas de discrimination à leur égard, sur la sécurité des mères et des enfants.
4. Le droit international, brandi sans nuance
Il est souvent avancé que « la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) garantit à tout enfant le droit d’entretenir des relations avec ses deux parents », pour justifier la résidence alternée comme modèle par défaut. C’est juridiquement exact, mais de manière conditionnelle : ce droit n’est ni absolu, ni inconditionnel. L’article 9 de la CIDE stipule en effet que :
« Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’entre eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Autrement dit, le maintien des liens parentaux doit toujours être subordonné à l’intérêt supérieur de l’enfant, au cas par cas. Ce cadre permet justement de limiter, suspendre ou encadrer les relations avec l’un des parents si celles-ci présentent un risque pour la sécurité, le développement ou le bien-être de l’enfant — comme c’est le cas en contexte de violences conjugales, de manipulation psychologique, ou d’abandon parental.
De même, la résolution 2079 du Conseil de l’Europe (2015), fréquemment invoquée pour soutenir la résidence alternée, n’a aucune valeur juridique contraignante. Il s’agit d’un texte non normatif, qui encourage les États membres à promouvoir une coparentalité équilibrée, mais ne préconise pas l’instauration d’un modèle automatique. Elle insiste sur l’importance de favoriser les accords parentaux volontaires dans l’intérêt de l’enfant, et ne remet pas en cause le rôle du juge pour évaluer au cas par cas. En outre, plusieurs parlementaires et ONG féministes avaient déjà, à l’époque, alerté sur le fait que cette résolution risquait d’être instrumentalisée pour imposer un régime rigide, au mépris des situations de violences et d’inégalités.
Ainsi, ces textes internationaux sont souvent interprétés de manière déformée par les partisans de la présomption légale de résidence alternée, qui en oublient les principes fondamentaux de prudence, de proportionnalité et d’évaluation individualisée. Il ne s’agit pas de nier le rôle du second parent, mais de rappeler que l’intérêt de l’enfant ne peut être réduit à une stricte égalité arithmétique entre adultes.
5. La présomption légale : une arme judiciaire contre les mères
Le texte met en avant comme un progrès juridique le fait qu’« une présomption de résidence alternée permettrait une inversion de la charge de la preuve », obligeant le parent qui la conteste à démontrer qu’elle serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Mais c’est précisément ce point qui alarme de nombreuses juristes, associations de protection de l’enfance, de défense des droits des femmes et institutions indépendantes.
Une telle inversion reviendrait à faire peser la responsabilité de la preuve sur le parent protecteur — le plus souvent la mère — y compris dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales. Plutôt que de garantir une évaluation prudente et individualisée par le juge, la présomption rendrait la résidence alternée quasi automatique par défaut, sauf démonstration formelle et documentée de sa nocivité. Or, dans la réalité judiciaire, prouver qu’un père est dangereux, maltraitant ou instable exige des procédures longues, coûteuses et psychologiquement éprouvantes, souvent impossibles à mener sans avocat, expertise ou appui institutionnel.
Les associations spécialisées (comme le CNIDFF, la Fondation des femmes, la FNSF, etc.) alertent régulièrement sur le fait que la majorité des victimes de violences conjugales ne parviennent pas à faire reconnaître ces violences devant les juridictions civiles, faute de preuves suffisantes ou en raison d’un refus systémique de les intégrer dans les contentieux familiaux. Dans un tel contexte, l’inversion de la charge de la preuve revient à considérer par défaut la résidence alternée comme neutre, alors même que de nombreux pères violents continuent d’utiliser les procédures de garde pour maintenir un contrôle post-séparation
6. Une loi qui aggraverait les inégalités sociales
Imposer une résidence alternée comme principe par défaut implique bien plus qu’un simple partage du temps parental. Cela suppose deux logements stables, équipés et adaptés à l’accueil de l’enfant, une coordination logistique continue entre parents (transports scolaires, emploi du temps, proximité des lieux de vie), ainsi que des ajustements professionnels parfois incompatibles avec des horaires précaires ou à temps partiel. Or, pour les familles les plus vulnérables — majoritairement des mères seules, locataires, sans emploi stable ou en situation de dépendance économique — ce modèle, conçu pour des configurations parentales stables et aisées, se révèle profondément inégalitaire et socialement inapplicable.
Du point de vue résidentiel, les inégalités sont flagrantes. Une étude de l’INSEE (2017) montre que les pères sont beaucoup plus souvent propriétaires du logement familial au moment de la séparation et restent fréquemment dans le domicile initial, tandis que les mères, en particulier dans les cas de départs liés à des violences, doivent se reloger rapidement, seules, et à proximité de l’école ou du domicile paternel pour que la résidence alternée soit envisageable. Dans les zones urbaines ou périurbaines tendues, les loyers trop élevés rendent cette condition logistique impossible à tenir, surtout pour des femmes à faibles revenus ou en emploi précaire. Cette contrainte résidentielle, totalement ignorée par les partisans d’une résidence alternée automatique, constitue pourtant un facteur déterminant d’exclusion.
À cela s’ajoute une architecture fiscale et sociale qui renforce mécaniquement les déséquilibres. En cas de résidence alternée, les allocations logement, les prestations familiales ou la part fiscale des enfants peuvent être partagées ou réduites, sans prise en compte réelle du niveau de vie, du statut professionnel ou des charges supportées par chaque parent. De plus, la Contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant (CEEE), lorsqu’elle est versée, est déductible d’impôts pour le parent payeur (souvent le père), mais imposable pour la mère qui la reçoit, alourdissant sa fiscalité et réduisant ses droits sociaux. Cette asymétrie, pointée dans les travaux de Sibylle Gollac et Céline Bessière (Le genre du capital), produit une coparentalité déséquilibrée, dans laquelle le statut égalitaire affiché masque un taux d’effort inégal, tant en temps qu’en ressources.
Conclusion
Ce que ces propositions de loi racontent n’est pas simplement une histoire de coparentalité apaisée — c’est une guerre culturelle menée sur le terrain du droit et de l’émotion. Une guerre des normes. Ce que la chercheuse Amélie Férey nomme normfare : un affrontement stratégique où des acteurs cherchent à imposer leurs intérêts en s’emparant du langage juridique, des affects publics, et des récits de justice. Ici, ce sont les groupes masculinistes qui en ont fait leur terrain d’action privilégié.
Derrière l’apparente neutralité des chiffres et l’appel à l’égalité parentale, on retrouve un schéma bien décrit par Kate Manne, philosophe féministe australienne : surmobilisation de la souffrance masculine (himpathy), invisibilisation des violences vécues par les femmes (herasure), et usage instrumentalisé du droit pour rétablir une autorité patriarcale. Les mères deviennent suspectes par défaut, les pères victimes structurelles d’un supposé système "pro‑mères", et l’égalité se réduit à une affaire de calendrier partagé — sans égard pour les conditions de vie, les trajectoires sociales, ni la sécurité des femmes et des enfants.
Ce n’est pas de la réforme, c’est de la récupération. Ce n’est pas de la protection de l’enfance, c’est du rebranding patriarcal. Si ces militants voulaient réellement défendre les enfants, ils commenceraient par garantir aux deux parents les moyens concrets d’élever leurs enfants dans des conditions stables, sécurisées et choisies. Ils commenceraient par reconnaître que l’égalité, ce n’est pas traiter tout le monde pareil, mais tenir compte des inégalités réelles.
À la place, ils mènent bataille pour transformer un dispositif d’exception en règle automatique, dans une logique de neutralisation politique du genre. C’est là tout l’enjeu : imposer un modèle formel d’égalité parentale qui masque, et parfois aggrave, les dominations existantes. Ce normfare est un cheval de Troie. Il faut le désarmer.



