Depuis plusieurs années, des applications apparaissent pour agir face au harcèlement de rue. Elles sont généralement basées sur un système de géolocalisation ayant comme objectif de lancer des alertes pour prévenir des utilisateurs-ices et des proches. Ces technologies sont utiles. Elles rassurent les victimes et favorisent une idée de solidarité et de sécurité. Certains dispositifs permettent aussi d'appeler les secours, de recenser des ''safe place'' partenaires et d'organiser du co-piétonnage. Il en existe maintenant plus d’une quinzaine et de nouvelles sortent régulièrement sur le marché. La possibilité d’avoir des personnes à proximité pour intervenir dans une situation de danger et celle de pouvoir envoyer une localisation à des proches, grâce à une application est une avancée importante dans la lutte contre le harcèlement de rue.
D’un autre côté, les travaux scolaires visant à mettre en place des actions de sensibilisation au harcèlement de rue se multiplient eux aussi. Ils prennent la forme d’associations, de relais de témoignages ou encore de réseaux de co-piétonnage. En tout, plusieurs dizaines de projets existent rien qu’en France, certains très éphémères et d’autres plus pérennes.
La multiplication de ces dispositifs prouve que la question du harcèlement de rue prend de l’ampleur et de l’importance aux yeux de la société et cette prise de conscience est nécessaire afin que plus aucune situation de harcèlement n'ait lieu.
Pourtant, de la perte d’efficacité, au renforcement des stéréotypes et à l’invisibilisation des publics concernés, jusqu’à la récupération politique et marketing sur le dos de la cause, nous passons en revue les problématiques qui émergent ainsi.
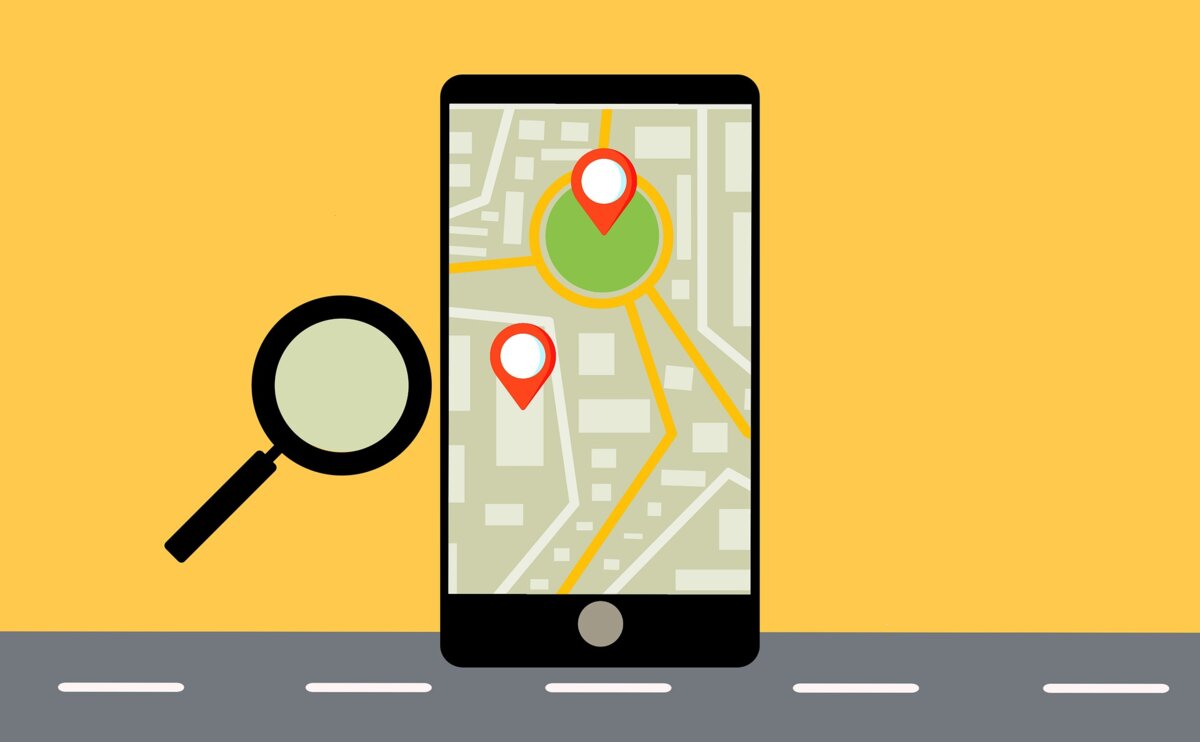
Agrandissement : Illustration 1

Un nombre important d’applications à l’origine d’une dispersion des ressources et effectifs.
Un des principaux problèmes est que le nombre grandissant de ces dispositifs divise le nombre d'individus prêts à intervenir en cas de besoin. Personne n’installe une dizaine d’applications et est actif·ve sur l’ensemble d’entre elles pour aider ou demander de l’aide.
Les créateur·ices·s, toujours en recherche de plus d'innovation, divisent les ressources utiles pour lutter contre le harcèlement de rue, alors que le plus efficace serait de créer un outil unique et complet.
Les différents groupes de safe-walk tombent dans le même écueil. S’ils partent souvent d’une bonne intention, leur nombre important et le manque de communication entre les différentes organisations sont à l’origine d’une division des forces.
Une vision unique et réductrice du harcèlement de rue.
L’immense majorité de ces initiatives traite seulement des comportements sexistes, s’adressant donc uniquement aux femmes.
Cependant, le harcèlement de rue est également raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, putophobe, validiste. Le harcèlement de rue est subi par l’ensemble des personnes minorisées. Celles-ci connaissent l’anxiété quotidienne, les micro-agressions régulières, les injures, les commentaires, le sentiment constant qu’aucune opportunité de s'exprimer dans les espaces publics ne leur est laissée.
Pourtant, elles ne sont pas prises en compte dans les dispositifs mis en place par les applications et les projets scolaires. A titre d’exemple, les personnes transgenres sont particulièrement concernées par le harcèlement de rue. Elles subissent en effet des violences transphobes, parfois combinées à de l’homophobie ou à du sexisme pour certaines d’entre elles. Cependant, les applications ne permettent pas d’inclure ces personnes, comme les propositions de co-piétonnage ‘’uniquement pour les femmes’’ qui vérifient les cartes d’identités (pas toujours à jour pour les femmes transgenres), ou encore les questionnaires binaires demandant si l’on est un homme ou une femme (quid des personnes non-binaires ?).
Quelle est alors l’aide apportée aux victimes qui font partie des minorités de genre ? Comment valoriser leur parole si les dispositifs mis en place pour les aider les invisibilisent ?
Le renforcement des préjugés racistes et classistes.
En insistant sur certaines zones, considérées plus dangereuses ou propices au harcèlement de rue, certains projets renforcent des préjugés et stigmates autour de celui-ci et de ses auteurs supposés.
La géolocalisation peut être un outil utile pour envoyer des alertes précises sur le lieu de l’agression. Cependant, certains projets proposent une cartographie de « zones à risque », majoritairement situées dans les banlieues. Ce genre d’actions nourrit le préjugé selon lequel le harcèlement serait uniquement le fait d'hommes racisés venant de quartiers populaires.
Une fois de plus, cette vision est très réductrice et éloignée de la réalité.
Le harcèlement de rue a lieu partout, dans les quartiers résidentiels neufs comme dans les banlieues. Le profil type du harceleur de rue n’existe pas. Ces cartes figurant des zones à risques situées uniquement dans des quartiers populaires véhiculent des préjugés racistes et classistes et qui ne montrent qu’une partie de la réalité. Aucune classe sociale ni aucun lieu de résidence n'immunise au harcèlement de rue, ni ne le favorise.
Les outils de lutte contre le harcèlement de rue, réappropriés par les dominants, à leur profit.
De nombreux projets scolaires re-créent, sous des noms différents, des initiatives qui reprennent le principe du projet Angela, lancé par des militantes féministes. Au lieu de de reprendre ce dispositif en multipliant les effectifs et partenaires, en conjuguant les forces et compétences des différents collectifs, des dizaines de dispositifs homologues sont créés chaque année, divisant ainsi ce qui sépare les ressources et les personnes prêtes à agir.
Il est effectivement plus aisé de mettre en place des idées déjà pensées par d’autres, de se vanter d’une réalisation déjà mâchée, de récupérer des luttes qui sont, historiquement, factuellement, militantes et féministes. Un travail mené par des bénévoles, ni rémunéré·e·s ni crédité·e·s pour leurs recherches, est réapproprié sans gêne par certain·e·s pour bénéficier de l’éclairage porté sur la question du harcèlement de rue sous forme d’applaudissement, de mentions très bien ou même d’argent.
Face au constat de la multiplication des applications, une solution logique serait de regrouper l’ensemble de ces projets similaires en un seul qui prendrait plus d'ampleur. Cette solution de bon sens se heurte aux intérêts, aux désirs de crédits et de visibilité à l'origine de la mise en place de ces applications. La question des rendements remplace alors celle de l’efficacité.
En effet, certaines plateformes et certains projets sont à but lucratif, et existent uniquement pour cette raison. Elles sont même parfois créées par des hommes cisgenres, hétéros et blancs, qui ne sont pas concernés par le problème. Encore une fois, les moyens militants sont détournés par des personnes, parfois non concernées fragilisant la lutte plutôt que de la renforcer. Dans ce cadre, il est possible de questionner les intentions sous-jacentes à la mise en place de ces applications et de ces travaux scolaires. Le but est-il vraiment de participer à un effort collectif visant à mettre fin au harcèlement de rue et aider les victimes, ou alors est-il de tirer des profits de cette cause ?
La lutte contre le harcèlement de rue n’est pas un business, ni un exercice scolaire. C’est une réalité et pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, elle a besoin de moyens et d’effectifs, pas de division, ni de communication qui désinforme.
Alors, comment mettre ces projets au service de la lutte contre le harcèlement de rue ?
Nous nous réjouissons du nombre de personnes et de structures qui participent à la lutte contre le harcèlement de rue, les discriminations, les violences et la haine. Toute cette énergie, si elle était mise en commun, mettrait définitivement terme au harcèlement de rue.
Les projets qui naissent, les technologies qui se mettent au service de la lutte, et l’augmentation des effectifs prêts à aider sont une force. Cependant, il faut faire attention à ne pas causer plus de tort que de bien. Regardons autour de nous, renseignons-nous sur les travaux déjà mis en place et la façon de s’y investir pour les aider, renforcer leur nombre, et y apporter nos idées.
Plus nous lutterons ensemble, plus nous serons efficaces.
Si vous voulez participer au combat face au harcèlement de rue, aidez-nous. Travaillons ensemble, avec l'aide des différentes personnes concernées, par nous, pour nous, avec nous. Nous devons rassembler nos forces.
Venez renforcer nos rangs. Demandez-nous comment nous soutenir. Si votre idée est similaire à un projet déjà mis en place par un autre collectif, enrichissez-le avec vos innovations et compétences.
Portez notre parole. Ne prenez pas la place des publics concernés dans la lutte.
En conjuguant nos forces et en travaillant ensemble, l’impact sur le harcèlement de rue sera conséquent, et la peur changera de camp.




