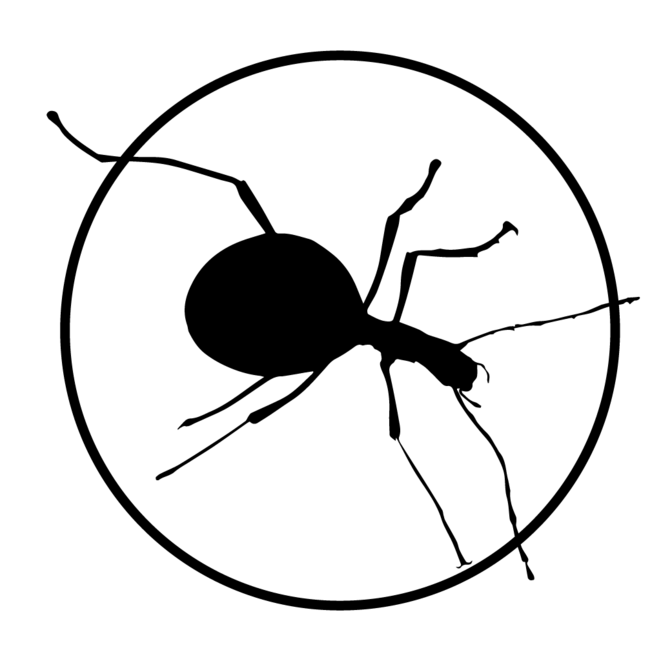Depuis les travaux de la Grande Galerie de l’Évolution du Muséum National d’Histoire Naturelle, qui a rouvert ses portes en 1994, la France est frappée d’une épidémie de rénovation de ses Muséums. Le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse a rouvert ses portes en 2008 après sa fermeture en 1997, celui de Bordeaux en 2019 après cinq ans de travaux, le Muséum de Lille est actuellement en rénovation après une première phase de travaux entre 2020 et 2021, le Muséum de Nantes fermera ses portes en 2026 pour créer de nouvelles surfaces, le Muséum de Nice modernise également son exposition permanente, et ainsi de suite.
Les cabinets de curiosités
Ces rénovations s’inscrivent toutes dans une nouvelle manière de penser les muséums et leurs expositions, mais également les sciences naturelles. Les Muséums d’histoire naturelle trouvent leur origine dans les cabinets de curiosités, qui apparaissent dès la Renaissance à l’initiative d’aristocrates érudits. Ces fameuses curiosités sont très hétéroclites : œuvres d’art, minéraux, animaux naturalisés, fossiles, antiquités, etc. Tout y est exposé, sans d’autre dessein que l’accumulation. Cette accumulation est le matériel même des sciences naturelles en pleine construction : l’objectif est de procéder à un inventaire purement descriptif du monde en se focalisant sur le rare, le précieux ou l’étrange. On y arbore son érudition et on permet aux visiteurs et visiteuses éclairées de poser les yeux sur l’ensemble du monde connu. Les curiosités sont à la fois conservées et exposées : il n’y a pas de choix dans ce qui va être montré de ce qui ne le sera pas. À partir des XVIIe et XVIIIe siècles, les premières critiques de cette pratique émergent. Les collections considérées comme trop hétérogènes se spécialisent : beaux-arts, techniques et sciences naturelles font maintenant chambre à part. Émergent ainsi les « cabinets d’histoire naturelle ».
Muséum et taxinomie
Au même moment s’impose un nouveau système de classification du vivant, notamment généralisé par Carl von Linné dans son Systema naturæ (la première édition datant de 1735). Désormais, les collections d’histoire naturelle seront classées selon ces catégories plus rigoureuses. À la Révolution, les cabinets et leurs collections sont saisis et réinstallés dans ce qui deviendra les premiers Muséums d’histoire naturelle, et le jardin royal des plantes est transformé en Muséum National d’Histoire Naturelle le 10 juin 1793. Les critères et systèmes de classification se complexifient, et les objets s’accumulent au gré des découvertes. Pour aborder ces expositions et lier les objets entre eux, il est alors nécessaire pour le visiteur de disposer de connaissances taxinomiques (science de la classification). Les muséums n’ont ainsi d’intérêt que pour les savants et érudits passionnés.
Une volonté didactique
Au XIXe siècle, les sciences se spécialisent et les domaines de recherche se multiplient. Les Muséums sont à la première place de la recherche en sciences naturelles et accumulent des objets issus des expéditions scientifiques et des épisodes de colonisation. On vit un véritable âge d’or : la moitié des musées scientifiques français ont ouvert à cette période. Mais une autre révolution prend place au crépuscule du XIXe : une première volonté véritablement didactique apparait, notamment pour diffuser les récents développements des nouvelles sciences expérimentales. Cette volonté se heurte à la réalité des espaces où sont accumulés tous les objets classés selon la taxinomie en cours. On dissocie alors espaces de collection et espaces d’exposition : tout n’est plus voué à être montré. Les Muséums deviennent ainsi de plus en plus des espaces de communication. En Scandinavie et en Amérique de Nord, où les institutions sont plus jeunes et donc moins réticentes aux changements, se développent les dioramas. Il ne s’agit plus uniquement de sélectionner des spécimens dans les collections mais de les préparer spécifiquement à des fins didactiques et scénographiques. Les animaux sont mis en scène dans leur environnement et leurs relations sont rendues visibles sans que les visiteurs et visiteuses n’aient besoin de connaissances scientifiques préalables.
Une lente mutation française
En France, les Muséums d’histoire naturelle passent à côté de ces révolutions, mais restent cependant des centres de recherches importants pour lesquels les collections constituées au fil des siècles est un atout majeur. Cette situation durera jusqu’à la fin des années 1980. La transformation des Muséums en France s’opère au carrefour de plusieurs changements : l’actualité écologique est de plus en plus prégnante et de nombreuses réflexions sur les musées ont permis de repenser leurs rôles et leur projet autour de la médiation. La première pierre est posée avec la rénovation de la Grande Galerie de l’Évolution et des expositions du Muséum National d’Histoire Naturelle, débutée en 1991. Les Muséums renouent avec leur public et se restructurent autour des visiteurs et visiteuses. Cette transformation se transcrit dans la Loi musées de 2002 et l’appellation « Musée de France », où la collection est « organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Les Muséums ne mettent plus en avant leurs collections uniquement comme le miroir du monde décrit par les scientifiques, mais souhaitent que celles-ci, par le biais d’expositions pensées pour et par la médiation et la communication, participent aux débats scientifiques et sociaux. La prise de conscience de ce rôle social a ainsi permis, entre autres, de débloquer des budgets à la rénovation de musées en France, dont la plupart des Muséums d’histoire naturelle.
Bibliographie
Lambert V. & Rasse P. 2021. — Des cabinets de curiosités aux muséums, des classiques aux modernes. Hermès, La Revue 87 (1): 36–43
Rasse P. 2013. — Systématique et systémique, la leçon des muséums. Hermès, La Revue 66 (2): 66–72
Schiele B. 2001. — Le musée de sciences : Montée du modèle communicationnel et recomposition du champ muséal.
Van Praët M. 1996. — Cultures scientifiques et musées d’histoire naturelle en France. Hermès, La Revue 20 (2): 143–149
Van-Praët M. 2008. — Muséums et collections d’histoire naturelle: quelle place dans l’histoire des Musées? Histoire de l’art 62 (1): 11–18