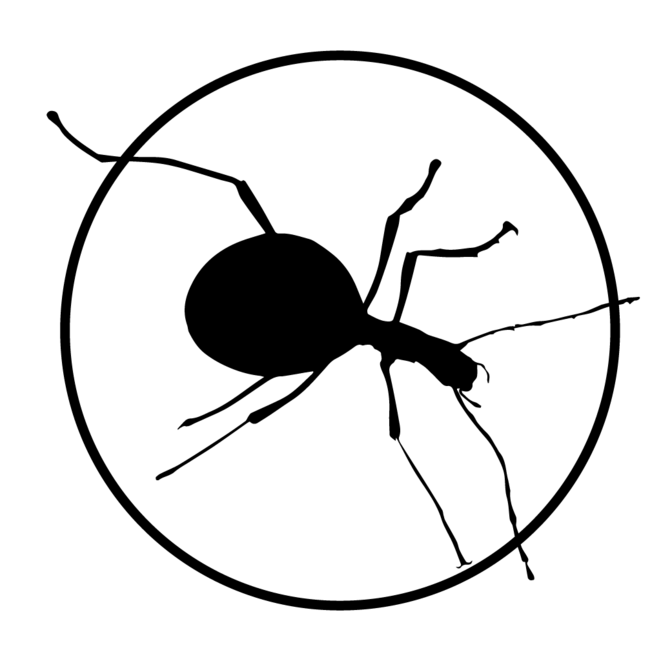Les collections des muséums d’histoire naturelle sont indispensables à la recherche en sciences naturelles. Constituées quelquefois sur plusieurs centaines d’années, elles sont les témoins des biodiversités passées et présentes. Elles sont un outil inestimable dans le contexte actuel d’effondrement d’origine anthropique de la biodiversité, permettant de documenter les changements d’aire de répartition des espèces, les variations morphologiques, physiologiques ou génétiques dans le temps et l’espace, les évolutions des connaissances naturalistes, et bien plus.
Ces collections, si largement étudiées et formant un des socles de sciences supposément neutres et objectives, sont cependant largement biaisées. Ainsi, certains lieux et dates (voire moment dans la journée) sont plus échantillonnés que d’autres, et certains groupes sont présents en plus grande proportion. Mais il est un autre biais qui a attiré l’attention des chercheurs et chercheuses ces dernières années : les muséums conserveraient plus d’animaux mâles que de femelles.
Des collections plus masculines
Les études concernant ce phénomène avancent plusieurs chiffres : chez les mammifères, 52% des individus conservés à travers le monde seraient des mâles, et la proportion est bien plus importante dans certains groupes comme les Artiodactyles (environ 60% de mâles), un ordre regroupant entre autres les ruminants, les porcins, les cétacés ou les hippopotamidés et dont les populations adultes sauvages présentent pourtant généralement plus de femelles. Ce biais se retrouve également chez des fossiles de bisons, ours bruns et mammouths : environ 75% seraient issus de mâles.
Les oiseaux ne sont pas en reste : 60% des spécimens conservés sont des mâles, proportion atteignant 63% chez les Columbiformes (regroupant notamment les pigeon et tourterelles) et les Apodiformes (martinets, hirondelles et colibris). Chez les reptiles, 53% sont des mâles, tandis que cette proportion atteint 61% pour les amphibiens.
Les chiffres sont encore plus criants chez les spécimens dits « types » (un type est un spécimen de référence ayant servi à la description d’une espèce et dont il porte le nom) : 75% des types d’espèces d’oiseaux sont des mâles, 61% pour les mammifères et 57% pour les amibiens et reptiles.
Pourquoi ce constat ?
Ce biais est particulièrement important chez les espèces et groupes qui présentent des mâles aux caractéristiques plus esthétiques aux yeux humains. Chez les oiseaux passeriformes (un ordre regroupant plus de la moitié des espèces d’oiseaux actuelles), on observe que les espèces présentant des mâles bien plus colorés que les femelles ont une proportion de mâles en collections plus importante. C’est également le cas chez les mammifères présentant des « ornements » comme des cornes, des défenses, des bois, des crinières et autres, qui sont souvent l’apanage des mâles.
Chez d’autres groupes ne présentant par de telles caractéristiques, le biais, moins important, serait moins intentionnel et résulterait plutôt de différences dans les méthodes de piégeage ou de repérage des espèces. Par exemple, les mâles de petits mammifères ont tendance à plus se déplacer et ont des habitats plus grands que ceux des femelles. Ils sont ainsi plus à même de rencontrer les collecteur.trices et leurs pièges. Chez les grenouilles, les mâles sont plus facilement détectés en raison de leurs chants territoriaux ou de reproduction. Certains groupes, plus minoritaires, présentent cependant un biais en direction des femelles, à l’instar des tortues marines. En effet, seules les femelles se rendent sur terre pour la ponte, à des dates et des lieux connus, ce qui rend leur capture plus simple.
Concernant les fossiles chez qui ce biais a été identifié, il serait dû à des différences dans l’écologie des mâles et femelles. Les femelles mammouths et bisons se rassemblent en troupeaux et groupes familiaux dont les mâles sont expulsés lorsqu’ils atteignent l’âge adulte. Ces derniers, ne bénéficiant plus de la protection offerte par le groupe et ses meneuses expérimentées, font preuve de plus d’imprudence, se rendent dans des territoires plus dangereux (parmi lesquels des tourbières, marais ou fosses à bitume offrant de meilleures conditions pour la conservation des fossiles) et sont donc plus à même de mourir à l’écart des groupes. Les fossiles de mâles sont donc plus dispersés et ont plus de chances d’être préservés, ce qui rend leur découverte fortuite plus probable, contrairement aux fossiles de femelles, plus géographiquement concentrés.
Un impact pour la recherche
Les recherches concernant l’évolution de caractères morphologiques ou l’anatomie comparée peuvent pâtir de cet écart : mâles et femelles peuvent présenter des différences anatomiques importantes (on parle de dimorphisme sexuel) pouvant influencer les résultats d’études comparatives. Les études génétiques sont aussi impactées, mâles et femelles présentant généralement des différences chromosomiques (mâles XY vs. femelles XX chez les mammifères, mâles ZZ vs. femelles ZW chez les oiseaux, bien que ces différences ne soient pas systématiques) et dans l’expression de certains gènes. Les études en parasitologies ou toxicologie sont également victimes de ces biais : l'écologie des mâles et des femelles d'une même espèce peut différer (dans le régime alimentaire, les interactions avec des individus de la même espèce ou d’espèces différentes, les milieux fréquentés, etc.) les exposant à des parasites ou contaminants différents. Enfin, les espèces sont plus souvent décrites à l’aide d’individus mâles, pouvant rendre l’identification des femelles plus complexe.
Le problème étant identifié, il en est de la charge des professionnel.les des musées de les prendre en considération, de les évaluer au sein de leurs collections et, si possible, de les corriger en acquérant de nouveaux spécimens. Lorsque de nouvelles collectes ont lieu, il devient impératif, autant que faire se peut, de collecter mâles et femelles en proportions similaires. Les scientifiques doivent également prendre en compte ces différences lors de la mise en place de leurs études et protocoles. Des efforts nécessaires pour une meilleure compréhension du monde qui nous entoure.
Bibliographie
Cooper N., Bond A.L., Davis J.L., Portela Miguez R., Tomsett L. & Helgen K.M. 2019. — Sex biases in bird and mammal natural history collections. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 286 (1913): 20192025.
Gower G., Fenderson L.E., Salis A.T., Helgen K.M., Van Loenen A.L., Heiniger H., Hofman-Kamińska E., Kowalczyk R., Mitchell K.J., Llamas B. & Cooper A. 2019. — Widespread male sex bias in mammal fossil and museum collections. Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (38): 19019–19024.
Wainwright T., Trevena M., Alewijnse S.R., Campbell P.D., Jones M.E., Streicher J.W. & Cooper N. 2024. — Sex biases and the scarcity of sex metadata in global herpetology collections. Biological Journal of the Linnean Society 142 (3): 308–318