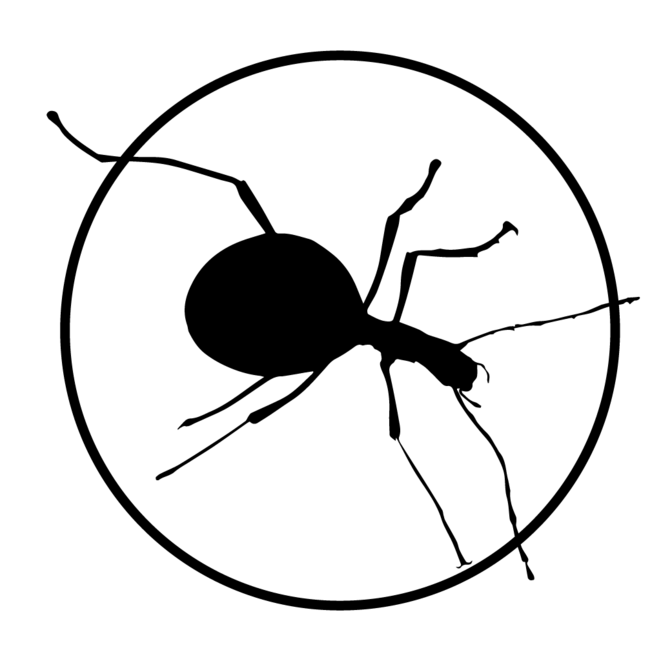L’exposition est le support principal de communication des musées. Elle apparaît comme un des rôles principaux du musée dans la définition du conseil international des musées (ICOM), qui le définit comme « une institution permanente à but non lucratif au service de la société qui recherche, collecte, conserve, interprète et expose le patrimoine matériel et immatériel. Ouverts au public, accessibles et inclusifs, les musées favorisent la diversité et la durabilité. Ils fonctionnent et communiquent de manière éthique, professionnelle et avec la participation des communautés, offrant des expériences variées pour l’éducation, le plaisir, la réflexion et le partage des connaissances ».
Cette définition rejoint celle que Bernard Schiele, chercheur s’intéressant aux questions de culture et muséologie scientifiques, donne des musées scientifiques. Ils sont des « lieu[x] de médiation et de négociation d’informations destinées au public ». Par médiation, Schiele entend que le musée « présente des artefacts et des expositions » pour « mettre les visiteurs en contact avec les sciences et les techniques » et « familiariser les visiteurs avec les idées et les notions clés de certains domaines ». Le musée joue ainsi le rôle d’interface avec le monde des sciences, extérieur à celui de l’exposition, dont sont issus les objets exposés. Il mobilise un corpus de savoirs (par exemple, les sciences dites naturelles pour une Muséum d’Histoire naturelle) se référant aux objets qu’il expose et réalise ainsi son objectif de partage des connaissances. Par négociation, Schiele entend que « ces interfaces sont des dispositifs […] pensé[s] et réalisé[s] ». L’exposition met en relation visiteurs avec des objets par une mise en espace de ceux-ci. Cette dernière est pensée (par les muséographes et scénographes) pour organiser des idées et notions et pour donner aux visiteurs les clés pour s’approprier le message. L’exposition constitue un discours formé par l’ensemble des objets exposés et des éléments (visuels, auditifs, tactiles, verbaux ou non-verbaux, etc.) qui accompagnent les visiteurs et qui leur donnent les indications nécessaires pour construire un sens. Elle assure ainsi aux visiteurs un passage entre son monde et celui dont sont issus les objets. C’est ce que Jean Davallon, sociologue spécialiste des médiations culturelles au sein des musées, entend lorsqu’il définit l’exposition « comme un dispositif résultant d’un agencement de choses dans un espace avec l’intention (constitutive) de rendre celles-ci accessibles à des sujets sociaux ».
La construction du sens dans l’exposition
On ne peut cependant s’assurer que le visiteur construise le sens que l’on souhaite qu’il construise. Le processus d’acquisition de connaissances relève de tant de différents facteurs qu’il est impossible pour les concepteurs ou conceptrices d’expositions de s’assurer entièrement de l’apprentissage par les visiteurs. Les musées restent un espace de choix, dans lequel les visiteurs sont actifs et déambulent librement, en choisissant ce à quoi ils ou elles souhaitent s’intéresser. L’acquisition de connaissances dans les musées dépend d’un dialogue constant entre les individus et leurs contextes personnels, socioculturels et physiques.
Selon Jean Davallon, trois facteurs peuvent tout de même permettre de favoriser la construction du sens souhaité chez les visiteurs. Premièrement, les éléments de l’exposition doivent être de nature hétérogène, de manière à pouvoir être interprétés les uns par rapport aux autres. On peut donner ici un exemple simple : l’association d’un objet et d’une étiquette dans un même espace. Tous deux sont de nature différente, l’un permet d’interpréter l’autre et vice-versa (il peut être difficile d’interpréter un objet sans son étiquette comme il est difficile d’interpréter une étiquette sans l’objet qu’elle désigne).
Le deuxième facteur correspond à l’intégration entre les éléments de l’exposition et leur contexte. Chaque élément s’emboîte dans des unités de rang supérieur leur servant de contexte, s’intégrant elles-mêmes dans des unités plus grandes, et ainsi de suite, jusqu’à l’exposition entière. Cet emboîtement de contextes contribue à la cohérence de chacune des unités et à la construction de sens à l’intérieur même de chacune d’entre elles. Un objet ne peut ainsi s’interpréter que parce qu’il est associé à d’autres éléments comme des textes ou illustrations qui le contextualisent (et inversement), et cet ensemble ne s’interprètent qu’à la lumière de son contexte, par exemple, une vitrine présentant plusieurs objets et éléments illustrant un phénomène, qui elle-même ne s’interprète qu’au regard des vitrines qui l’entoure dans une salle, etc. Ces unités doivent également s’enchaîner selon une trame qui garantit la relation entre chaque unité et participe à dérouler le discours de l’exposition. Par cet emboîtement et cette organisation selon une trame, on cherche à anticiper la déambulation des visiteurs au sein de l’exposition, et donc sa production de sens.
Enfin, le troisième facteur concerne la prise en compte de la perspective du visiteur : celui-ci doit percevoir que l’exposition cherche à lui communiquer une certaine information. Cela permet d’éviter que le visiteur fasse de fausses hypothèses sur ce que l’exposition cherche à lui faire comprendre.
Le rôle de l’objet dans l’exposition
Les objets jouent un rôle central dans les expositions. Ils sont, d’après André Gob et Noémie Drouguet auteur.rices d’un ouvrage intitulé « La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels », les « unités de base du langage de l’exposition ». Les objets ont été « extirpés » de leur monde pour en devenir les témoins au sein du monde de l’exposition : ils perdent leur fonction première et acquièrent un rôle symbolique.
On ne peut cependant pas ignorer que les objets muséaux peuvent être perçus directement tels qu’ils sont et non pas uniquement comme images du monde qu’ils représentent. Duncan Cameron, muséologue canadien, désigne ces objets comme des « vraies choses », définies comme : « des choses que nous présentons telles qu’elles sont et non comme des modèles, des images ou des représentations de quelque chose d’autre ». La relation que le visiteur forme avec une vraie chose est intuitive, et l’authenticité de l’objet (au sens où l’objet est réel et non un substitut, un faux) peut procurer de l’émotion au visiteur. La vraie chose est opposée au substitut qui représente une vraie chose, mais qui n’en est pas une.
François Mairesse, muséologue belge, dans son article « Muséologie et présentation : où sont les vraies choses ? » définit plutôt les vraies choses par leur potentiel communicatif. Il différencie ainsi plusieurs fonctions de communication :
- La communication factuelle « scientifique », un discours éducatif sur un fait scientifique ou un phénomène. Cette communication peut fonctionner avec tout objet, dont les vraies choses, et un substitut ou un autre support peut être plus efficace ici.
- La communication « a-scientifique », qui concerne le déclenchement d’une émotion parce que l’objet est porteur d’un témoignage. Seule une vraie chose dispose de ce potentiel (par exemple, une véritable lettre d’un soldat de la première guerre mondiale peut déclencher une émotion parce que l’on sait qu’elle est véritable et qu’elle provient d’une personne ayant vécu ce conflit).
- La communication spatio-temporelle représente la capacité d’un objet à apporter directement des informations sur ses dimensions spatiales (grand ou petit) et temporelles (vieux ou récent). Un substitut peut ici fonctionner en partie (une reproduction d’un tableau ou d’une statue à la véritable échelle informe immédiatement sur les dimensions de l’œuvre), mais la dimension temporelle peut plus difficilement être représentée.
- La communication méditative : un objet peut rappeler des valeurs ou notions de la culture humaine (une momie peut rappeler la mort par exemple). Tout objet peut ici fonctionner.
Expositions scientifiques et vulgarisation
Selon Bernard Schiele, les expositions scientifiques relèvent de la vulgarisation scientifique : leur rôle est de rapprocher la science du grand public, de faire acquérir une certaine quantité d’informations en se référant à un corpus de connaissances. Il définit la vulgarisation comme la diffusion « auprès du plus large public les résultats de la recherche scientifique et technique et plus généralement, l’ensemble des productions de la pensée scientifique en composant des messages facilement assimilables ». Elle se distingue de l’éducation à l’école car il n’y a pas d’apprentissage formel des connaissances et pas de suivi de l’apprentissage. Dans cette définition, les vulgarisateurs et vulgarisatrices sont vus comme des intermédiaires unissant chercheurs et public. La vulgarisation est considérée comme une traduction entre la langue savante et la langue commune, entre deux mondes (celui de la science et celui du « commun ») entre lesquels il existerait une rupture.
On peut apporter plusieurs critiques à cette vision de la vulgarisation. Premièrement, selon Daniel Jacobi, professeur de sciences de l’information et de la communication, la vulgarisation scientifique ne serait pas qu’une traduction, mais plutôt une rhétorique. La vulgarisation ne traduit pas le discours scientifique (elle emploie toujours des termes scientifiques), mais elle le met plutôt en scène en utilisant par exemple des figures de styles (comparaison, analogie, métaphore) dans l’objectif de reformuler ou de surprendre par exemple. Ensuite, la vulgarisation sélectionne des savoirs à diffuser sans se référer au discours scientifique qui les produit. Elle tente d’ancrer le savoir dans le vécu quotidien du visiteur (par l’analogie, la comparaison, la métaphore, etc…) en sapant les points d’appui du savoir. Elle ne communique pas une connaissance telle qu’elle est conçue dans le monde scientifique, elle n’en construit qu’une image.
De plus, les enjeux de l’exposition en tant que média, qui reste soumis à une économie de marché et aux règles de la consommation, sont différents de ceux du monde scientifique. Ces enjeux contraignent les messages et les mises en forme permettant de capter le plus de visiteurs. Ces savoirs sélectionnés, non exhaustifs, sont recontextualisés dans l’exposition, transformés pour assurer le divertissement en plus de l’instruction. Mais ces connaissances, si incomplètes et transformées soient-elles, entrent tout de même dans le champ social : le musée contribue tout de même à la socialisation du monde des sciences.
Bibliographie
Cameron D.F. 1968. — A Viewpoint: The Museum as a Communications System and Implications for Museum Education. Curator: The Museum Journal 11 (1): 33–40.
Davallon J. 2003. — Pourquoi considérer l’exposition comme un média? Médiamorphoses 9: 27–30.
Davallon J. 2000. — L’exposition à l’œuvre: stratégies de communication et médiation symbolique. L’Harmattan.
Desvallées A. & Mairesse F. 2005. — Sur la muséologie. Culture & Musées 6 (1): 131–155.
Desvallées A., Mairesse F. & Musées C. international des 2010. — Concepts clés de muséologie.A. Colin.
Falk J.H. & Storksdieck M. 2005. — Learning science from museums. História, Ciências, Saúde-Manguinhos 12: 117–143.
Gob A. & Drouguet N. 2014. — La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels.Armand Colin.
Jacobi D. 1985. — Sémiotique du discours de vulgarisation scientifique. Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours (2).
Mairesse F. 2002. — Muséologie et présentation: où sont les vraies choses ? ICOFOM Study Series: 81–88.
Schiele B. 2001. — Le musée de sciences : montée du modèle communicationnel et recomposition du champ muséal. l’Harmattan.
ICOM — Définition du musée. Consultable via https://icom.museum/fr/ressources/normes-et-lignes-directrices/definition-du-musee/