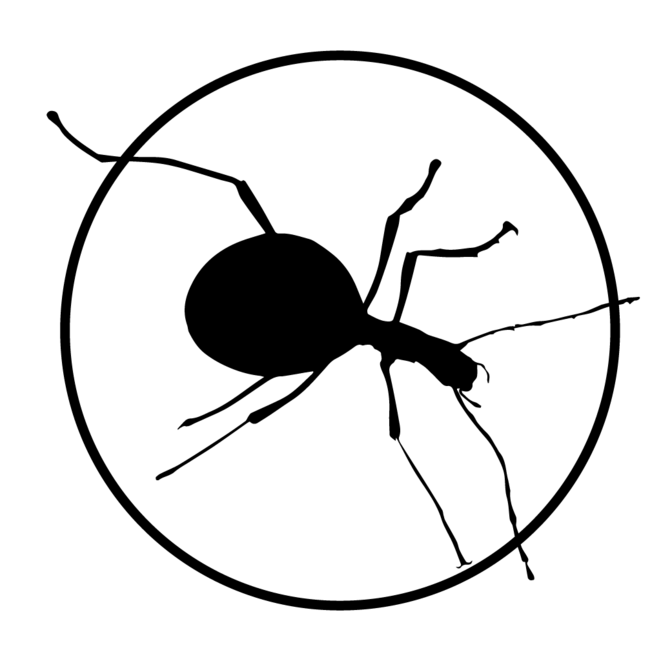En 1967, l’Escargot Lissachatina fulica, plus connu sous son nom d’Escargot géant africain, est introduit sur Tahiti. Censé servir de source de nourriture, il se retrouve rapidement dans la nature. Il devient alors un important ravageur de culture, capable de former de véritable invasion. En 1974, pour lutter contre cette « peste », le Ministère de l’Agriculture décide d’avoir recours à un agent de lutte biologique.
De la lutte biologique
La lutte biologique est un moyen permettant de contrôler des populations d’espèces exotiques envahissantes ou que l’on considère comme nuisibles en introduisant un agent de lutte ennemi naturel de ces espèces. Dans les meilleurs des cas, l’agent s’établit dans le milieu et contrôle le nuisible sans autre intervention humaine. C’est une méthode intéressante en ce qu’elle ne nécessite pas de dépenses sur le long terme (bien qu’un investissement initial important puisse être nécessaire) et permet, habituellement, de lutter efficacement contre une espèce ciblée sans utiliser de pesticide. On pourrait raisonnablement penser que la lutte biologique est employée si et seulement si des études ou des essais démontrent formellement que l’agent de lutte ne s’attaque qu’à l’espèce cible. Après tout, si l’objectif est de lutter contre une espèce envahissante faisant des ravages, ne vaut-il mieux pas s’assurer que l’agent employé n’en cause pas à son tour ? Revenons à notre histoire d’escargot.
L’Euglandine comme agent de lutte biologique
Face aux dégâts que causait l’Escargot géant africain dans les jardins et cultures de Polynésie française, le Ministère de l’Agriculture décida donc de relâcher un autre escargot, Euglandina rosea, ou l’Euglandine, un carnivore pouvant supposément se nourrir de l’Escargot géant africain. Ce petit escargot originaire du Sud-Est des États-Unis avait déjà été utilisé sur l’archipel d’Hawaï à la fin des années 1950 pour contrer le même Escargot géant africain. Les premiers résultats semblaient montrer un lien entre l’augmentation d’Euglandine et la diminution de l’Escargot géant africain sur l’île, un argument en faveur de l’efficacité de cet agent. Il a cependant été rapidement démontré que les deux phénomènes n'étaient pas liés, et que les premières études n’avaient pas pris en compte de nombreux facteurs comme la saisonnalité, les maladies, les parasites ou la consanguinité qui pouvaient tout aussi bien expliquer la baisse apparente des populations de l’Escargot géant africain. Pourtant, avec les conseils des autorités hawaïennes, la France décide également d’utiliser l’Euglandine en Polynésie, malgré les alertes lancées par les spécialistes.
La disparition des partulidés
Elle est donc introduite à Tahiti en 1974 et à Moorea en 1977. Dans les années qui suivent, elle se disperse sur les autres îles de l’archipel de la Société : elle est observée à Raiatea en 1986, à Tahaa en 1994, à Bora Bora et Huahine en 1991, et à Maupiti à une date encore inconnue aujourd’hui. En 1978, on observe un fort déclin des populations d’Escargot géant africain sur Moorea. Une bonne nouvelle en apparence. Pourtant, cette baisse s’observe également dans des régions où l’Euglandine n’est pas encore présente. Cette dernière ne semblait donc pas jouer son rôle d’agent de lutte biologique. Pourtant, elle prolifère et s'installe sur les îles : l'Euglandine semble donc bien se nourrir de quelque chose.
Les partulidés sont de petits escargots, généralement arboricoles, que l’on retrouve uniquement sur les îles du Pacifique. Au début des années 1980, on observe les premiers déclins de ces escargots sur Moorea. Ici, les études sont formelles, c’est bel et bien l’Euglandine qui est responsable. En 1988, 7 espèces de partulidés de Moorea sont considérées comme éteintes dans la nature. Le constat est le même pour les 2 espèces de Bora Bora et les 6 espèces de Tahaa, ainsi que pour 2 espèces (sur 4 connues) de Huahine et pour 29 espèces de Raiatea (sur 33 connues). Ainsi, plus d’une soixantaine d’espèces de partulidés ont disparu de Polynésie française depuis l’introduction de l’Euglandine. Des pertes considérables, la majorité de ces espèces étant endémiques de ces îles.
Une lumière au bout du tunnel
Face à ces extinctions, un programme international de conservation et de reproduction des partulidés est lancé en 1986, coordonnant des zoos disposant en captivité de certaines des espèces disparues et ayant pour objectifs de réintroduire ces escargots sur leurs îles d’origine et de renforcer les populations survivantes. En 2015, les réintroductions commencent, et plus de 21 000 individus appartenant à 11 espèces disparues dans la nature ont depuis été réintroduits sur les îles de Tahiti, Moorea, Huahine et Raiatea. Sur Moorea, au mois de septembre de cette année, une réserve a même été spécialement créée pour accueillir ces escargots.
Aujourd’hui, l’Euglandine semble avoir disparu de Tahha, Huahine, Bora Bora, Maupiti, voire de Raiatea, mais serait encore présente sur Tahiti et Moorea. L’Escargot géant africain est quant à lui toujours présent sur Tahiti, Moorea, Huahine et Raiatea mais aurait disparu de Tahaa, Bora Bora et Maupiti. Une petite lueur d’espoir pour les partulidés.
Bibliographie
Coote T. & Loève É. 2003. — From 61 species to five: endemic tree snails of the Society Islands fall prey to an ill-judged biological control programme. Oryx 37 (1): 91–96. https://doi.org/10.1017/S0030605303000176
Gerlach J., Barker G.M., Bick C.S., Bouchet P., Brodie G., Christensen C.C., Collins T., Coote T., Cowie R.H., Fiedler G.C., Griffiths O.L., Florens F.B.V., Hayes K.A., Kim J., Meyer J.-Y., Meyer W.M., Richling I., Slapcinsky J.D., Winsor L. & Yeung N.W. 2021. — Negative impacts of invasive predators used as biological control agents against the pest snail Lissachatina fulica: the snail Euglandina ‘rosea’ and the flatworm Platydemus manokwari. Biological Invasions 23 (4): 997–1031.
Une réserve aménagée à Moorea pour les escargots Partula, consultable via https://www.tahiti-infos.com/Une-reserve-amenagee-a-Moorea-pour-les-escargots-Partula_a232873.html
Le petit escargot partula à la rescousse de nos forêts, consultable via https://la1ere.franceinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/le-petit-escargot-partula-a-la-rescousse-de-nos-forets-1622231.html
Réintroduire les escargots arboricoles polynésiens, consultable via https://www.beauvalnature.org/nos-actions/programmes-de-conservation/escargots-polynesie
Small snails make big comeback in French Polynesia, consultable via https://news.mongabay.com/2024/09/tiny-snails-make-a-big-comeback-in-french-polynesia/