Quand j'ai commencé à faire des missions de régisseur général en théâtre, j'ai commencé à passer du temps au téléphone, pour organiser les spectacles en amont. J'ai donc été obligé de changer mon vieux forfait téléphonique, avec comme objectif de continuer sans Internet.
Sauf que... je n'avais pas le choix : soit je gardais un forfait pas cher avec très peu d'appels et pas d'Internet, soit j'avais appels illimités ET des centaines de giga de données mobiles. Il n'y avait pas réellement d'entre-deux, étant donné que les forfaits sans données mobiles étaient plus chers que ceux avec. Alors oui, je ne voulais pas Internet sur mon portable, mais je ne voulais pas non plus être un pigeon... Résultat, j'ai pris un forfait Internet.
Et depuis, ça modifie mon comportement. Je m'étais mis en position de ne pas utiliser Internet sur portable. Comme un·e addict aux jeux qui signe soi-même une interdiction de casino[1], je m'étais construit de toute pièce une excuse. Parce que tout autour de moi est incitation à utiliser Internet sur portable. Depuis les cartes des bars sur QR code, à toutes les injonctions à rentrer dans des conversations de groupe sur Whatsapp, Signal, Telegram…, de la famille, des ami·es, du travail, des collègues, des militant·es...
Ça illustre bien ce qu’on appelle « l'effet de réseau ». Plus il y a d'utilisateur·ices d'un service (messagerie, site de rencontre ou de vente d’occasion…), plus celui-ci est désirable et à même d'attirer de nouveaux·lles utilisateur·ices. Les messageries les plus utilisées le sont parce que tout le monde les utilise, ce qui renforce leur monopole... et la pression sur celleux qui ne l'utilisent pas[2].
Avant, même si me venait le désir de céder, d'utiliser la même messagerie que tout le monde – et me retrouver bombardé de notifications, sollicitant en permanence mon système de récompense jusqu'à me rendre accro[3] – je m'étais organisé pour que ça me soit impossible, ou difficile. Jusqu'à ce que mon intérêt économique, et ma peur d'être pris pour un con, me forcent à prendre cet abonnement.
Alors ça ne paraît pas grand-chose, et d'une certaine manière, ça n'est effectivement pas grand-chose. Je n'ai toujours pas Whatsapp et ne suis pas sur des conversations de groupe. Mais j'ai quand même ouvert la porte. J'utilise Internet de temps en temps, parfois plus, parfois moins. J'ai gardé certaines limites, mais d'autres ont été pulvérisées. Je vois par exemple, que quand je publie un article ou un post sur les réseaux sociaux, je ne peux pas m'empêcher de guetter les réactions, le nombre de « likes », de commentaires ou de partages. Étant comme la plupart des personnes accro à la validation sociale, je dois lutter contre moi-même pour ne pas utiliser ce moyen d'en récolter, et de renforcer mon addiction numérique.

Agrandissement : Illustration 1

Et je suis donc, petit à petit, de plus en plus intégré dans cette société numérisée, malgré mon choix actif de mettre des limites.
Vivre avec Internet ou mourir sans ?
Alors on me dira que j'avais et ai encore le choix. Je répondrai qu’au contraire c'est un exemple typique de manipulation des choix disponibles pour mieux orienter les comportements. Ici, mon choix de ne pas utiliser Internet (choix libre que je ne devrais pas avoir besoin d'expliquer, la Silicon Valley vantant à l'envi la liberté qu'elle apporte et défend[4]) est contraint par une certaine rationalité économique. Et le cynisme des fournisseurs d'accès : la dépendance à Internet et aux écrans étant de plus en plus reconnue, cela revient à favoriser les addictions, pour augmenter les profits[5]. On ne peut pas appeler cela un choix tant les coûts de refus rendent pénalisantes les tentatives de sobriété numérique.
Cela montre aussi à quel point le concept de liberté individuelle a du mal à s'appliquer dans ce genre de situations : c'est toute une organisation de société qui se joue là, plus qu'une question de choix individuels. Survivre dans cette société nécessite une connexion Internet : lorsque j'ai commandé un taxi pour accompagner ma compagne à la maternité, j'ai été obligé d'installer une application, parce que les standards téléphoniques sont maintenant obsolètes. Sans application, nous aurions dû trouver une autre solution, tout en gérant des contractions toutes les 10 minutes. Alors est-ce que je dois remercier ces fournisseurs d'accès de m'avoir donné l'opportunité d'installer l'appli, ou me plaindre que leur monopole ait supprimé les standards téléphoniques ?
Monopole radical : quand la technique détermine la politique
Internet a rendu possible un « monopole radical » de la technologie numérique. Ivan Illich développe ce concept selon lequel certaines technologies, passé un seuil de diffusion, deviennent incontournables et structurent la société. Leur diffusion est tellement massive qu'elles en viennent à « modifier, contrôler et à terme contraindre des populations à modifier radicalement leurs habitudes quotidiennes, notamment en restreignant leurs choix et leurs libertés »[6]. Au niveau collectif, les institutions, les modes de communication et de commerce en sont profondément transformés. Au niveau individuel, il devient impossible de s'en passer.
Illich prend l'exemple de la voiture en montrant comment celle-ci, au-delà du choix individuel d'en posséder ou simplement d'en utiliser une, structure entièrement l'espace. Les centres de consommation sont éloignés des centres de vie, les zones de travail éloignées des zones de loisir, obligeant en permanence chacun·e à prendre des transports mécaniques individuels ou en commun. L'espace public devient un espace de déplacement[7]. C'est toute l'organisation spatiale qui est modifiée, des villes comme des campagnes. Et donc l'organisation de nos vies, de notre temps, nos déplacements/communication/consommation[8].

Agrandissement : Illustration 2

Bien avant les débats autour de l’intelligence artificielle, la numérisation avait déjà bouleversé le monde du travail. Comme le montre Stéphanie Roza, c’est bien la numérisation qui permet de créer des chaînes de commandement et de production traversant les continents. On conçoit un produit aux États-Unis, on le produit en Chine à base de matières premières récoltées entre l’Inde, le Brésil et le Congo, avant de l’acheminer dans tous les continents. Il sera ensuite de nouveau renvoyé en Chine pour être recyclé, ou simplement jeté dans une décharge en Europe ou ailleurs. La mondialisation ne pourrait pas être aussi profonde sans le numérique, qui permet ces chaînes à flux tendus d’approvisionnement et de commandement d’une complexité folle. Avec comme conséquence concrète des délocalisations, des disparitions de métier – guichets dans les gares remplacés par des applis, traders remplacés par les algorithmes de « trading à haute fréquence »[9]…
Rester libre depuis son techno-cocon
L'environnement se numérise, à coups de QR code insérés dans l’espace public ou de Pokemon virtuels cachés dans des magasins, forçant chacun·e à s'adapter et à numériser, petit à petit, ses comportements. La contrainte est douce et se renforce par un discours mettant en avant le côté pratique et confort de ces produits/technologies, permettant ainsi de limiter les contestations et débats. Ces systèmes techniques nous entourent, "disparaissant dans la quotidienneté comme l'eau échappe aux yeux du poisson en étant son « élément ». "[10] Alain Damasio parlerait de ce technococon dans lequel on s'enferme, et depuis lequel on vend notre libre arbitre à des programmeurs et des publicitaires[11].
Un exemple pour mesurer la vitesse et la profondeur de ce processus est que l'on n'a même plus de mot pour désigner les « équipements que les smartphones ont remplacé dans l'usage et que l'on appelait autrefois « portables » »[12]... Dumbphone, téléphone à clapet, téléphone de dealer... En posséder un est devenu au mieux une bizarrerie, et au pire une preuve d'actions ou d'intentions illégales[13].
Assumer que les technologies sont un monopole radical plutôt qu'un choix individuel permet de déplacer les débats autour de leur régulation. Ce ne sont pas tant les usages individuels qui sont en cause que la philosophie derrière leur conception, et les modalités de leur diffusion. Le marketing, mais aussi la manière dont elles s'intègrent dans toutes nos institutions avec le concours actif de l'état – école, santé, services publics – et leur hégémonie culturelle ne sont que quelques exemples de la numérisation croissante de nos vies et de nos sociétés. L'action individuelle, bien que nécessaire, ne sera pas suffisante sans une prise en compte plus globale du numérique comme « fait social total ».
Cela pose aussi la question des moyens de la lutte. Peut-on encore, en situation de monopole radical, lutter contre les technologies numériques ? N’est-on pas obligé d’utiliser ces outils pour tenter de les détourner ? Est-ce qu’utiliser ces outils disqualifie la lutte ? La question est particulièrement complexe, quand on sait par exemple que Mozilla Firefox, le navigateur qui protège le mieux la vie privée, est financé en grande partie par Google pour lui éviter d’être démantelé pour monopole[14]…
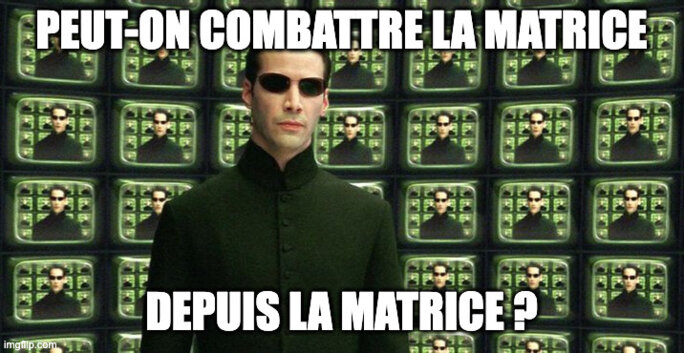
Agrandissement : Illustration 3
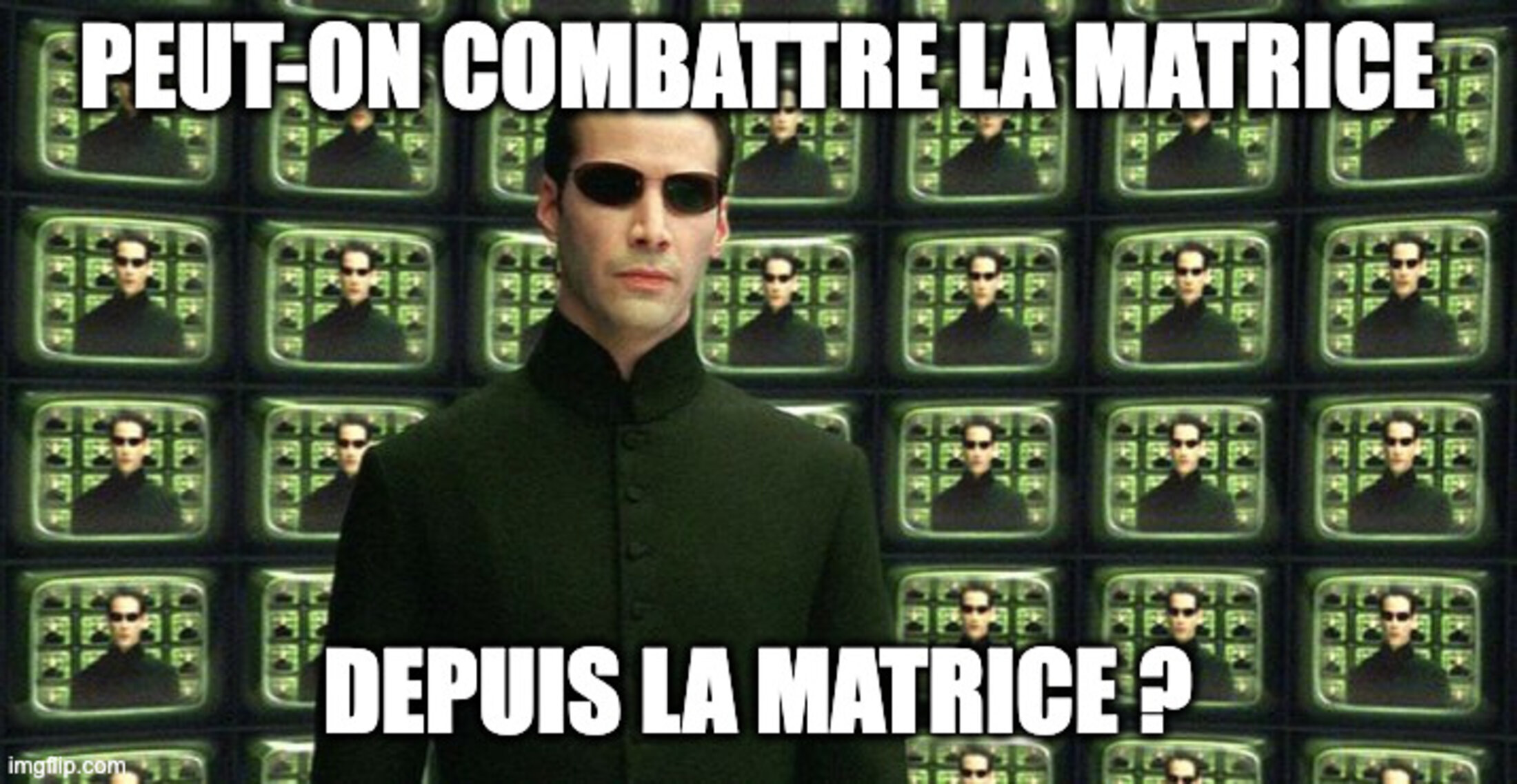
[1] « L’éthique serait un art d’agir préventivement sur la situation. Surtout, n’attendez pas d’être dans votre situation impossible, commencez par ne pas vous y mettre. » Gilles DELEUZE, Sur Spinoza. Cours novembre 1980-mars1981, éditions de Minuit, 2024, p. 132 voir aussi
[2] Jeanne GUIEN, Le consumérisme à travers ses objets, divergences, 2021, p. 150
[3] Léo FAVIER, Dopamine, Arte, 2023 https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/
[4] Eric SADIN, La Siliconisation du monde, L’échappée, 2015
[5] Voir cet article, détaillant la plainte de familles contre TikTok pour son interface addictive et les contenus poussant au suicide qui y sont diffusés et recommandés : Olivier MIMRAN, « TikTok : onze familles françaises ont porté plainte pour « risques d’addiction » contre l’application », 20minutes, 5 mars 2025 https://www.20minutes.fr/high-tech/by-the-web/4142146-20250306-tiktok-onze-familles-francaises-depose-plainte-risques-addiction-contre-application?utm_source=firefox-newtab-fr-fr
[6] Citation d’Ivan Illich, tirée de cet article de l’ADEME : « Qu’aurait pensé Ivan Illich du monopole radical des GAFA ? », ADEME, juillet 2014 https://transportsdufutur.ademe.fr/2014/07/quaurait-pense-illich-du-monopole-des-gafa.html
[7] Christelle BORTOLINI, « Pourquoi les villes les mieux adaptées aux enfants sont aussi les plus durables », The Conversation, 11 mars 2025 https://theconversation.com/pourquoi-les-villes-mieux-adaptees-aux-enfants-sont-aussi-plus-durables-251160
[8] Voir Ivan ILLICH, Énergie et équité, Arthaud poche, 1975
[9] Stéphanie ROZA, Marx contre les GAFAM. Le travail aliéné à l’heure du numérique, Presses Universitaires de France, 2024
[10] Bernard STIEGLER, Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou? Les Liens qui Libèrent, 2016 , p. 32
[11] Alain DAMASIO, Vallée de Silicium, Seuil, Villa Albertine, 2024, p. 102. Voir aussi sa conférence au TEDxParis du 16 octobre 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=cR0T5-a6YTc
[12] Jeanne GUIEN, Le consumérisme à travers ses objets, divergences, 2021, p. 152
[13] Marion BASTIT, « Vivre sans smartphone en 2024 : un quotidien semé d’embûches », Reporterre, 26 septembre 2024 https://reporterre.net/Vivre-sans-smartphone-en-2024-un-quotidien-seme-d-embuches
[14] Julia LAÏNAE, Nicolas ALEP, Contre l’alternumérisme, La Lenteur, 2023 [2020]



