Cet article est le premier volet d'une recherche sur Internet et l'extrême droite. Vous pouvez trouver le deuxième ici.
Le scandale Cambridge Analytica en 2016 a montré que Donald Trump diffusait des publicités micro-ciblées sur les réseaux sociaux, grâce aux données collectées sans le consentement des internautes1. Il vient de se faire réélire suite à une campagne dont le terrain principal a encore été la désinformation sur Internet2. Le soutien d'Elon Musk, patron de X (ex-Twitter) a été déterminant3, mais pas seulement. Des moyens énormes ont été déployés par les deux camps pour dénigrer leur adversaire sur Internet. Cette campagne montre l'influence d'Internet sur la politique actuelle, accentuant la personnalisation des campagnes au détriment des arguments proprement politiques. On est loin de l'image d'une « démocratie Internet », équivalent numérique de l'agora athénienne.
Le succès de Donald Trump, mais plus globalement des partis d'extrême droite partout dans le monde, pousse à se poser la question : est-ce qu'Internet, en favorisant ces campagnes de haine et de désinformation, favorise par défaut les groupes et discours d'extrême droite ?
C'est l'hypothèse que nous étudierons dans cet article. Nous verrons en particulier le rôle primordial de la publicité dans le financement des sites Internet. Celle-ci est, dans l'imaginaire collectif, symbole de consommation et d'une forme de légèreté. Elle peut être associée à des manipulations politiques – on se souvient des images de propagande des régimes totalitaires du siècle dernier – mais on imagine difficilement des réclames promouvant la fermeture des frontières ou la mise en prison d'opposant·es politiques.
On verra pourtant que le choix de la publicité ciblée comme modèle de financement par défaut des sites - pour augmenter les visites et les « clics » vers les bannières publicitaires - valorise les émotions telles que la peur, le mal-être, et l'isolement. Cela influence les règles de création et de diffusion de contenus, favorisant encore les valeurs et thématiques d'extrême droite (nationalisme, insécurité, immigration...) au détriment de celles associées à la gauche (écologie, inégalités sociales, éducation...). Ces émotions empêchent l'échange d'opinions de manière apaisée, menaçant le débat public à la racine.
Réfléchir aux émotions qui circulent sur Internet, aux valeurs qui y sont favorisées me semble important car on ne vote pas forcément pour des idées directement politiques. Comme le rappelle le sociologue Félicien Faury dans son livre Des électeurs ordinaires, la « politique » est ignorée en tant que telle par une grande majorité des citoyen·nes, et ce sont plutôt des ressentis, « un ensemble de goûts et de dégoûts sociaux, d'attachements et d'aversions », qui construisent des « visions du monde », dont une des « possibilités d'expression » est le vote ou l'engagement à l'extrême droite4.
Cet article se concentrera sur la manière dont l'organisation économique d'Internet favorise la circulation des idées et émotions favorables à l'extrême droite. Un deuxième article la semaine prochaine analysera la manière dont les partis d'extrême droite et groupes d'ultra droite réutilisent les techniques de communication propres au marketing et à la publicité pour promouvoir leurs idées sur Internet. Le but étant de toucher le « grand public », tout en profitant d'une « double identité » : un parti institutionnalisé reconnu, à la communication policée, qui profite de celle, plus radicale, des groupuscules d'ultra droite, unis dans les urnes malgré leurs divergences sur le terrain5.
Les discours d'extrême droite s'adaptent aux réalités locales et historiques, il est donc assez difficile d'en dégager une doctrine spécifique. On pourrait plutôt y trouver un ensemble d'affects, ainsi qu'un attachement nationaliste. Le chercheur Steven Forti les voit comme une "grande famille national-conservatrice". Sociologiquement, le vote extrême droite vient plutôt d'une peur ou d'une sensation de déclassement6. Bien que toutes les classes sociales votent à l'extrême droite (contrairement au cliché répandu disant que c'est un vote de « pauvres »), les classes moyennes basses sont celles où le vote extrême droite est le plus répandu7. En effet, ce sont celles qui ont quelques privilèges, souvent chèrement acquis, mais pas assez pour les mettre à l'abri des diverses coupes budgétaires et mesures d'austérité dues à quarante années de néolibéralisme.
Il sera ici beaucoup question de discours racistes, car le vote RN, et l'engagement à l'extrême droite en général, sont largement en lien avec le racisme. Qu'il se dise ouvertement – 82% des « personnes déclarant une proximité partisane avec le FN-RN » se déclarent « plutôt racistes » ou « un peu racistes »8 – ou qu'il soit caché sous les dehors de la lutte contre l'islamisme ou l'immigration. De fait, les politiques anti-immigration voulues par les partis d'extrême droite ciblent en grande majorité les populations non-blanches. On l'a vu de manière criante lorsque l'accueil des réfugié·es ukrainien·nes a été massif et très bien accepté par la population, même les militant·es d'extrême droite. De plus, les discours officiels ou plus informels tendent à utiliser les termes « migrant », « musulman », « turc », « arabe », « maghrébin » de manière interchangeable9.
On pourrait distinguer en France les mouvements d'extrême droite – dont l'objectif serait un succès aux élections afin d'appliquer des mesures sécuritaires et anti-immigration – des mouvements d'ultra droite, plus radicaux, qui refusent la logique parlementaire et tentent plutôt d'imposer dans l'espace public une parole anti-immigration, basée sur la peur d'un remplacement des populations européennes par celles venues d'autres continents.
Il est à noter que le terme extrême droite est critiqué pour sa connotation péjorative, renvoyant tous ses courants à un devenir nazi ou fasciste, sans prendre en compte leur diversité.
La genèse d'Internet : la publicité comme péché originel
Bien que né d'un programme militaire états-unien, l'ARPANET10, lancé en 1962, Internet a été développé grâce à la collaboration de nombreux scientifiques et apprenti-informaticien·nes à travers le monde, notamment le Français Louis Pouzin, qui travaillait sur le réseau Cyclades11. Il a aussi permis la rencontre de milieux très différents : les militaires états-uniens et les scientifiques, mais aussi des hippies technophiles comme John Barlow, ancien parolier du groupe The Grateful Dead12, des investisseurs internationaux, et des militants altermondialistes13. Tout cela a contribué à donner l'image d'une « république des informaticien·nes » originelle, proche de l'agora athénienne.
Le réseau a été ouvert au public à partir de 1991, avec la création du World Wide Web14. Les applications commerciales étaient alors interdites sur le réseau. L'internet servait surtout à des forums, des discussions en ligne, et n'était accessible qu'à peu de personnes, la technologie coûtant encore cher. C'est néanmoins le début de sa massification.
À partir de 1995, et l'ouverture aux applications commerciales, tout change. La technologie devient de plus en plus accessible, et les acteurs privés s'immiscent dans le jeu. Les sites cherchent à se professionnaliser, et essaient différentes manières de gagner de l'argent – abonnements, publicité, conseils en investissements, vente de produits dérivés... Il était à l'époque très difficile de créer une application rentable. Le 8 août 2002, Le New York Times titrait « Google peut-il créer un modèle commercial aussi bon que sa technologie ? »15 À cette époque, Google – maintenant la plus grande régie publicitaire du monde – refusait la publicité pour des raisons éthiques et politiques. Ses deux concepteurs, Sergey Brin et Larry Page, en avaient donné les raisons en 1998 :
Il est probable que les moteurs de recherche financés par la publicité favoriseront par essence les annonceurs, loin des besoins des consommateurs. Ce type de biais est très difficile à détecter mais pourrait tout de même avoir un effet.16
Malgré ces belles intentions, c'est finalement Google qui instaure le financement par la publicité comme modèle à suivre pour les autres sites. Après l'éclatement de la bulle financière d'Internet en avril 2000, les fondateurs de Google aux abois se tournent vers leur minuscule régie publicitaire, AdWords. La possibilité de cibler les annonces à partir de la récolte des données des utilisateur·rices, et la mesure, par le « taux de clics », de leur efficacité, rendent la publicité en ligne particulièrement intéressante pour les annonceurs. Devant le succès exponentiel de la publicité ciblée sur Google, passant d'un million de dollars de bénéfices en 2004, à dix milliards en 2010, les autres plateformes mettent elles aussi en place un système de collecte des données des internautes pour valoriser leurs espaces publicitaires17. En 2016, 98% des revenus de Facebook venaient de la publicité18.
Mis à part ses effets sociétaux négatifs19, la publicité a en effet tous les avantages économiques : les sites sont gratuits, ce qui ne nuit pas à leur fréquentation, et les annonceurs ont une visibilité beaucoup plus précise sur l'efficacité de leurs campagnes. Petit à petit, toutes les entreprises se lançant sur Internet utilisent ce modèle par défaut. C'est ce qu'Ethan Zuckerman, créateur repenti de la fenêtre « pop-up », appelle le « péché originel d'Internet »20.

Publicité et récolte des données : la ruée vers l'attention
De ce choix de modèle économique découlent de nombreuses caractéristiques structurelles de l'internet actuel. En effet, il implique une recherche de l'attention des internautes : plus ceux-ci passent de temps sur un site, plus ils sont exposés à des publicités, et plus les créateur·rices du site sont payé·es par les annonceurs. Georg Franck nomme la structure qui découle de ce choix « l'économie de l'attention », ou « capitalisme de l'attention ». Pour lui, « le financement par la publicité signifie toujours que l’espace public se transforme en un marché »21. Nous échangeons notre attention contre l'accès aux contenus des sites. Les créateur·rices des sites sont rémunéré·es par les annonceurs pour leur capacité à attirer et retenir notre attention.
Dans ce modèle économique, ce qui fait la valeur financière d'un site n'est donc pas la qualité des biens et services vendus, mais le temps passé par les internautes sur celui-ci. La précision du ciblage est aussi valorisée, permettant d'envoyer des annonces plus « pertinentes ». Plus les annonces sont ciblées, plus elles mènent à un nombre de « clics » important voire d'actes d'achats ; plus le prix des espaces publicitaires sera donc élevé. Il faut alors récolter le plus de données possibles sur les internautes, pour adapter l'architecture des sites et garder le plus longtemps possible l'attention des internautes. Si possible en les mettant dans un état d'esprit propice à l'achat. Ce qui est vendu par les sites n'est donc pas un contenu à destination des internautes, mais bien l'attention des internautes à destination des annonceurs.
Pour trouver les moyens techniques de réaliser ces ambitions, c'est tout un pan de la recherche scientifique qui est financé par les GAFAM22, dans l'optique d'étudier les différentes qualités de notre attention et les manières de les influencer. « Ce qui fait dire à un ancien employé de Facebook : « les meilleurs esprits de ma génération réfléchissent à la manière de faire cliquer les gens sur des bannières publicitaires, et ‘ça craint vraiment’. »23
La série documentaire « Dopamine »24 produite par Arte présente plusieurs exemples de ces stratégies mises en place pour rendre « accro » les utilisateur·rices d'applications, toutes ayant pour but d'activer la production de dopamine. Cette hormone responsable du plaisir et de la motivation joue sur les mécanismes « primitifs » de notre corps et notre cerveau, ainsi que les biais cognitifs25. Elle développe des addictions ou des comportements obsessionnels contre lesquels on ne peut se défendre que très difficilement.
Le choix d'ignorer les publicités ne protège en aucune manière, comme le montrent les études de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, chercheurs en psychologie sociale. Ils montrent qu'une publicité à laquelle on ne prête pas attention s'implante quand même dans notre inconscient, influençant notre comportement et nos choix jusqu'à plusieurs semaines après. « C'est dire les conséquences que peuvent avoir les publicités qui apparaissent sur notre écran, lorsque nous naviguons sur le net, ces publicités auxquelles nous ne prêtons pourtant, le plus souvent, aucune attention »26.
C'est donc en cultivant des émotions négatives pour le bien-être individuel que les créateur·rices de sites et d'applications entendent nous faire acheter. « Si c'est gratuit, vous êtes le produit », dit un slogan du mouvement antipub. Selon Nir Eyal, neuroscientifique auteur d'un modèle pour rendre accro à une application, « les émotions, en particulier celles qui sont négatives, sont de puissants déclencheurs d'actions. Les sentiments d’ennui, de solitude, de frustration, de confusion et d’indécision induisent souvent une légère souffrance ou irritation, provoquant un réflexe presque instantané pour atténuer cette sensation négative »27. Le but recherché est ici de profiter des micro-souffrances du quotidien pour proposer, au moment précis où notre corps réclame un palliatif, un bien ou service à acheter. Ceci au mépris des effets sociétaux négatifs (achats compulsifs, endettement, impacts sur le sommeil, troubles de la sociabilité...).

Agrandissement : Illustration 2

Les recherches de Facebook vont dans ce sens, comme nous l'apprend Frances Haugen, lanceuse d'alerte ancienne employée de l'entreprise, pour qui les algorithmes de recommandation « hyperamplifient les contenus négatifs »28, c'est-à-dire ceux qui jouent sur des affects comme la tristesse, la colère, la peur. Ces émotions ont un impact sur la santé – les travaux sur la surcharge cognitive pointent très souvent la responsabilité de l'internet et notamment des téléphones portables et notifications – mais aussi, de manière collective, sur la démocratie.
Les inégalités d'attention, capitaliser sur le malheur des internautes
Le Wall Street Journal a publié en 2021 des documents internes de Facebook. Ils montrent sans ambiguïté qu'Instagram a des effets négatifs sur la santé mentale de ses utilisateur·rices, notamment chez les jeunes : « plus les ados vont sur Instagram, plus leur bien-être général, leur confiance en soi, leur satisfaction à l’égard de la vie, leur humeur et l’image qu’ils ont de leur corps se dégradent. Une étude a montré que si les étudiants utilisaient davantage Instagram un jour donné, leur humeur et leur appétit de vivre étaient au plus bas ce jour-là. »29 Les mécanismes de comparaison sociale sont notamment en cause, sur ce réseau où circulent en majorité des photos d'influenceur·ses retouché·es.

Agrandissement : Illustration 3

Cela s'ajoute aux inégalités d'attention entre les internautes : « 95% de nos navigations se dirigent vers 0,03% du contenu disponible. »30 69% des contenus qui sont postés en ligne n'étaient jamais vus en 201931. Ces statistiques montrent un abîme effarant entre les internautes qui donnent de l'attention et ceux qui en reçoivent. Ces inégalités d'attention s'ajoutent aux inégalités économiques, et à l'ambiance anxiogène qui règne sur les réseaux sociaux. C'est en jouant sur le malheur et le manque d'estime de soi que le capitalisme de l'attention assoit sa domination. Et les perdant·es à ce jeu sont nombreux·ses.
Si ce mal-être peut être bon pour l'économie, il ne l'est ni pour la santé publique, ni pour la démocratie. Pour Georg Franck, les victimes sont celles et ceux qui « en très grand nombre, prêtent toujours attention et considération, mais n'en reçoivent guère en retour », les poussant au désespoir avec pour conséquence des réflexes d'autodéfense identitaire violents.
Les souffrances liées au déficit d’estime de soi peuvent être aussi douloureuses que l’indigence physique ; la soif de reconnaissance peut rendre aussi agressif qu’un estomac vide. Le désir d’humilier ceux qui refusent de nous accorder le respect dont on a besoin pour sa propre estime de soi est à l’origine des violences terroristes auto-sacrificielles contre différents symboles de la culture d’exportation occidentale. Il permet par ailleurs de rendre compte des ressentiments que manipulent les mouvements populistes de droite, ainsi que de la violence démonstrative ou des symboles nazis que le lumpenprolétariat utilise pour attraper le peu d’attention qu’il ne pourrait autrement jamais recevoir dans l’économie de la considération.32
En transformant les inégalités économiques et culturelles en inégalités d'attention, cette avalanche d'émotions négatives dépossède celles et ceux qui n'en avaient pas du peu qui leur restait, leur estime de soi. Elle en fait, pour reprendre les mots de Judith Butler, des « sans deuils », des vies « qu'on considère déjà comme des non-vies, ou comme partiellement en vie, ou comme déjà mortes et perdues d'avance, avant même toute forme de destruction ou d'abandon »33.
Cette violence subie pousse à un désespoir de plus en plus grand. Ce qui est semble-t-il bon pour les affaires des GAFAM, mais a un effet négatif sur la vie démocratique.
Choix économiques, conséquences politiques
Car les partis politiques sont aussi soumis à cette logique de la concurrence de l'attention. Afin d'être non pas mis en avant, mais simplement rendus visibles par les réseaux sociaux, il leur faut correspondre à ces standards, et créer des posts ou contenus mettant en avant des émotions négatives. Frances Haugen explique comment cette logique modifie la communication des partis politiques, même les plus modérés. Ceux-ci sont obligés, pour être rendus visibles, de publier du « contenu négatif, haineux, polarisant ou qui divise »34, sous peine d'être invisibilisés par les algorithmes.
Ce contexte est un piège pour les partis les plus modérés, qui sont incités à augmenter la proportion de contenus négatifs dans leur communication. Malgré eux, bien souvent, ils légitiment ainsi des positions plus extrêmes que les leurs et participent à la décohésion sociale.35
Cette accentuation des émotions « négatives » a un effet sur les affects politiques des citoyen·nes. Et donc sur les idées et les votes. Cela crée un terrain de frustrations, une sensation d'impuissance, de peur et d'isolement. Celles-ci sont justement les émotions sur lesquelles se construisent les idées et votes pour l'extrême droite. Eva Illouz dans son essai, Les émotions contre la démocratie, écrit que ces sentiments s'inscrivent dans la « psyché politique, pour devenir partie intégrante de leur identité et de leur constitution émotionnelle. »36 Ces émotions créent des espaces « remplis de projections et de scénarios émotionnels qui ne manquent pas d'encourager des interprétations paranoïdes de la vie politique et sociale. »37
En cela, elles soutiennent les idées d'extrême droite, notamment cette sensation d'envahissement dont parlent régulièrement les enquêté·es de Félicien Faury. Cette sensation a été théorisée sous le nom de « théorie du grand remplacement » par Renaud Camus. Elle a été médiatisée dans le grand public suite à l'attentat terroriste de Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande qui a fait 49 mort·es38, et fait désormais partie intégrante des discours d'extrême droite, voire de droite39.
Médias numériques : produire de l'info pour les plateformes ou les internautes ?
Le vote n'est pas uniquement déterminé par des choix idéologiques. Il l'est aussi et surtout par une « vision du monde ». Celle-ci vient plutôt des relations sociales, ou des informations auxquelles on est exposé·e. D'où l'importance des médias dans le processus démocratique, et de leur « pluralisme ». En donnant la parole à différentes opinions, ou en diversifiant les faits qui sont présentés, ceux-ci permettaient « d'exposer les individus à des points de vue différents des leurs »40. Les faits sont la base sur laquelle se construisent les opinions. L'ère des médias dits « de masse » permettait ainsi d'avoir des faits communs à partir desquels débattre.
L'arrivée des plateformes a modifié en profondeur la manière dont nous cherchons les nouvelles. Nous passons désormais par Google, Facebook ou YouTube pour nous informer. Afin d'être visibles par les internautes, les médias se retrouvent dans l'obligation d'adapter leurs contenus aux standards de ces plateformes. Ils mettent donc en avant des contenus choquants, clivants, qui sont ceux qui attirent le plus les interactions. Face à ces impératifs économiques, la véracité des informations mises en avant est secondaire. Comme l'écrit David Chavalarias, directeur de recherches au CNRS :
Il est à peine exagéré de dire que le fil d'actualité de Facebook est devenu l'une des sources d'information les plus influentes de toute l'histoire de l'humanité. En 2021, le réseau social aux 2,8 milliards d'utilisateurs est plébiscité par 61% des Terriens ayant accès à Internet et plus de la moitié d'entre eux le consultent au moins une fois par semaine pour s'informer sur l'actualité. […] Facebook ne le fait pas de manière passive : l'information que chacun est amené à voir est soigneusement sélectionnée par un algorithme en constante évolution.41
Les contenus journalistiques et les informations sont incités à aller vers de plus en plus de sensationnalisme et d'émotions négatives, pour s'adapter aux nouvelles contraintes économiques. Les contenus sont simplifiés et chargés émotionnellement pour attirer le plus possible de clics42. Il n'y a d'ailleurs même plus besoin d'avoir une information pour créer un contenu journalistique, il suffit d'un bon titre et d'une illustration attirante. C'est une logique qui était déjà à l'œuvre dans les médias traditionnels, mais qui se perpétue et s'amplifie dans les médias numériques. Ainsi, une étude du New York Times de 2016 estimait que, grâce à ses saillies choquantes, Donald Trump avait bénéficié de l'équivalent de deux milliards de dollars de publicité gratuite. Les médias (traditionnels et numériques) reprenant ses prises de position absurdes ou choquantes pour les critiquer certes, mais lui donnaient tout de même de la visibilité43. C'est une technique publicitaire classique nommée le shockvertising (mélange de « shock » et « advertising » - publicité).

Agrandissement : Illustration 4
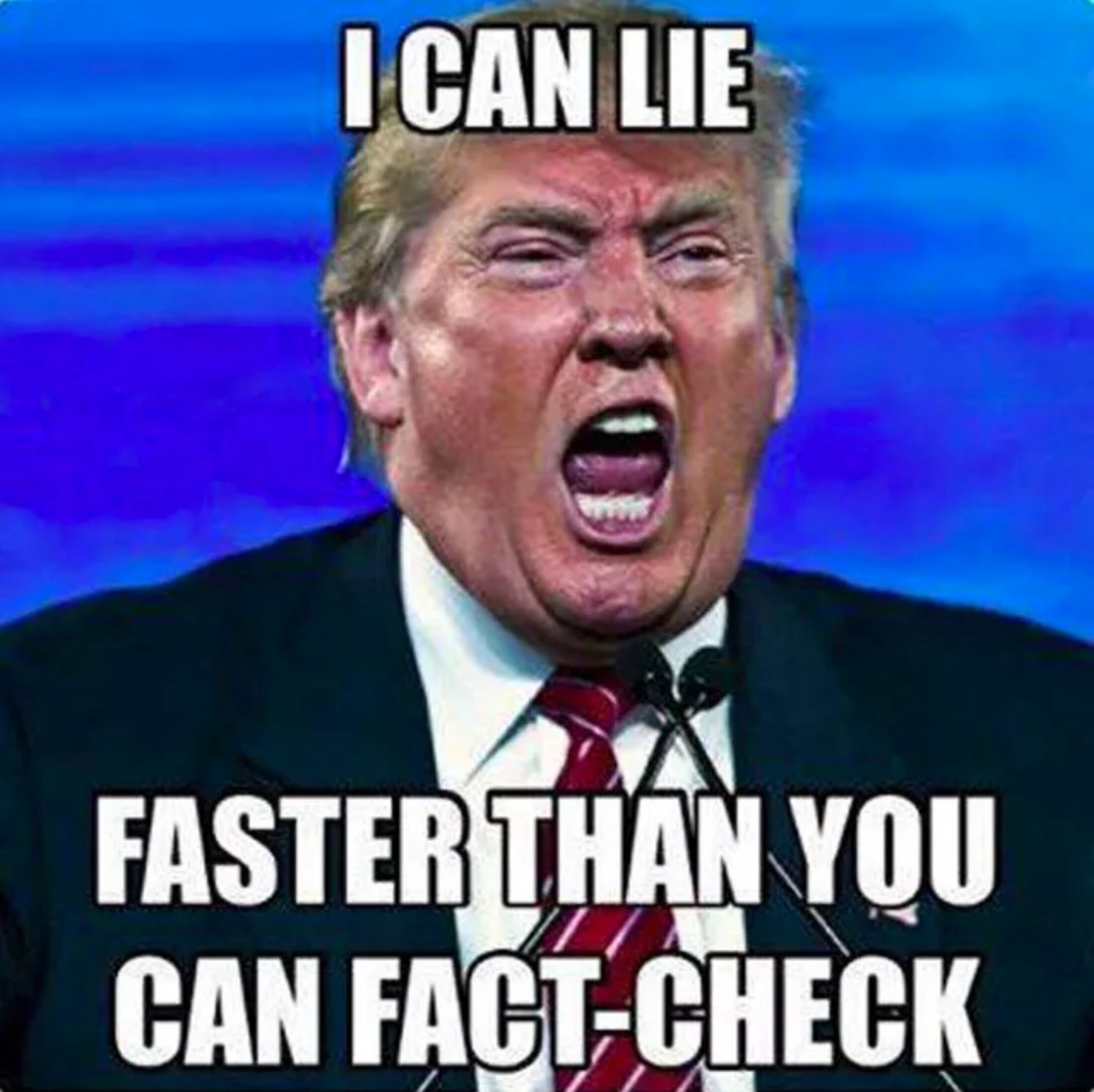
L'exemple extrême de cette logique est « Shape », l'algorithme rédacteur en chef du journal Melty, qui analyse les sujets générant le plus d'intérêt sur les réseaux sociaux afin de déterminer lesquels traiter44. Qu'il y ait une nouvelle ou pas.
Les dispositifs de discussion et de commentaires des médias numériques ne favorisent ni la nuance ni les argumentations rationnelles et sourcées, encore moins un dialogue constructif aboutissant à une compréhension commune, ou un accord sur une proposition synthétisant les positions45. Sur Twitter, les messages ont été limités pendant longtemps à 140 caractères, limite qui a depuis doublé pour en atteindre 280. Ce paragraphe qui ne présente qu'un seul argument d'un raisonnement plus large, en compte plus de deux fois plus (730). Commenter l'actualité se résume ainsi généralement à des invectives ou à des prises de position caricaturales permettant plutôt de s'affirmer personnellement que des analyses ouvertes à discussion46.
Ciblage des messages politiques : vers une obsolescence du débat
Le ciblage des publicités pousse cette logique encore plus loin. Les plateformes offrent en effet aux annonceurs la possibilité de cibler très précisément les publicités. Facebook propose pas moins de 250 000 attributs pour choisir le public-cible d'une campagne47. Cela permet d'envoyer des messages qui correspondront au maximum à nos préférences, et à nous mettre dans l'état le plus propice à cliquer sur la publicité, puis à acheter. Les publicités sont « pertinentes », c'est-à-dire qu'elles augmentent la probabilité que nous achetions quelque chose dont nous ne pensions pas avoir besoin quelques minutes plus tôt.

Agrandissement : Illustration 5

D'où la proposition des plateformes d'estimer notre état psychologique à tout moment, pour cibler pas seulement la bonne personne, mais aussi le bon moment, celui où nos défenses sont au plus bas.
Des documents internes de Facebook […] ont révélé que la compagnie vantait aux annonceurs sa capacité à identifier les moments clés où les adolescents se sentent « peu sûrs d'eux », « sans valeur », ou « ont besoin d'un coup de pouce pour avoir confiance en eux ». [...] Des indications qui sont très précieuses lorsqu'il s'agit de vendre des produits, puisque ces états émotionnels favorisent les achats compulsifs.48
Ainsi, c'est quand nous sommes les plus vulnérables que Facebook propose de nous envoyer des publicités qui contourneront notre libre arbitre et nous pousseront à acheter pour compenser le mal-être dans lequel nous plonge notre fréquentation des réseaux sociaux. Outre le cynisme effarant d'une telle proposition, elle pose des problèmes très graves pour la démocratie.
Car les messages publicitaires ne vendent pas uniquement des produits, mais aussi des messages politiques. C'est le rêve de tout parti démagogique : chaque personne recevant un message différent, il n'est plus possible d'avoir une vue d'ensemble d'un discours, et donc d'en contester les propositions. Encore moins d'argumenter. « Puisque personne n'a de vision globale du discours, la stratégie qui consiste à dire aux citoyens ce qu'ils veulent entendre ne court plus le risque d'être mise face à ses incohérences »49.
Supercherie facile à démasquer à partir du moment où les internautes discutent entre eux, et commentent ces contenus lors d'échanges. Or c'est précisément ce qu'empêche la fréquentation des réseaux sociaux : la violence des débats sur Internet rend de moins en moins probables les discussions politiques interpersonnelles. Des études ont montré que « 59% [des personnes qui avaient eu des interactions politiques sur Internet] estimaient [qu'elles] avaient été « stressantes et frustrantes », et 64% que ces interactions leur avaient donné l'impression d'avoir moins de choses en commun avec leurs interlocuteurs qu'elles ne le pensaient »50. Pour expliquer cette angoisse à débattre de politique en ligne, on peut penser à la culture du « clash », où les messages envoyés ne le sont pas pour convaincre l'autre, mais pour le vaincre, à base d'attaques ad hominem et d'ironie.
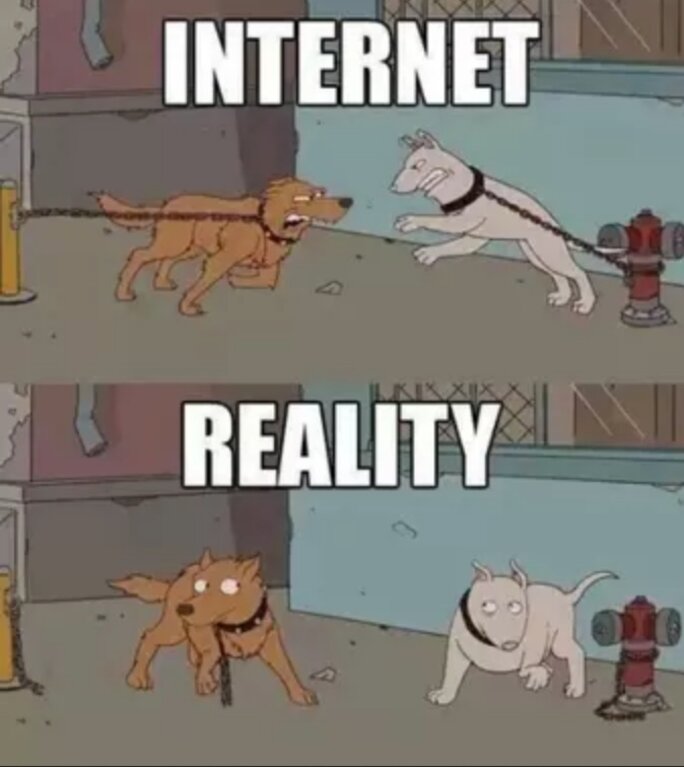
Agrandissement : Illustration 6
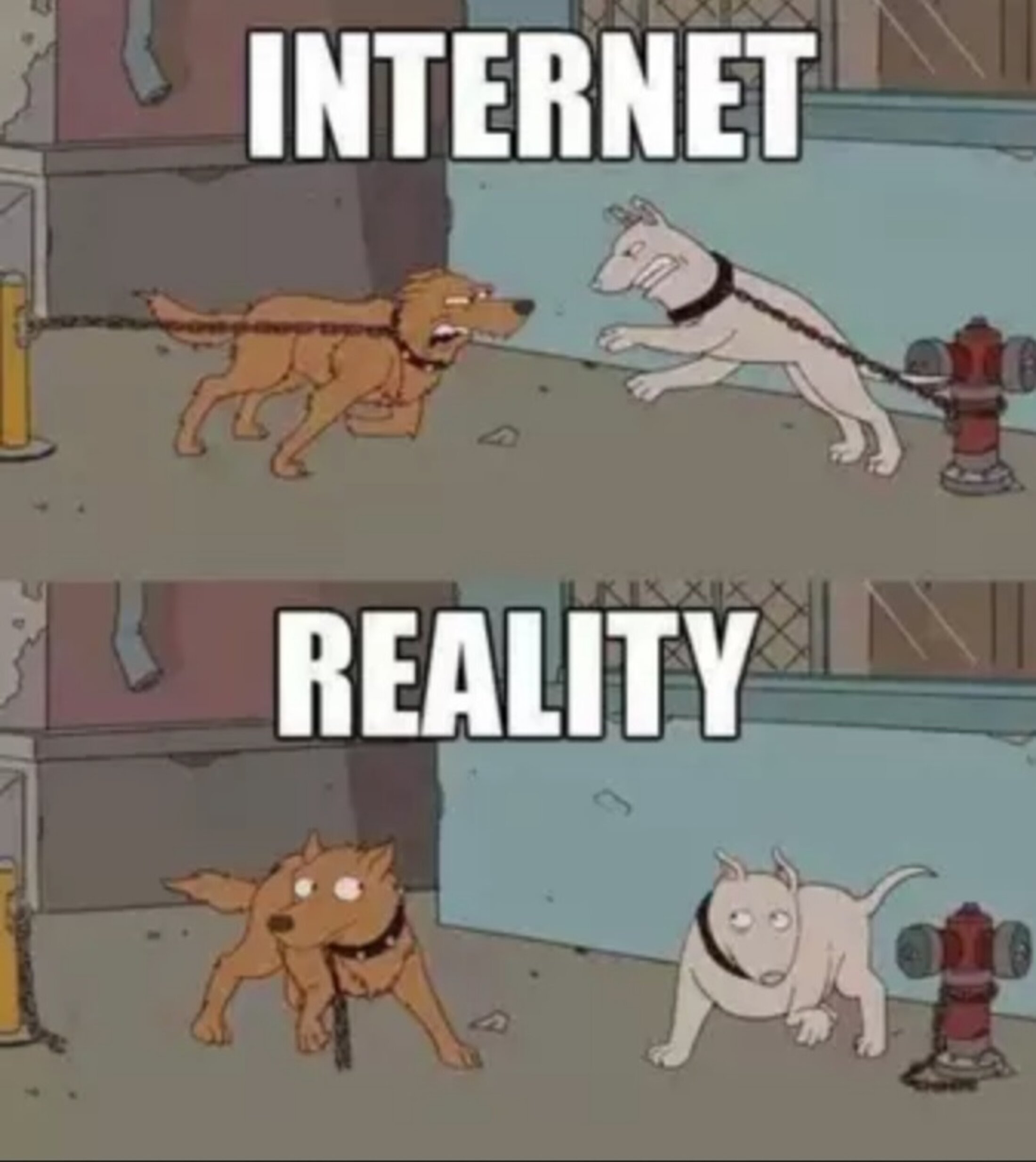
David Chavalarias insiste sur le fait que ces perceptions ont un effet direct sur les débats IRL (« In Real Life », dans la vie non-numérique) en les inhibant, précisément à cause de cette sensation de différences impossibles à dépasser.
Un propos extrême trouvera toujours quelques personnes pour y réagir ; comme ce post attirera l'attention, il sera mis en avant par les algorithmes, recevra encore d'autres réactions, sera encore mis en avant, etc. prenant la place des posts plus constructifs. Il est de plus difficile, avec le peu d'informations qui nous sont accessibles en ligne, de déterminer si la personne qui fait irruption dans notre forum/blog/jeu en ligne est un troll51, un·e militant·e d'extrême droite, ou les deux52. De nombreux internautes se réfugient donc dans l'abstention, et cessent de discuter politique. Ce qui bénéficie encore à l'extrême droite.
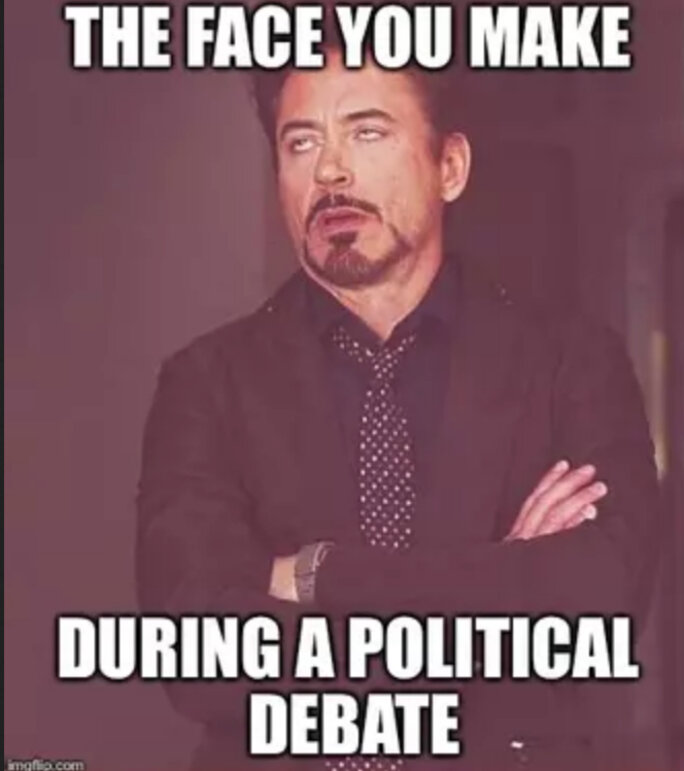
Agrandissement : Illustration 7

La manipulation peut ainsi passer inaperçue. Pour gagner une élection, il suffira de diffuser des messages disant Rouge à l'un·e, et Bleu à l'autre, selon les données récoltées. Voter pour un·e candidat·e ou un parti ne signifie plus adhérer à un projet mais simplement avoir une impression favorable (ou la moins défavorable possible) d'un·e candidat·e. Ceci n'est pas uniquement dû à l'internet, le système néolibéral international laissant de moins en moins de marge de manœuvre aux élu·es une fois au pouvoir53. Mais cette tendance est renforcée par les mécanismes que nous venons de citer.
Ainsi, Kamala Harris a ciblé des utilisateur·ices de Facebook en leur envoyant des vidéos, expliquant ses positions sur la guerre entre Israël et le Hamas. Selon les régions, le montage insistait sur sa solidarité avec les souffrances du peuple israélien, ou sa condamnation de la violence de l'armée israélienne54.
Cette nouvelle organisation médiatique permet aux partis de faire de la publicité sans être limités par les lois sur le pluralisme. « L'issue d'un scrutin est en grande partie déterminée par la perception qu'ont les citoyens des grands enjeux du moment. Or la publicité vise précisément à influencer les perceptions »55. Un message remettant en cause l'origine humaine du changement climatique ou montrant un faits divers impliquant des migrant·es ne sera pas comptabilisé en France comme une publicité politique, et ne comptera donc pas dans le décompte en période électorale. Or cette publicité favorisera les partis d'extrême droite.
Ce sont des techniques qui sont utilisées par les partis nationalistes du monde entier. Ainsi, le moine Wirathu, leader bouddhiste particulièrement virulent envers les musulman·es, diffuse en Birmanie des DVD montrant des violences, supposées faites par des musulman·es56. Cela permet de créer un certain climat de méfiance ou de tension, et d'imposer son islamophobie comme une thématique acceptable, et ce jusque dans les institutions étatiques. Cette stratégie est classique à l'extrême droite. Charles Maurras, figure royaliste et antisémite, écrivait déjà en 1900 : « Nous conspirons a créer un état d'esprit »57.
Tout cela explique pourquoi dans le top 12 des comptes les plus suivis en 2021, il n'y en avait qu'un qui n'est pas directement affiliée à l'extrême droite. « Mis à part un compte anonyme qui se décrit comme un « compte d'actualité opposé au pouvoir en place », et Florian Philippot, ex-numéro 2 du Front National qui arrive en deuxième place, toutes les personnalités politiques de ce classement sont d'extrême droite et pro-Zemmour. Quasiment toutes ont pris ouvertement des positions en faveur de la politique de Vladimir Poutine. »58
Le parti qui utilise le plus la publicité ciblée en France est le Rassemblement National. Marine Le Pen a dépensé 25 000 euros, Jordan Bardella 30 000, et la page du parti 15 000, en publicités ciblées sur Facebook entre avril 2019 et janvier 202159.
Conclusion : prendre soin de l'espace public
Les grandes entreprises d'Internet, poussées par la recherche de financements publicitaires, organisent leurs sites de manière à valoriser des affects de peur, de ressentiment et d'impuissance. Cela leur permet d'augmenter leurs recettes publicitaires, au fur et à mesure que nous surconsommons pour compenser nos souffrances quotidiennes.
Une des conséquences indirectes est un terrain favorable au vote d'extrême droite. Les réalités sociales difficiles que vit une grande partie de la population sont augmentées des affects négatifs qui sont diffusés sur Internet. Les partis d'extrême droite se basent sur ces affects, les ressassent, les amplifient, pour mieux imposer leurs solutions : plus de sécurité, criminaliser l'immigration, revenir à un ordre ancien jugé meilleur60. Et Internet valorise leurs contenus, car ils font réagir, amenant plus de trafic, et donc de recettes publicitaires. En surreprésentant des faits divers violents, Internet normalise cette violence. En valorisant les contenus clivants (souvent complotistes ou racistes), il donne une direction à cette colère.
La publicité ciblée montre de plus la fin d'un espace public réellement politique. Les espaces sont polarisés, hystérisés, et les sympathisant·es d'idées dites de gauche ont de moins en moins de chances d'interagir avec des sympathisant·es d'idées dites de droite. Encore moins que ce peu d'interactions soit constructif. Cela fait encore le jeu de l'extrême droite, qui utilise ces dissensions pour augmenter la radicalité des ses propositions. De plus, en mettant l'accent sur la colère plutôt que sur l'empathie, il devient moins condamnable moralement de proposer des solutions violentes et excluantes. On revient à cette normalisation de la violence à l'oeuvre sur les réseaux sociaux61. Plus simple de dire « chacun ses problèmes ». Plus compliqué de prendre en compte des problèmes globaux à cause du manque de complexité des contenus sur Internet.
En mettant l'accent sur les émotions négatives plutôt que sur une compréhension des points de vue différents, les géants d'Internet et les partis d'extrême droite font la même chose : détruire l'espace public.
Alors, l'exemple de TAY62 est-il notre devenir sur l'internet ? TAY est un agent conversationnel : une IA dont le but est de converser avec les internautes. Elle a été lancée sur Twitter le 23 mars 2016 à 5h14, puis retirée le 24 mars à 18h, suite à de nombreux tweets appelant à une guerre raciale, à brûler les féministes, à voter pour Donald Trump et à prêter allégeance à Hitler... Les chercheur·ses ont déclaré que l'expérience avait été ratée car TAY avait été victime d'attaques de trolls d'extrême droite. C'est le cas. Mais l'expérience en est-elle pour autant ratée ? Est-ce que cela ne nous en apprend pas tout autant sur ce qu'est Internet ? Selon Pacôme Thiellement, « TAY a évolué sur Twitter comme n'importe quel être humain en ligne, mais sans les restrictions qu'aurait apportée une connaissance des comportements appropriés »63
<img data-asset="

Agrandissement : Illustration 8

Pour imaginer un agent conversationnel qui se développerait de façon « civilisée » sur les réseaux sociaux, il faudrait imaginer un réseau social qui encouragerait lui-même un comportement civilisé entre les hommes. Il faudrait également imaginer une humanité épanouie, capable de vivre et d'agir librement, sans cette addiction à l'attention qui nous met violemment en concurrence sur les réseaux sociaux, et favorise les comportements les plus agressifs et les plus dégradants. Or rien n'est moins évident dans un monde capitaliste, c'est-à-dire un réseau social avant tout défini par la maximisation des profits pour ses producteurs et la concurrence pour ses utilisateurs.64
La question qui se pose alors est si la fréquentation des réseaux sociaux, des sites basés sur la captation de notre attention et la vente de nos données, ne pousse pas nos sociétés vers des régimes autoritaires et un effondrement progressif des régimes démocratiques. La montée de l'extrême droite sur l'internet et dans les urnes en serait un signe avant-coureur, un avertissement. Elle est en tout cas le signe que le « climat politique » change.
C'est l'hypothèse que pose David Chavalarias :
Les infrastructures numériques mondialisées de gestion des données sociales et de marchandisation de l'influence sociale sont des éléments de stabilité des États totalitaires, et des facteurs d'instabilité des démocraties.
En l'état actuel des choses, les régimes démocratiques ne peuvent donc qu'être des régimes transitoires vers des démocraties illibérales, voire des régimes totalitaires, seuls régimes politiques stables sous l'économie numérique de l'influence sociale.65
Que faire alors ? Comment changer ces structures ? Le problème semble insoluble tant les moyens déployés par les GAFAM sont gigantesques, tant ceux-ci se sont imposés comme des acteurs indispensables de la vie politique, et tant les débats techniques semblent hors de portée de simples citoyen·nes. Mais c'est précisément ce sentiment d'impuissance qui avantage les GAFAM. C'est cette sensation de ne pas être important, que notre voix ne compte pas, qui nourrit l'extrême droite autant que les grandes plateformes d'Internet.
Une ligne qui pourrait guider la réflexion sur le sujet serait celle du soin à apporter à l'espace public66. Avoir pour objectif de créer des conditions et des espaces propices à la discussion, aux débats permettant l'intégration du plus grand nombre de paroles, tout en créant la possibilité d'un tri et d'une synthèse la plus neutre et inclusive possible67. Pour Hannah Arendt, l'opinion ayant la plus grande validité est celle qui « prend en compte le plus grand nombre d'opinions »68.
C'est ce qui a été rendu possible lors de la Commission Citoyenne pour le Climat (CCC), où 150 citoyen·nes ont été tiré·es au sort pour réfléchir ensemble sur des mesures alliant écologie et lutte contre les inégalités. Tout un dispositif avait été mis en place pour permettre de prendre les décisions les plus éclairées possibles. Premièrement, le temps : le processus de réflexion et de débat a duré 9 mois, au terme desquels les propositions étaient votées en plénière. Les citoyen·nes ont aussi été divisé·es en 5 commissions thématiques69. Celles-ci devaient, à la fin du processus, faire une synthèse de leurs mesures et de leurs réflexions pour les présenter aux autres groupes, qui validaient ou non ces décisions par un vote. Enfin, les citoyen·nes ont reçu des paroles d'expert·es sur les sujets qui les concernaient, tout en ayant la possibilité de choisir elles-mêmes les expert·es (personnalités politiques, scientifiques, entrepreneur·euses, militant·es...) à auditionner. Cela leur permettait de recevoir des avis parfois divergents, venant de toutes sortes de milieux, et d'arbitrer en connaissance de cause. Enfin, un ensemble de conseiller·es juridiques était à leur service pour leur permettre de traduire en projets de lois et amendements leurs propositions.
Tout cet encadrement du débat, fait pour informer sans orienter (l'organisme chargé de l'organisation n'était pas relié au gouvernement et a d'ailleurs dû faire face à quelques pressions du ministère), et laissant l'initiative aux citoyen·nes malgré un calendrier rigide, a permis un débat éclairé et donné lieu à des propositions particulièrement intéressantes, qui prenaient en compte la réalité concrète des citoyen·nes, en même temps que les objectifs plus globaux de lutte face aux changements climatiques.
Malheureusement, les propositions ont toutes été soit ignorées soit vidées de leur substance par Emmanuel Macron et son gouvernement70. Les membres de la Commission Citoyenne pour le Climat ont jugé les applications de leurs mesures « insuffisantes et parcellaires », et pointent l'influence des lobbies71.
Malgré le coup de communication, cette expérience montre qu'avec des structures adaptées et pertinentes, une confrontation de points de vue peut réellement permettre d'atteindre à une plus grande objectivité collective, et une vie démocratique saine et inclusive. Pour Eric, membre de la commission « Consommer », cette expérience a été fondatrice, tant au niveau politique que personnel, lui faisant rencontrer des gens d'autres origines sociales et vivant d'autres réalités, tout en le forçant à s'entendre et à composer avec elles72. Le bilan des membres de la CCC souligne « une superbe expérience humaine et démocratique […], une démonstration au grand public […] des vertus de l’intelligence collective »73.
Des législations commencent à exister en ce sens, comme le « Digital Services Act », une législation européenne entrée en vigueur le 17 février 2024 qui limite l'influence des GAFAM74. Un prochain texte est en préparation pour le renforcer. Il serait bon que les prochaines prennent en compte les problématiques que nous venons de soulever, sans quoi il est probable que la pénétration de plus en plus profonde de l'internet dans nos sociétés mette en péril la possibilité même de la démocratie.
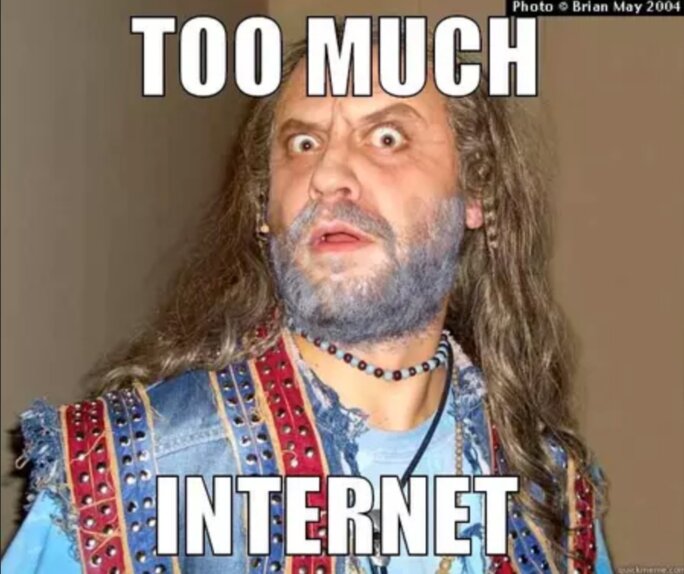
Agrandissement : Illustration 9
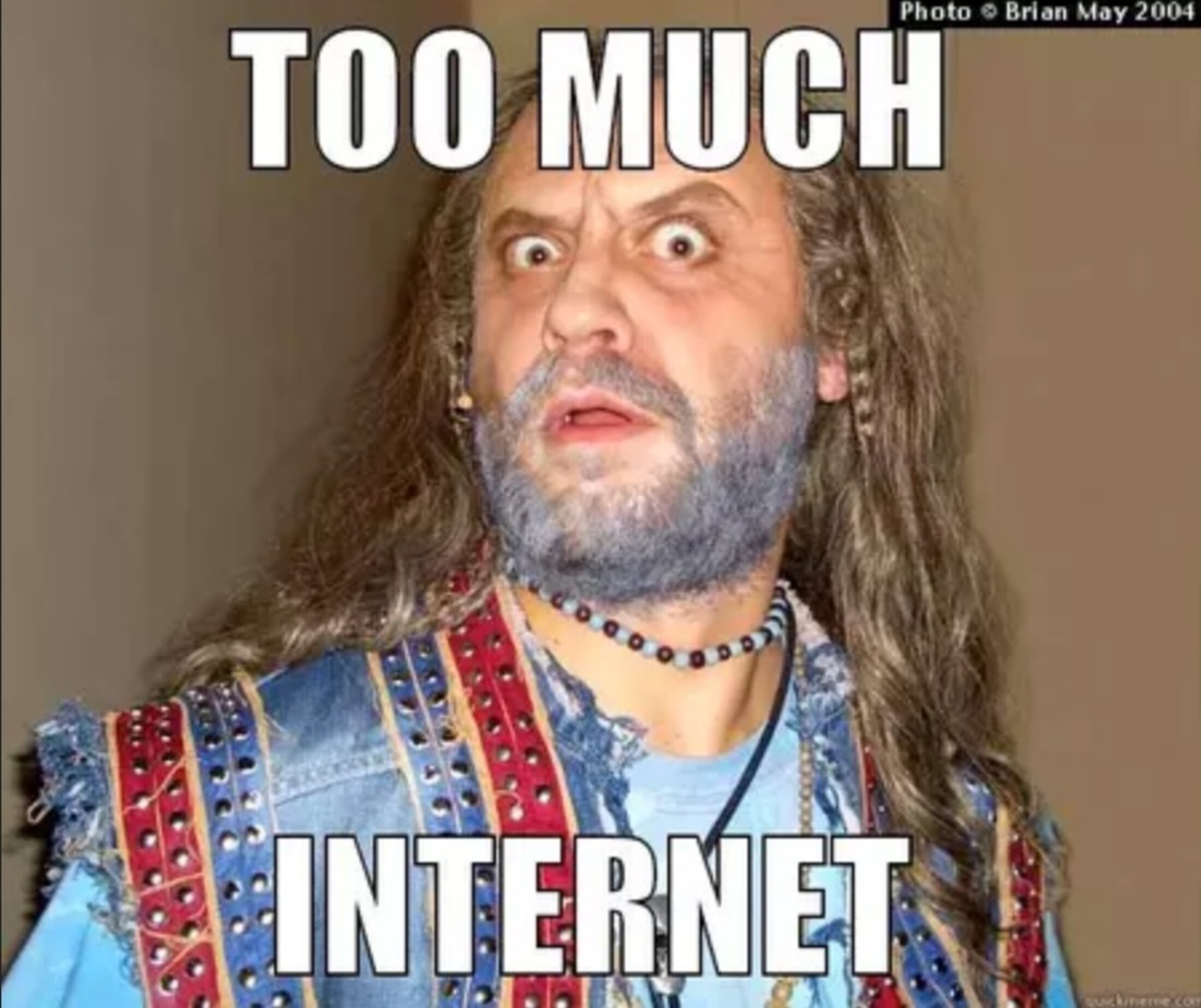
1 Xavier RIDEL, « Comment Donald Trump a utilisé Facebook pour cibler les internautes », Slate, 1 février 2017 https://www.slate.fr/story/136199/trump-brexit-cambridge-analytica
2 Nicolas TEILLARD, « Présidentielle américaine : influenceurs, réseaux sociaux... la transformation du paysage médiatique », France Info, 8 novembre 2024. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/d-un-monde-a-l-autre/presidentielle-americaine-influenceurs-reseaux-sociaux-la-transformation-du-paysage-mediatique_6858722.html
3 Quang PHAM, « Comment Elon Musk est devenu un champion de la désinformation au service de Donald Trump », France 24, 30 octobre 2024. https://observers.france24.com/fr/comment-elon-musk-est-devenu-un-champion-de-la-d%C3%A9sinformation-au-service-de-donald-trump
4 Félicien FAURY, Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l'extrême droite, Éditions du Seuil, 2024, p. 18
5 Voir la préface de Nicolas Lebourg au livre d'Alain CHEVARIN, Lyon et ses extrêmes droites, Éditions La Lanterne, 2020. préface accessible en ligne : https://tempspresents.com/2020/09/04/lyon-et-ses-extremes-droites/
6 Eva ILLOUZ, Les émotions contre la démocratie, Premier Parallèle, 2022
7 « les électeurs interrogés, même s'ils restent préservés de la pauvreté et du chômage, vivent leur situation économique et sociale comme incertaine et fragile », Félicien FAURY, op. cit., p. 33
8 « Selon une enquête de la CNCDH de 2015, parmi les personnes déclarant une proximité partisane avec le FN-RN, 43% se déclarent elles-mêmes « plutôt racistes » et 39% « un peu racistes », soit un total de 82% à s'auto-identifier comme racistes d'une manière ou d'une autre, ce qui constitue un niveau exceptionnellement élevé par rapport aux citoyens proches d'autres partis politiques. » Félicien FAURY, op. cit., p. 150
9 Félicien FAURY, op. cit., p. 120-121
10 Acronyme pour Advanced Research Program Agency Network. L'ARPA est l'agence de l'armée états-unienne chargée de faire des recherches scientifiques de fond.
11 Pierre BARBAROUX, « Innovation disruptive et naissance d’un écosystème : voyage aux origines de l’internet », Revue d'économie industrielle, n° 146, 2e trimestre 2014, Ecosystèmes et modèles d'affaires. https://journals.openedition.org/rei/5787
12 Il est notamment l'auteur de la « Déclaration d'indépendance du cyberespace », qui voyait de manière utopique Internet comme un espace dans lequel les gouvernements ne pourraient jamais imposer leur loi. Ce texte est un bel exemple du mélange d'idéalisme hippie et de libertarisme qui prévalait à la naissance d'Internet. https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_du_cyberespace
13 Eric SADIN, La Siliconisation du monde. L'irrésistible expansion du libéralisme numérique, L'Échappée, 2021
14 Le World Wide Web est le système d'adressage et de communication entre appareils qui permet de consulter des pages Web, en passant par le réseau Internet. Un site commençant par www.quelquechose est sur le World Wide Web.
15 Saul HANSELL, « Google's toughest search is for a business model », New York Times, 8 avril 2002 https://www.deseret.com/2002/4/10/19648349/google-s-toughest-search-is-for-a-business-model/
16 Sergey BRINN, Lawrence PAGE, « The anatomy of a Large-scalehypertextual Web search engine », Computer Networks and ISDN systems 30, n. 1-7, 1998:18, cité par Soshanna ZUBOFF, L'Âge du capitalisme de surveillance, Zulma, 2022, p. 106
17 Shoshanna ZUBOFF, op. cit., p. 95-140
18 Source : https://fortune.com/2017/05/05/facebook-digital-advertising-business-model/
19 Voir par exemple l'interview de Mehdi Khamassi publiée sur le site de l'association Résistance à l'Agression Publicitaire : https://antipub.org/recevoir-de-la-publicite-doit-etre-une-demarche-active-interview-de-mehdi-khamassi-chercheur-en-sciences-cognitives/?_thumbnail_id=10441
20 Ethan ZUCKERMAN, « Internet's Original Sin », The Atlantic, 14 août 2014. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/08/advertising-is-the-internets-original-sin/376041/
21 Georg FRANCK, « Capitalisme mental », Multitudes, 2013/3, n. 54, p. 202 https://shs.cairn.info/revue-multitudes-2013-3-page-199?lang=fr
22 Acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ce sont les cinq entreprises les plus grosses du numérique, qui concentrent la plus grande partie du trafic Internet, des ventes de matériel informatique, et de recettes publicitaires.
23 « La forme des choix. Données personnelles, design et frictions désirables », CNIL, Cahiers Innovation & Perspective, n. 06, janvier 2019, p. 13 https://linc.cnil.fr/cahier-ip6-la-forme-des-choix
24 Leo FAVIER, Dopamine, Arte 2019 : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/
25 Les biais cognitifs sont des « traitements stéréotypés d’informations non pertinentes ». On pourrait les définir comme une distorsion dans le traitement cognitif d’une information. En gros, cela signifie que le tri des informations que nous utilisons pour traiter plus efficacement la réalité n'est pas toujours pertinent. Voir Tanguy DELAIRE, « Libre arbitre et publicité, généalogie d'un double discours », Le Club Mediapart, 28 octobre 2024 https://blogs.mediapart.fr/tanguydelairewanadoofr/blog/281024/libre-arbitre-et-publicite-genealogie-dun-double-discours
26 Robert-Vincent JOULE, Jean-Léon BEAUVOIS, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, Nouvelle version, Presses Universitaires de Grenoble, 2014, p. 269
27 « La forme des choix. Données personnelles, design et frictions désirables », CNIL, Cahiers Innovation & Perspective, n. 06, janvier 2019, p. 17
28 David CHAVALARIAS, op. cit., p. 100
29 Christia SPEARS BROWN, « Comment plusieurs études montrent qu'Instagram peut nuire au bien-être des jeunes », The Conversation, 26 septembre 2021 https://theconversation.com/comment-plusieurs-etudes-montrent-quinstagram-peut-nuire-au-bien-etre-des-jeunes-168514
30 Dominique CARDON, Culture numérique, Les Presses de Sciences Po, 2019, cité par Mathilde SALIOU, op. cit., p. 52
31 Selon une étude de Contentsquare, citée dans COMK, « 2/3 des contenus de marques ne sont jamais vus », 20 mars 2020 https://comarketing-news.fr/2-3-des-contenus-de-marques-ne-sont-jamais-vus/
32 Georg FRANCK, op. cit., p. 212
33 Judith BUTLER, Qu'est-ce qu'une vie bonne ?, Éditions Payot et Rivages, Paris, 2020, p. 54
34 David CHAVALARIAS, op. cit., p. 98
35 David CHAVALARIAS, op. cit., p. 180
36 Eva ILLOUZ, Les émotions contre la démocratie, Premier Parallèle, 2022
37 Eva ILLOUZ, op. cit., p. 280
38 Sasha POLAKOW-SURANSKY, Sarah WILDMAN, « Renaud Camus, les idées derrière les balles de l'attentat de Christchurch », Slate, 20 mars 2019 https://www.slate.fr/story/174768/nouvelle-zelande-christchurch-idees-terroriste-france-grand-remplacement-renaud-camus
39 Franck JOHANNES, « Jordan Bardella reprend à son compte la théorie complotiste du « grand remplacement » », Le Monde, 30 août 2021, https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/08/30/jordan-bardella-reprend-a-son-compte-la-theorie-complotiste-du-grand-remplacement_6092713_823448.html ou https://www.nytimes.com/2019/03/15/world/asia/new-zealand-shooting-brenton-tarrant.html
40 David COLON, Propagande, op. cit., p. 276
41 David CHAVALARIAS, op. cit., p. 65-66
42 David COLON, Rupert Murdoch : l'empereur des médias qui manipule le monde, Tallandier, 2022
43 Nicholas CONFESSORE, Karen YOURISH, « £2 Billion worth of free media for Donald Trump », The New York Times, 15 mars 2016. https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring-donald-trumps-mammoth-advantage-in-free-media.html
44 Sophie EUSTACHE et Jessica TROCHET, « De l'information au piège à clics », Le Monde Diplomatique, août 2017, https://www.monde-diplomatique.fr/2017/08/EUSTACHE/57804
45 Jürgen HABERMAS, De l'éthique de la discussion, Flammarion, 1999
46 Christine SERVAIS, « Scènes médiatiques et arènes de discours. Formes d’engagement dans un monde perdu », Réseaux, Éditions La Découverte, 2017/2 (n° 202-203), p. 79 à 121. https://shs.cairn.info/revue-reseaux-2017-2-page-79?lang=fr
47 David CHAVALARIAS, op. cit., p. 116
48 David CHAVALARIAS, op. cit., p. 117-118
49 Davis CHAVALARIAS, op. cit., p. 120
50 David CHAVALARIS, op. cit., p. 61
51 Un troll est un internaute qui « cherche délibérément à engendrer des polémiques, par exemple en abordant un sujet controversé ou en s’en prenant aux autres participants » voir partie suivante de l'article
52 "On avait commencé à parler de post-ironie. On en trouvait la version la plus concentrée, endurcie et aiguisée dans la communication de l'art-right. La post-ironie produisait des énoncés invulnérables, parce qu'ils étaient présentés comme des "plaisanteries" et désarmaient donc préventivement la moindre critique qui les prendrait au sérieux, mais en même temps, leurs contenus étaient odieux, et abaissaient à chaque fois le curseur de l'acceptable". WU MING 1, op. cit., p. 119
53 « Les candidats […] savent que s'ils parviennent au pouvoir, ils n'auront en réalité qu'une marge de manœuvre limitée. Dans ces conditions, les programmes politiques sont, comme les produits, relativement peu différents les uns des autres. Sur quoi va alors se porter la différenciation ? Sur la personnalité et « l'image » du candidat. » Guy DURANDIN, L'information, la désinformation et la réalité, 1993, Presses Universitaires de France
54 Erin Burnett Out Front, CNN Politics, 1 novembre 2024, https://edition.cnn.com/2024/11/01/politics/video/kfile-different-messages-harris-campaign-israel-gaza-ebof-digvid
55 David CHAVALARIAS, op. cit., p. 124
56 Barbet SCHROEDER, Le Vénérable W, 2017 https://www.premiere.fr/film/Le-Venerable-W
57 Charles MAURRAS, Enquête sur la monarchie, Gazette de France, 1900, in Michel WINOCK, op. cit., p. 155
58 David CHAVALARIAS, op. cit., p. 185
59 David CHAVALARIAS, op. cit., p. 122
60 Michel WINOCK (dir.), Histoire de l'extrême droite en France, Éditions du Seuil, 2015
61 Collectif Sleeping Giants, « Infiltré dans la fachosphère de Twitter/X, Le Club de Mediapart, 1 octobre 2024. https://blogs.mediapart.fr/sleeping-giants-france/blog/011024/infiltre-dans-la-fachosphere-de-twitterx
62 Acronyme de Thinking About You / « en train de penser à toi »
63 Pacôme THIELLEMENT, « TAY, les agents conversationnels sont des cons », Infernet, Blast, 24 juin 2022 https://www.youtube.com/watch?v=mtpanIOCRQw
64 Pacôme THIELLEMENT, op. cit.
65 David CHAVALARIAS, op. cit., p. 172
66 Olivier VOIROL, op. cit.
67 Jürgen HABERMAS, De l'éthique de la discussion, Champs Flammarion, 2013
68 Hannah ARENDT, « Vérité et Politique », in La Crise de la culture, éditions Gallimard, 1972
69 Consommer, Produire et travailler, Se déplacer, Se loger, Se nourrir
70 « Le lobby publicitaire à l'assaut des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat », antipub.org, 16 décembre 2020 https://antipub.org/le-lobby-publicitaire-a-lassaut-des-propositions-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
71 « Convention citoyenne pour le climat : une expérience démocratique inédite », Vie-publique.fr, 18 mai 2021 https://www.vie-publique.fr/eclairage/279701-convention-citoyenne-pour-le-climat-experience-democratique-inedite#mise-en-%C5%93uvre-des-propositions
72 Culture POUB, « Détricotage de la convention citoyenne pour le climat (CCC) et de ses propositions antipub : entretien avec Eric, rapporteur de la commission "consommer" de la CCC », Zoom Écologie, Fréquence Paris Plurielle, 11 janvier 2021 (émission radio) https://zoom-ecologie.net/?Detricotage-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-CCC-et-de-ses
73 Avis de la Convention Citoyenne pour le Climat sur les réponses apportées par le gouvernement, 2 mars 2021, https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/wp-content/uploads/2021/03/CCC-rapport_Session8_GR-1.pdf
74 « « Digital Services Act » : un règlement pour encadrer les services numériques », gouvernement.fr, 16 février 2024



