Naoned :
Port sans navire, citadelle des exilés
Aucune restriction de forme, sinon la contrainte temporelle (5 minutes récitées pour un enregistrement sonore) et avec comme mots-clefs : Nantes, l'esclavagisme, la mémoire et le concept de Fraternité.

Agrandissement : Illustration 1

Il y a eu 1492 – les épices, le sucre et l’or ; les scalps, le tango, la salsa et le sang. Il y a eu les explorateurs, devenus négociants, les conquistadores assoiffés de parures, enivrés par les légendes Incas, les fleurs rebelles Mapuches, l’obstination des Séminoles. Il y a eu Aristote et Pythagore, Galilée et Copernic ; l’Église repentie, la terre plate qu’on a faite sphérique ; une idée, de l’argent, la soif ; des marins ignorants, des couronnes avides ; et des colons partis fendre ciel, terre, et mer, pour révéler de nouvelles routes ; fonder de nouvelles nations, planter de nouveaux drapeaux, chanter de nouveaux hymnes, sur des terres dont on méprisait l’Histoire ; des colons appâtés par les rumeurs, la promesse du gain, et de la fuite des champs de servage, éternellement héréditaires. Une idée, de l’argent, et des armes. Des hommes, colons aux ambitions prophétiques, venus évangéliser, soumettre, tuer ; entrainés dans la course folle des espoirs et du monde qu’il pensait découvrir en baptisant ; car en nommant, ils possédaient. Il y a eu les empires vaincus, les peuples exterminés, des langues évanouies ; il y a eu des révoltes, des Quilombos, des survivants. Et des millions d’êtres humains déracinés, anonymes, oubliés, naufragés ; et celles et ceux qui sont demeurés, très vite assujettis, les africains dont l’âme serait bien troquée contre celle des indigènes. Le plaidoyer de Bartolomé de Las Casas n’a pas suffi ; Dieu ne pouvait pas gracier tout le monde ; parce qu’il y avait des champs et des domaines en Alabama, parce qu’il y avait des ateliers à Manchester, parce qu’il y avait un port à Nantes, la main d’œuvre sur la côte de Guinée, et du pétrole au Sénégal.
Alors on les a pillés, et plus tard, séparés par des frontières artificielles, plaies béantes qui saignent encore le continent, du Kivu à Kindia, du Soudan à la Libye. C’était l’édification implacable du racisme en science, le lent murissement du capitalisme, et le fleurissement des villes portuaires, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, au Pays-Bas, et en France enfin : Rouen, le Havre, Bordeaux, Brest ; la ville que nous habitons désormais : Naoned.
Bientôt, ces négociants, petits artisans, auront une assise idéologique, son cortège de Lumières, de figures intellectuelles assez audacieuses pour briser les lignes, assez sérieuses pour être entendues, leurs ouvrages, les notions qui ont façonné ces nouvelles consciences, et qui prépareront 1789, les têtes coupées, la fin du clergé tout puissant ; et parmi elles, la consécration de l’individu, de l’Etat nation et de la propriété. Les rois et le féodalisme auront eu leur temps. L’Eglise saura s’adapter. C’est l’ère de la bourgeoisie, et sa devise : Liberté, Egalité, Fraternité. Celle que l’on a placardé aux frontons des mairies, sous la IIIème République ; celles que les Gilets Jaunes ont opposé, comme un idéal promis et avili à l’hiver 2018.
Qu’il faille distinguer ces trois notions, nous indique déjà un parti pris. Et que nous rejetons. Il est des mots qui n’existent pas encore, que nous devons inventer – ou emprunter peut-être, dans les langues des diasporas de Naoned qui ont, elles aussi, fait la ville, et continuent de la faire vivre. Il y a le Soso, et le wontanara prononcé sur les lèvres des réfugiés guinéens aux moments des adieux, qu’on peut difficilement traduire, mais qui pourrait évoquer l’union, la lutte commune, un ensemble peut-être. Il y a azadi (آزادى), la liberté kurde, reprise en chœur par les femmes la diaspora des peuples d'Iran l'année passée, après la mort de Mahsa, et qui signifiait déjà peut-être davantage que la liberté individuelle, la liberté de propriété, cette liberté libérale, qui permet tout, et même d’exploiter, et de tuer ; car enfin, comment envisager la liberté, sans la justice ? La justice, sans la liberté ?
Les géologues, architectes et urbanistes s’accordent à dire que si les édifices du Quai de la Fosse, de l’île Feydeau et de Commerce tanguent, c’est en raison du sol meuble, de ce sable, et des comblements des bras d’eau de l’Erdre et de la Loire. Quant à nous, il nous plaît à penser que notre ville aimée sait ses fondations troubles ; qu’elle bascule, s’écroule, chavire ; sachant qu’elle s’est édifiée dans le sang, les chaînes, des millions de vies arrachées à elles-mêmes, les déportations et les charniers. Qu’elle a su accueillir dans son giron les aventuriers qui ont successivement échoué sur ses rives ; qu’en son sein toujours, résonne une myriade de voix mêlées.
Il est des mots qui n’existent pas encore, et que nous devons inventer – ou emprunter peut-être, en la calle, sur les lèvres de Nantes, de ces exilés, échos vivant du passé, boutures d’aujourd’hui.
Il reste encore à œuvrer, afin qu’éclose la fraternité véritable, que les rapports humains soient enfin dépourvus des contrats mercantiles, de l’inégalité qui en découle, de l’autorité ; celle d’un monde libre, sans frontière, sans papier, ni visa, ni fusils, sans barbelés, et débarrassé de l’esclavage salarié.
Lautaro Tarazona,
Révolutionnaire internationaliste.
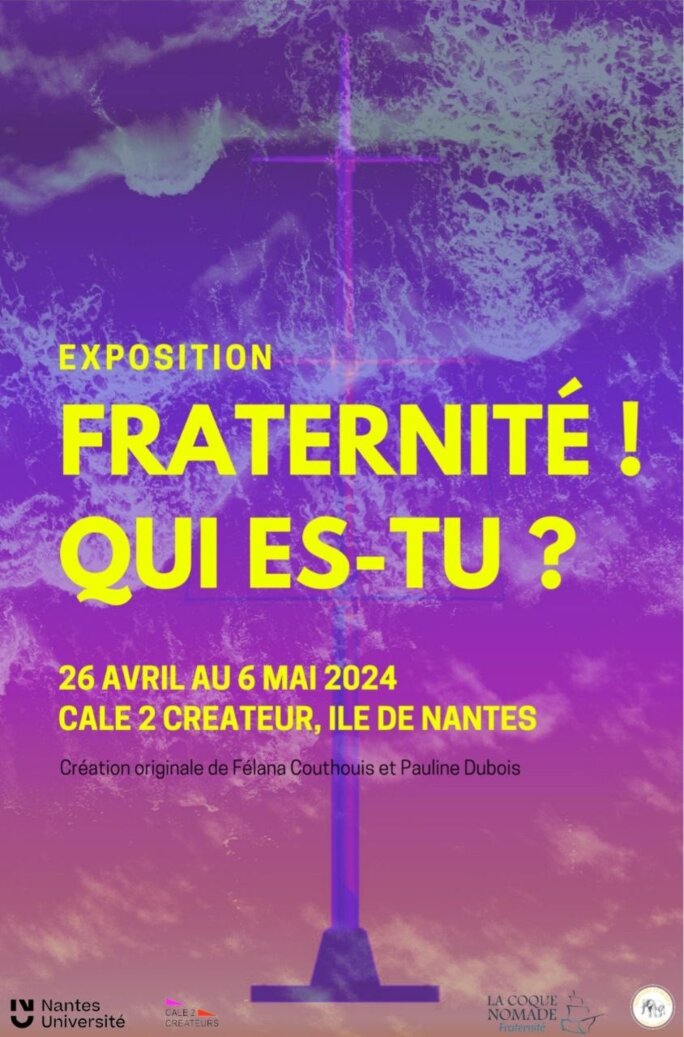
Agrandissement : Illustration 2
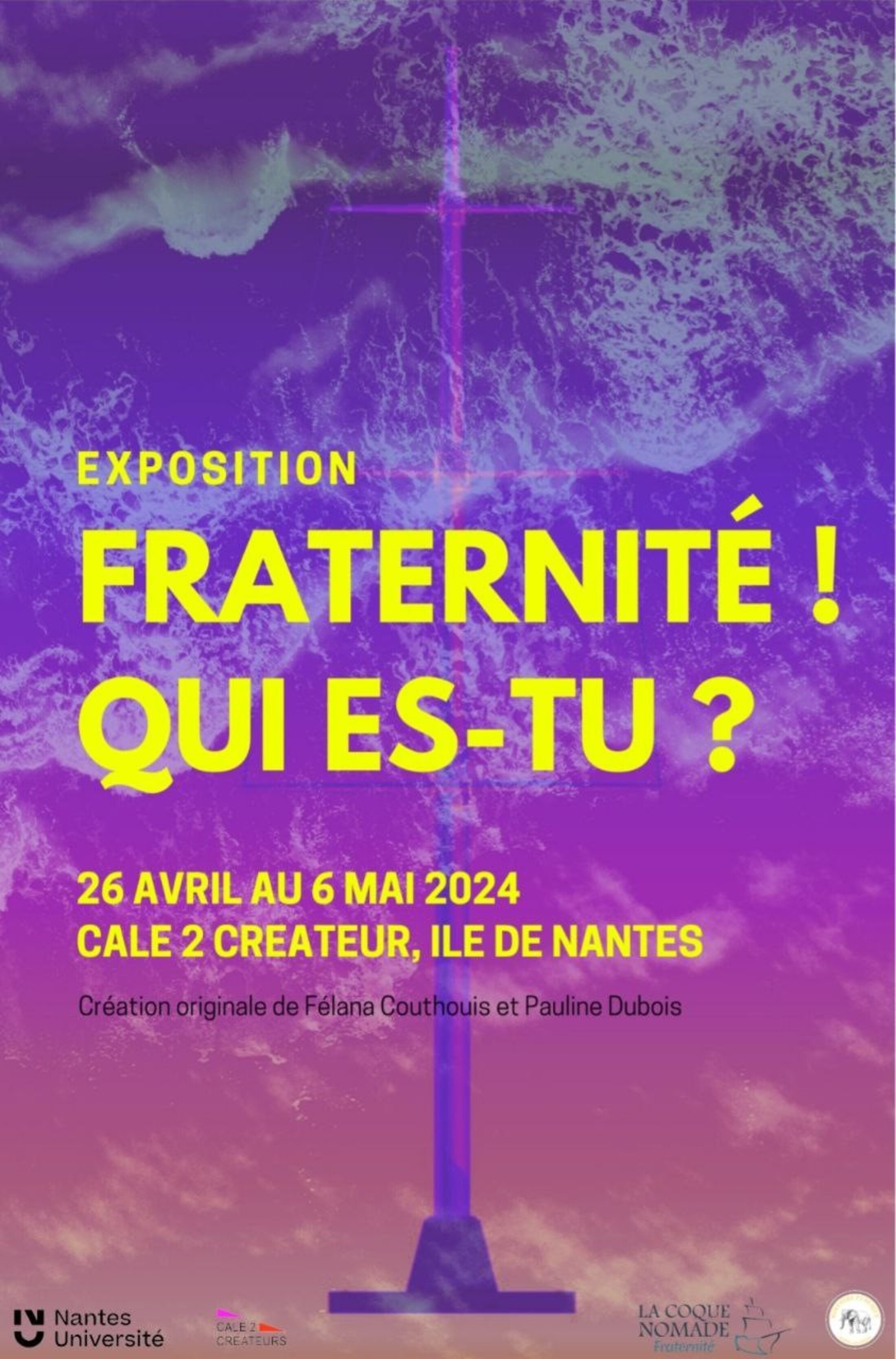
Fraternité ! Qui es-tu ? - Cale 2 Créateurs
"Cette exposition se consacre à l'Histoire du terme Fraternité en France, de sa naissance à son évolution jusqu'à aujourd'hui. A travers une exposition qui se veut historique, sensible et participative, interrogeons-nous sur les valeurs et le sens de Fraternité dans les grands débats actuels.
Pensée et réalisée par Pauline Dubois et Félana Couthouis, étudiantes en Master 1 d'Histoire Publique à l'université de Nantes."



