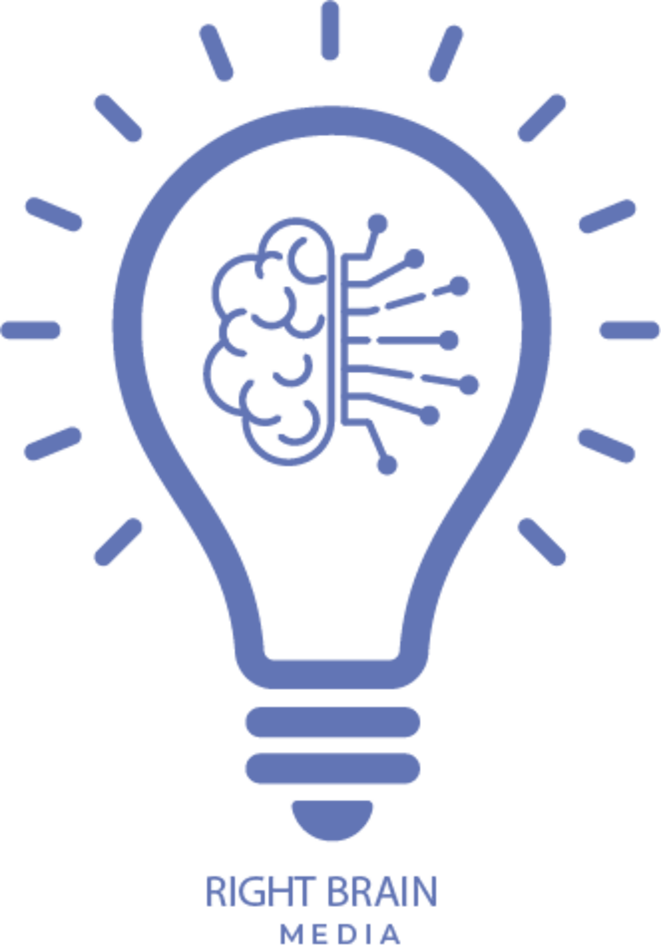« Une dizaine de milliardaires possèdent plus de la moitié des médias français. Il y a donc une mainmise d’un nombre d’acteurs trop réduit sur une grande partie du paysage médiatique. »
A partir de ce constat, le sénateur socialiste de Paris, depuis longtemps engagé en faveur de la liberté de la presse, examine l'influence des puissants magnats du capitalisme français sur les médias. Dans un contexte de "normalisation économique", récemment détaillée par Laurent Mauduit dans Mediapart, David Assouline tire la sonnette d'alarme concernant la présence de milliardaires tels que Bernard Arnault, Xavier Niel et Patrick Drahi au sein des comités de direction des grands médias français. Cette normalisation économique, souvent suivie d'une normalisation éditoriale, est marquée par des pressions, des censures et des manipulations diverses sur lesquelles l’élu socialiste revenait hier dans les colonnes de La Croix. "Le pluralisme est un fondement démocratique essentiel", clame le sénateur socialiste de Paris, soulignant qu'il garantit la liberté de se forger une opinion éclairée. Cependant, l’ancien premier secrétaire de la fédération socialiste parisienne alerte sur la menace réelle qui pèse sur ce principe, car les actionnaires peuvent effectivement exercer un contrôle sur les contenus diffusés dans leurs médias. « Bien que tous ne le fassent pas, ils en ont les moyens légaux, comme en témoigne le sinistre exemple de Vincent Bolloré ». Ainsi, le sénateur parisien fait remarquer que, malgré les possibilités légales de contrôle, les médias sous l'influence du groupe Bolloré ne respectent pas le pluralisme et transforment leurs organes de presse en outils de propagande. Or, l'article 3-1, alinéa 3, de la loi du 30 septembre 1986, qui fonde l'intervention de l'ARCOM en matière de "déontologie de l'information", impose à l'organisation de garantir "l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent". Dans ce cadre, le régulateur doit notamment s'assurer que les conventions d'autorisation conclues avec les chaînes privées respectent le droit d'opposition et le droit à la protection des sources, consacrés par l'article 2 bis de la loi de 1881.
Comment Vincent Bolloré à tout chamboulé ?
Le 23 juillet dernier, le journaliste Laurent Mauduit évoquait dans les colonnes de Mediapart une inquiétante dégradation du respect des fondamentaux juridiques au sein des médias appartenant à Vincent Bolloré. En effet, le tycoon breton a franchi une étape décisive en transformant ses médias en véritables organes de l'extrême droite. Cette métamorphose s'est matérialisée par la mise en avant de figures comme Eric Zemmour, sur CNews, ainsi que par son soutien à sa campagne présidentielle. De plus, Geoffroy Lejeune, un autre journaliste d’extrême droite, a été nommé à la tête du Journal du dimanche (JDD). Ces actions inquiétantes, soulignées aussi bien par David Assouline que par Laurent Mauduit, constituent une menace pour le droit de savoir des citoyens, l'un des piliers essentiels de la démocratie. En effet, le non-respect par les médias contrôlés par Bolloré de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 devient problématique pour la liberté de la presse française. La loi exigeant que toutes les chaînes de radio généraliste et de la TNT diffusant des émissions d'information politique et générale mettent en place un comité contribuant au respect des principes de liberté, n’est plus respectée au sein d'entités telles que CNews, où des émissions comme L'Heure des pros ou Face à L'Info sont devenues des tribunes pour diffuser certaines idées dans l’espace public. Lors de son audition devant une commission d'enquête sénatoriale, Vincent Bolloré a rejeté l'idée que son groupe cherchait à promouvoir une "chaîne d'opinion". Toutefois, les recherches d'une chercheuse du CNRS contredisent cette affirmation. Enfin, l’Arcom n’aurait pas été assez vigilante avec les médias du groupe Bolloré, puisque la seule amende infligée à CNews pour l'un des "plus graves dérapages" de Zemmour s'élevait à seulement 200 000 euros. Ces constats inquiétants posent des questions fondamentales sur la préservation du pluralisme et de l'information objective au sein des médias français, et appellent à une action vigilante des acteurs concernés pour protéger les principes démocratiques garantis par une loi de 1986 que David Assouline souhaite modifier.
Il est urgent de revoir la loi de 1986
Dans son récent entretien accordé à La Croix, David Assouline a mis en évidence un enjeu crucial lié à la loi de 1986 sur la liberté de communication. « Cette loi, clamait-il, établit une distinction entre trois catégories de médias : la télévision, la radio et la presse écrite, excluant les hebdomadaires et magazines considérés alors comme n'étant pas d'information et de politique générale. » Ainsi, le sénateur de Paris souligne une même entité ne peut pas posséder des médias dans plus de deux de ces trois catégories. Néanmoins, le rachat d'Europe 1, du JDD et du groupe Canal+ par Vincent Bolloré met en évidence le non-respect de cette loi dans les entités qu'il contrôle. Pour régler ce problème, le sénateur socialiste propose d'intégrer ces mastodontes dans notre cadre juridique et de proposer un modèle alternatif, plus qualitatif et pluraliste que celui fixé par la loi du 30 Septembre 1986 sur la liberté de communication, et propose également de traiter la question des contenus diffusés sur les gafam.
Une volonté de mieux réguler les Gafam
« Les grandes plateformes que sont les Gafam sont entrées dans le jeu de l’information, entièrement émancipées des régulations qui l’encadrent chez nous. En plus d’être un problème en soi, c’est aussi un argument des grands groupes français, dont certains estiment qu’il faut concentrer le plus possible pour leur faire concurrence. » En abordant ainsi la question des Gafam dans son entretien avec le journal La Croix, David Assouline souligne un problème majeur. Le contexte actuel de la lutte pour capter l'attention du public dans une économie largement algorithmée est devenu de plus en plus agressif. Cette situation soulève directement la question de la régulation globale, notamment au niveau national et européen, des interactions entre les géants du web, les GAFAM, et les médias. Ces entreprises, grâce à leurs plateformes largement automatisées, agissent comme des intermédiaires entre les internautes, consommateurs d'informations, et l'énorme quantité de contenus disponibles en ligne, dont ceux produits par les médias d'actualité, tout en diffusant également des informations plus légères sur des plateformes comme Tiktok ou Twitter. Un maitre de conférences spécialisé dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) exprime ses inquiétudes quant à l'évolution de ce nouveau modèle médiatique. « Au-delà de la manière dont les médias sont actuellement produits, distribués et consommés, l'utilisation de plateformes comme Tiktok pose la question de leur intégration au sein d'entreprises dotées d'organisations de travail spécifiques et basées sur une culture professionnelle du journalisme, tout en mettant en lumière l'apparition de fake news. ». Comme de nombreux chercheurs, il observe que les professionnels responsables de ces questions se trouvent à l'intersection du filtrage de l'information, du marketing et du journalisme participatif. Cependant, les approches varient grandement selon les médias, qui développent des pratiques adaptées à leur propre situation. Cette réalité complexe nécessite une réflexion approfondie sur la régulation des interactions entre les acteurs du web et les médias traditionnels, afin de garantir un paysage médiatique équilibré et respectueux des principes journalistiques fondamentaux.