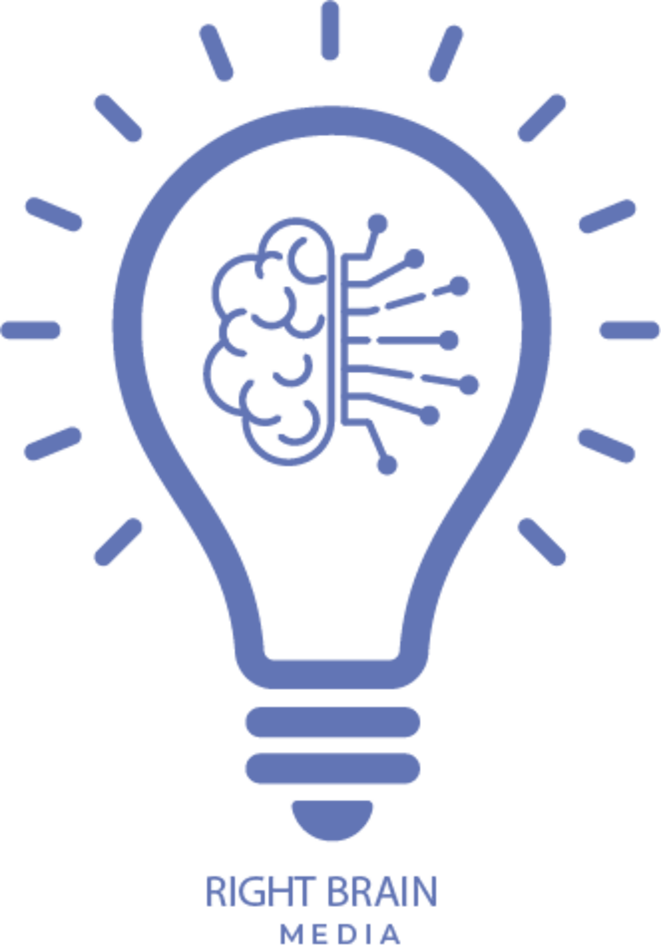La naissance du sionisme comme réponse à l’antisémitisme à l’aube du XXe siècle
Au cœur de l'effervescence intellectuelle du XIXe siècle allemand, un homme se distingue par sa vision et son audace : Theodor Herzl (1860-1904). Dans un monde où les échos de l'antisémitisme se font de plus en plus forts, même dans la patrie du précurseur chancelier Otto Von Bismarck, ce dernier souhaitait engager un Kulturkampf : « De tout temps, clamait le chancelier, j’ai été, au point de vue religieux, tolérant jusqu’aux limites que fixe aux prétentions de chaque croyance particulière la nécessité de la vie commune des différentes confessions dans le même organisme politique […]. Quand j’engageai le Kulturkampf, j’y étais principalement déterminé par le côté polonais de la question […], les tableaux de statistiques ne permettaient plus de mettre en doute les progrès rapides du nationalisme polonais aux dépens du germanisme. » Au cœur de cet état, Herzl ressent l'urgence d'agir. Il ne se contente pas de critiquer ou de se lamenter ; il propose une solution audacieuse. En 1896, il publie "Der Judenstaat", une œuvre qui deviendra rapidement le manifeste d'une nouvelle approche de la "question juive". Martin Schwartz, éminent historien de l'université de Bordeaux et excellent connaisseur de cette période charnière, décrit avec passion le tournant que représente ce texte. "Avec la parution de 'L’État juif', le sionisme, ce mouvement naissant, change de cap. Il s'éloigne de l'idée générale d'une émancipation pour tous pour se recentrer sur une émancipation spécifiquement juive. Cela, malheureusement, aux dépens d'une population qui se retrouvera plus tard en marge, en proie à l'occupation et à l'exil à la fin du 19ème siècle." Les événements mondiaux, tels que les pogroms sanglants en Russie ou l'Affaire Dreyfus qui secoue la France, renforcent la conviction de Herzl : l'intégration totale des Juifs, même dans une nation aussi avancée que la France, n'est qu'une douce illusion que Herzl souhaite combattre.
L’Arabe était l’homme invisible
Dans "L’État juif", Theodor Herzl explore de nombreux thèmes, mais omet curieusement d'aborder le mode de vie des peuples arabes vivant en Cisjordanie. Après avoir parcouru la Palestine, Herzl réalise à quel point les terres arabes sont cultivées, sauf dans certaines zones de « l’actuelle Cisjordanie ». En 1897, il jette les bases de l’Organisation sioniste mondiale à Bâle. Cette organisation, rapidement reconnue pour son influence, devient une force incontournable dans le paysage politique et social de l'époque. Herzl, avec sa vision presque prophétique, imagine un rôle particulier pour les Juifs séfarades. Majoritaires en Allemagne et en Europe à la fin du XIXe siècle, il les voit comme des ponts entre l'Occident et l'Orient. Ils apporteraient avec eux non seulement la culture occidentale, mais aussi un raffinement et une sophistication qui illumineraient une région depuis longtemps en proie à des conflits internes. Et, tout comme il l'avait anticipé, la fin du siècle voit un afflux massif de la diaspora juive vers la Palestine. "Ces mouvements migratoires étaient avant tout une réponse aux pogroms en Russie, des attaques brutales et impitoyables contre les Juifs", commente Schwartz. Cette prise de conscience amène les sionistes à une réflexion profonde sur le sionisme, influençant la façon dont de nombreux Juifs et chrétiens percevaient négativement les Palestiniens. Dans le contexte actuel, Schwartz note que, tout comme à la fin du XIXe siècle, les actions militaires visent à neutraliser les groupes musulmans qui soutiennent le Hamas. Mona Chollet, dans une récente chronique pour Mediapart, rejoint l'avis de Schwartz sur la vision des sionistes vis-à-vis des colons : « Nous sommes en pleine désinformation orchestrée par l’État israélien, cherchant à occulter le regard condescendant des colons juifs envers les populations locales à leur arrivée en Palestine. ».
De l'exode salvateur au projet colonial
À l'aube du 20ème siècle, un regard complexe se pose sur la Palestine. Du point de vue sioniste, les Palestiniens apparaissent presque comme des ombres sur leur propre terre, des êtres sans histoire ni identité propre. Ils sont perçus comme des indigènes, souvent réduits à l'image de Bédouins nomades, sillonnant les étendues fertiles de la Palestine depuis des siècles sans vraiment y laisser de trace durable. Par contraste, l'arrivée des Juifs d'Europe en Palestine est saluée par les musulmans comme une renaissance, un élan de modernité et de progrès. À travers les yeux des Arabes, le peuple juif n’est pas seulement perçu comme des migrants ; il est porteur de lumière, venant éclairer une région perçue comme restée dans l'obscurité. Theodor Herzl s'inscrit parfaitement dans cette logique. Il rêve d'une Palestine où les Juifs diffuseraient la culture et les valeurs allemandes. Cependant, la Palestine n'est pas exactement la terre aride et sans histoire que certains voudraient croire. Les terres sont fertiles, cultivées depuis des millénaires, et les oranges palestiniennes, par exemple, sont reconnues pour leur qualité exceptionnelle, bien avant l'arrivée des premiers sionistes. Martin Schwartz évoque un philosophe juif, Ahad Ha’Am, qui avait déjà souligné en 1891 que la Palestine était tout sauf un désert. Avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la Palestine abritait même déjà une communauté juive d'environ 60 000 personnes.
Vers la colonisation constante du territoire palestinien
En 1914, la Palestine bruisse d'activité avec ses 700 000 habitants, dont 100 000 Juifs. Puis, l'écho de la déclaration de Balfour en 1917, plaidant pour la création d’un État pour le peuple juif en Palestine, résonne à travers le monde. Les années s'écoulent. Entre 1919 et 1948, la Palestine voit arriver près de 450 000 Juifs, dont un afflux venant de Pologne entre 1934 et 1936. L'ombre de la Shoah plane, et malgré les horreurs, des nations comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis hésitent à ouvrir leurs portes. De plus, en 1938, le monde se tourne vers la conférence d’Évian, orchestrée par le président américain Roosevelt, souhaitant offrir une terre aux Juifs en Palestine. Mais l'espoir s'amenuise, et la Palestine devient le principal refuge pour les survivants de la Shoah. L'odyssée du navire Exodus en 1947 symbolise ce périple. Refoulés par les Britanniques, de nombreux Juifs trouvent finalement asile en Palestine. Les années 1950 voient l'arrivée en masse des Séfarades. Les années 90 marquent un nouvel afflux, principalement de Russie et de l’ex-URSS. Avec la proclamation d'Israël en 1948, la population explose, passant de 806 000 à 8,6 millions en 2017, alimentée par l’immigration. Enfin, l’offensive menée en octobre 2023 a entraîné la violence de la guerre avec des destructions massives et un bilan humain tragique, dépassant les 8 000 morts. En effet, des journalistes du Monde ont révélé ce matin que l’armée israélienne souhaite détruire les infrastructures militaires souterraines du Hamas, stratégiquement positionnées sous les hôpitaux, les mosquées et les écoles. Un exemple frappant est le bombardement près de l'hôpital d'Al-Qods. Enfin, face à la violence du conflit israélo-palestinien, l’espoir d’une paix en Cisjordanie s’amenuise. Malgré les nombreux défis rencontrés, l'espoir d'une coexistence harmonieuse demeure l'objectif ultime de nombreuses générations habitant la région.