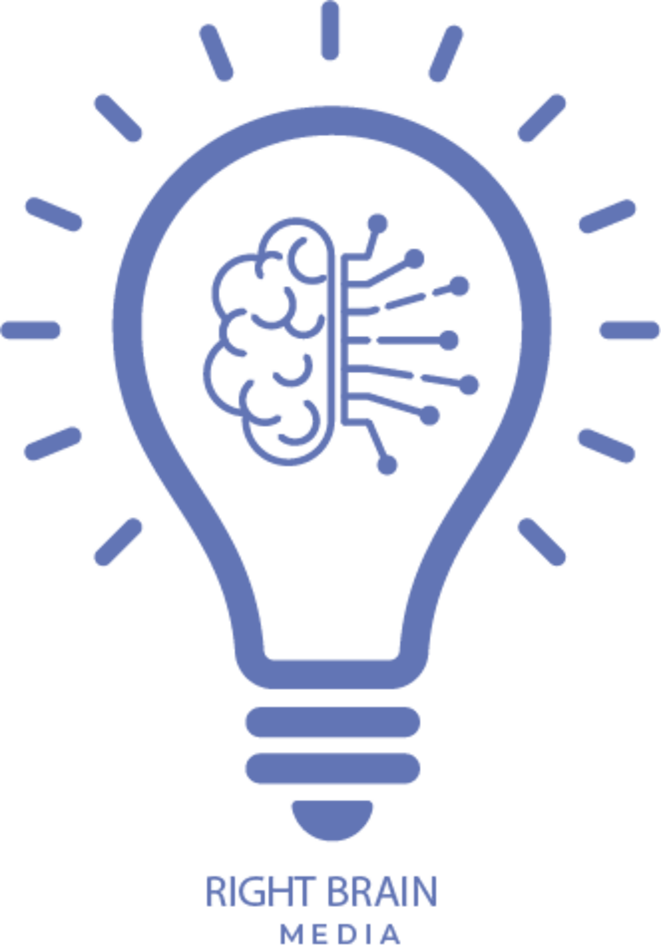Évolution énergétique : La France face à un défi comparable à la révolution industrielle
« La transition énergétique que connaît actuellement la France pourrait bien être l'équivalent moderne du déploiement du réseau ferroviaire au début de la révolution industrielle, une période durant laquelle 2 à 3% d'investissements du PIB étaient consacrés chaque année à cette innovation majeure. » En tenant ces propos, la ministre de la Transition énergétique souligne, face aux enjeux climatiques, son engagement à suivre les directives européennes concernant les énergies renouvelables. Initialement adoptées en 2009, elles prévoyaient que 20% de l'énergie de l'Union provienne de sources renouvelables d'ici 2020. Modifiée en 2018, la directive visait 32% d'énergies renouvelables pour 2030. Cependant, sous la Commission d’Ursula von der Leyen, également présente à Bordeaux ce samedi, et désireuse de positionner l'Europe en tête de la transition écologique, l'objectif est réajusté à 40% d'ici 2030, et même 49% pour l’énergie des bâtiments. Cette vision s'intègre dans une démarche plus vaste de rénovation des bâtiments et de baisse de consommation énergétique.
Quid des ressources naturelles onéreuses ?
Dans son allocution d’aujourd’hui, au congrès de rentrée du Parti Renaissance, Agnès Pannier-Runacher a omis d'évoquer que la quête d'une énergie propre dépend fortement de ressources naturelles précieuses. Louise*, experte en politiques publiques de transition écologique, rappelle : « Les métaux rares, essentiels à la création d'éoliennes, panneaux solaires et batteries. » Elle pointe donc un certain paradoxe dans " l'approche Pannier-Runacher ». « La ministre ne mentionne pas la hausse du coût des métaux nécessaires à notre transition », note Louise. Pour mettre en lumière cette idée, elle cite un article de Philippe Waechter de 2022, mentionnant une augmentation de plus de 1000% du prix du lithium entre 2020 et 2022. Malgré cela, la ministre demeure confiante, mettant en avant les efforts budgétaires français : « Le budget pour la rénovation thermique est passé de 2,4 à 5 milliards en un an. La trajectoire environnementale est prometteuse. ». Ainsi, Agnès Pannier-Runacher relève qu’après un recul de 1% des émissions de gaz à effet de serre entre 2012 et 2017, ce taux a grimpé à 2,7% ces cinq dernières années, atteignant un sommet de 4,3% cette année.
Peu de chiffres pour évoquer les mesures écologiques en faveur des Français précaires
« Pour 2030 et 2050, la France envisage une refonte majeure de son modèle énergétique, privilégiant la rénovation thermique. Elle y alloue 5 milliards d'euros, mais l'utilisation totale de ces fonds reste incertaine, face aux enjeux territoriaux et de suivi. » Insistant sur le fait que les foyers ne doivent pas repousser leurs projets de rénovation pour raisons personnelles, la ministre suggère une écologie « accessible et adaptée aux classes moyennes ». Cependant, en évoquant les taxes sur le carburant, Agnès Pannier-Runacher néglige de mentionner que la Commission européenne projette une transformation massive du parc automobile que les politiques européennes visent à réduire. En effet, les émissions des nouveaux véhicules baisseront 55 % d'ici 2030, par rapport à l'actuel 37,5 %. La ministre paraît donc en décalage avec les procédures européennes lorsqu'elle proclame vouloir prendre en compte les réalités des Français en situation précaire et déclare : « Les agriculteurs ne doivent pas être brusquement affectés sans disposer d'alternatives viables, comme les biocarburants ou le biogaz. ». Elle mise sur un discours d'« aide aux plus démunis », souhaitant que chaque secteur profite des bénéfices écologiques, sans étayer ses propos. La transition écologique semble ainsi difficilement acceptable.
Des ZFE pour une élite urbaine ?
« Chaque initiative écologique nécessite une communication limpide et un discours solide. Les zones à faibles émissions, vues par certains comme des barrières pour les plus précaires, devraient être valorisées pour leurs avantages sanitaires ». En s'exprimant ainsi, Agnès Pannier-Runacher semble avoir oublié les Gilets jaunes. Ce mouvement rappela à l'élite la réticence des Français face aux restrictions de mobilité, symbole de liberté menacée. La Loi d'orientation des mobilités (LOM) de 2019 imposa aux agglomérations la création de « zones à faibles émissions » (ZFE), excluant les véhicules les plus polluants. Si logique en apparence, ces zones, applaudies par les citadins et cyclistes, sont vues comme discriminatoires, notamment par les habitants des périphéries. « Ces personnes, sans moyens pour un véhicule récent ou sans transports en commun, se sentent rejetées. » confie un militant Renaissance issu d'un territoire rural. Ce passionné d'automobile évoque que les « batteries solides » pourraient être une solution en milieu rural. « En utilisant de la céramique plutôt qu'un électrolyte liquide, des batteries plus légères et efficaces sont envisageables. Elles pourraient améliorer l'autonomie et réduire l'empreinte carbone de 25 % à 39 %." Toutefois, ce fervent macroniste, ayant adhéré à LREM dès 2016 admet son ignorance quant au coût d'une telle technologie, la jugeant probablement réservée à une élite urbaine.