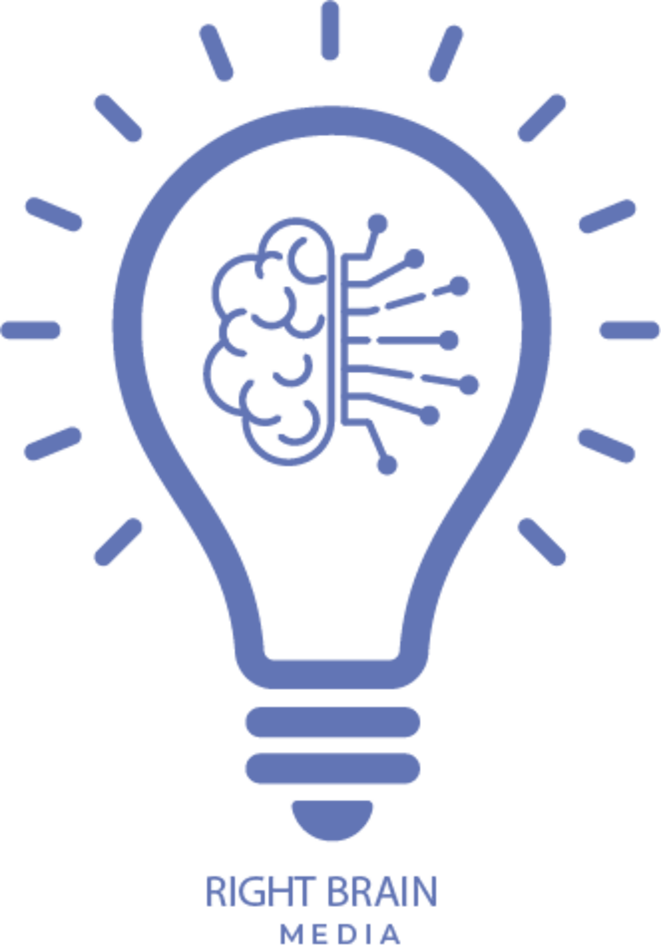Une vie mensongère
« L’amour, croyait-elle, devait surgir subitement, avec de grands éclats, des fulgurations – ouragan céleste s'abattant sur la vie, la chamboulant, emportant les volontés telles des feuilles et entraînant dans l’abîme le cœur entier. » Cette citation de Gustave Flaubert illustre qu’Emma se berce dans l’illusion portée par la fiction romantique. Désillusionnée par son échec amoureux avec Rodolphe, elle persiste pourtant. « Ne croit-elle pas, en assistant à Lucie de Lammermoor, opéra tiré de Walter Scott, qu’elle « sais[ît] désormais la trivialité des passions que l’art amplif[ie] » énonce Flaubert. Pourtant, cette lucidité éphémère cède place à l’impulsion ; elle tombe dans les bras de Léon deux jours post-spectacle, espérant de nouveau vivre un amour extraordinaire. À l'image de sa maîtresse, ce jeune est aussi esclave de ses lectures, toutefois, contrairement à elle, il est protégé des excès par son ambition bourgeoise. Tel Emma Bovary, j’ai éprouvé, hier soir après une projection au Luxy, un cinéma d’Ivry Sur Seine privatisé par La Grande Distribution et Mediapart. Il y eut un moment ou mon imagination s’est enflammée quand, lors d'un débat sur le film présenté j’ai interrogé ses auteurs. Je me suis présenté comme un rédacteur assidu du blog de l’organisateur, les auteurs du film en posant une question " à côté de la plaque." Avant de poser cette question, j’ai réalisé mon envie de me profiler en tant que rédacteur fréquent d'un blog renommé, et la joie que ce rôle m'offre dans un pays où seulement 1% des autistes travaillent. Ce rôle consistant à écrire et faire des reportages m’amène vers un idéal, totalement fictif, qui hantait constamment Rodolphe, quand il dépeint sa maîtresse comme « l’amoureuse de tous les romans, l’héroïne de tous les drames, le vague elle de tous les volumes de vers » (p. 342). Il ne l’idéalise que sous cette condition, tout comme je glorifie mon rôle de blogueur, que j'expose dans des conférences de presse où j’interroge d'anciens prétendants à la présidence, à l'instar d'un journaliste aguerri. Néanmoins, rapidement, les émotions d'Emma et les miennes s'évanouissent, car la réalité invalide nos illusions, comme c'est toujours le cas avec les fantasmes romantiques dans Madame Bovary. Souvent, la réalité contredit mes fantasmes lorsque je dois expliquer à un groupe de personnes, après un film, que je suis atteint d'un trouble autistique. « Cela ne gêne-t-il pas dans votre profession ? » m’a interrogé une lectrice de Mediapart hier soir dans le métro. Face à cette question, je reste sans réponse, car je vis dans un déni partiel de ma condition et de mon quotidien.
L’aveuglement constant
L’aveuglement est l'un des thèmes majeurs de mon vécu et de l’œuvre de Flaubert. Dans Madame Bovary, trois personnages principaux en pâtissent. Vu son penchant pour ses lectures romanesques, Emma en fait partie. Elle fait preuve d'un manque de perspicacité alarmant concernant l'amour, croyant qu'il peut transcender les trivialités du quotidien et que le bonheur peut être perpétuel. J'agis de manière similaire en mettant en avant ma capacité à rédiger des billets pour le blog où ceux-ci seront publiés, m'inventant une carrière de journaliste sans détenir de carte de presse. Cependant, ce n'est pas le seul faux pas d'Emma, ni le mien, car elle manque cruellement de jugement sur elle-même et son mari, tout comme mon handicap entrave ma perception claire de ma situation professionnelle. Emma ne réalise pas l'indignité de solliciter Rodolphe pour de l'argent, malgré qu'il l'ait lâchement abandonnée et qu'elle l'ait tant détesté. En envoyant un mail à la responsable politique de L’Express pour postuler via LinkedIn, je n'ai pas non plus compris que je vivais dans une bulle, éloignée de ma réalité quotidienne. Ainsi, quand mon intervention a échoué hier soir au Luxy, je me suis senti aussi piètre que Charles Bovary, décrit dans ce passage où Emma réalise son échec sur Hippolyte : « Emma, face à lui, observait ; elle ne ressentait pas son humiliation, mais une autre : celle de s'être figuré qu'un tel homme puisse avoir quelque valeur […]. » (p. 245). Quant à moi, ce rôle fictif que je me crée, me confère-t-il de l'importance ?
Un peu de style
Les métaphores métonymiques, tirées de l'univers physique et psychique du personnage, rappellent à Emma sa réalité. Hier, mon intervention m'a aussi confronté à ma condition d'autiste avec des difficultés d'interaction sociale, capable d'interviewer Benoit Hamon ou Fabien Roussel un jour, et de rater lamentablement une question lors d'un débat le jour suivant. Emma, tout comme moi, nie sa « capacité à se percevoir autrement que ce qu'elle est », ce que Jules de Gaultier nommera le bovarysme. Dans son essai sur cette œuvre, il considère cette tendance d'Emma non comme une aspiration démocratique (l'ambition), mais plutôt comme un trouble psychologique. L'embarras public que j'ai vécu hier illustre comment cette tendance peut se transformer en une incapacité à être soi-même. Gaultier interprète ceci comme un phénomène historique, issu de l'exaltation des imaginations marquées par les grands événements de la Révolution et de l'Empire. En tant qu'homme de 2023, j'y vois une pathologie sociale, dans un monde où Instagram et Tiktok ont amené les gens à se croire stars ou journalistes, simplement capables de donner des instructions à ChatGPT ou de payer un loyer à Paris pour rencontrer des célébrités.
Critique de la modernité
Dans son autre étude sur le bovarysme, Jules de Gaultier identifie un autre facteur historique : la sécularisation. Comme vu précédemment, les critiques de l'ambition ne résonnent plus dans la France bourgeoise du XIXe siècle. La religion cesse de jouer son rôle social de modération des passions, d'inculcation de l'abnégation, et de rappel de la vanité des biens matériels. La visite décevante d'Emma chez Bournisien, incapable de l'apaiser spirituellement, symbolise cette faiblesse. Or, ce sont les catholiques qui ont été les premiers à s'engager en faveur de l'aide aux handicapés mentaux. La Croix était également le seul journal qui s'était engagé à me prendre en stage après mon école de journalisme, avant que mes soucis de santé me rattrapent. Dans ma vie personnelle, les bandes de potes " cathos militaires" où l'on faisait la prière avant de manger sont également les seules où l'on m'a considéré comme un " vrai ami". La défaillance totale de compassion des gens au Luxy hier soir, évidente lorsqu'une jeune libraire a affirmé que chez les gauchistes, tout est plus compliqué. « Embaucher des autistes en industrie ou en restauration les soumet aux standards du capitalisme », me confiait une libraire féministe hier soir, sans pouvoir nommer une entreprise « progressiste » n'employant pas exclusivement des diplômés de grandes écoles, j'ai eu la chance d'interroger quelques entrepreneurs engagés dans la transition écologique et sociale qui ont franchi le cap, ils sont peu nombreux; illustre que le militant moderne ne porte plus autrui dans son cœur. Il est trop absorbé par les ouvrages de Frédéric Lordon, ses manifestations répétées que m’a décrit un lecteur de Mediapart en soulignant l’irrelevance de ma question, et ses combats pour des causes environnementales. Quant aux rh de ces grands médias dit " de gauche", ils préfèrent me dire en entretien d'embauche " je ne veux pas te briser tes rêves", ou pointer toutes les atypies dans mon comportement pour me présenter comme une personne normale. " Je ne comprends pas le raisonnement des RH de Libé ou du Monde et tous ces médias de gauche, tu n'as pas cassé un verre ou hurlé dans un open-space" me confira autour d'un café chaud une entrepreneuse lorsqu'on évoquera ces faits dans une conférence autour de l'autisme et l'emploi.
Mais revenons aux lectures de Jules de Gaultier. Le futur percepteur à Dieppe, oppose alors, comme parangon, le percepteur de Yonville, Binet, qui a su trouver sa place et s'en satisfaire, occupé à façonner des ronds de serviette durant ses loisirs, sans autre aspiration. Ce n’est pas une remarque anodine : la louange de Binet remplit le dernier paragraphe de l'essai, tout comme mes éloges des jeunes handicapés travaillant en usine ou en restauration remplissaient mes discours lors de ce débat avec la libraire d'Ivry Sur Seine. J’ai tenté de peindre le portrait de cet autiste compensant son handicap intellectuel par un travail manuel, à l'instar de Flaubert qui a minutieusement dépeint le bonheur simple de Binet : "N’est-ce pas Binet, le percepteur, le véritable sage de l’œuvre, possédant un tour et trouvant une plénitude absolue à créer des ronds de serviette encombrant sa demeure « avec la fierté d’un artiste et l’égoïsme d’un bourgeois », ou « à sculpter en bois des objets complexes, formés de croissants, de sphères imbriquées, érigés comme un obélisque et inutiles » ? Et si le véritable sage de 2023 n'était-il pas l'entrepreneur employant des autistes en cuisine ou sur une chaîne de production chez L’Oréal ? La question mérite réflexion.
Lire autrement Madame Bovary
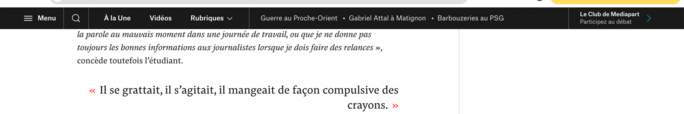
Agrandissement : Illustration 2
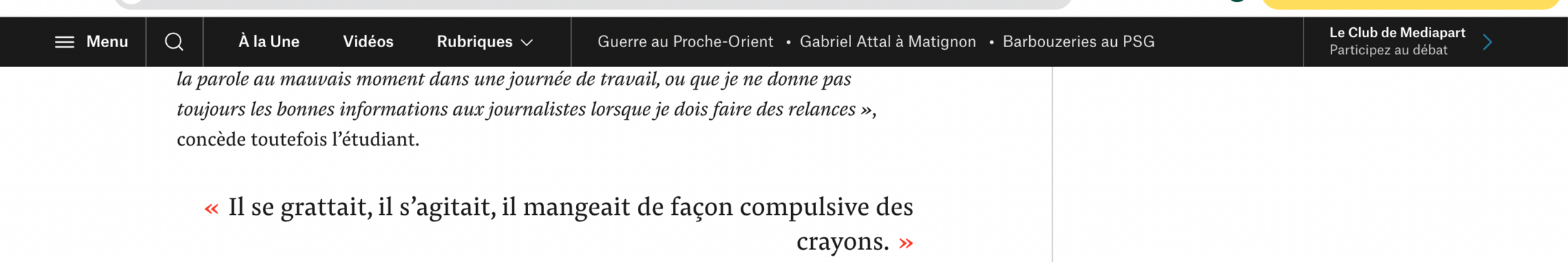
Ainsi, Jules de Gaultier, interprète de Gustave Flaubert, met en lumière, en parlant du percepteur Binet, les valeurs fondamentales de l’œuvre, transformant un personnage secondaire en porteur d'une importante leçon de vie. Cela me rappelle les enseignements de monsieur Tran sur l’entreprise Les Cafés Joyeux qui « emploie des autistes », pendant que Mediapart et Libération publient des articles détaillés sur nos particularités, expliquant comment « nous nous grattions », ou soulignant nos comportements inhabituels. Le bovarysme, se traduisant par « se bercer d'illusions », concernant un statut journalistique fictif, constitue pour moi un palliatif à l’ennui. Après qu’un journaliste de Mediapart a relaté dans un reportage mes « crises d’épilepsie » et autres troubles, en insistant sur ces aspects, je me suis créé une existence idéalisée, nourrissant l'espoir d'une réelle amélioration. Combien d'autistes, comme moi, fantasment sur une carrière professionnelle parfaite, tandis que leur réalité semble fade, et que dans nos pensées et sur les réseaux sociaux, tout paraît tellement plus attrayant ?