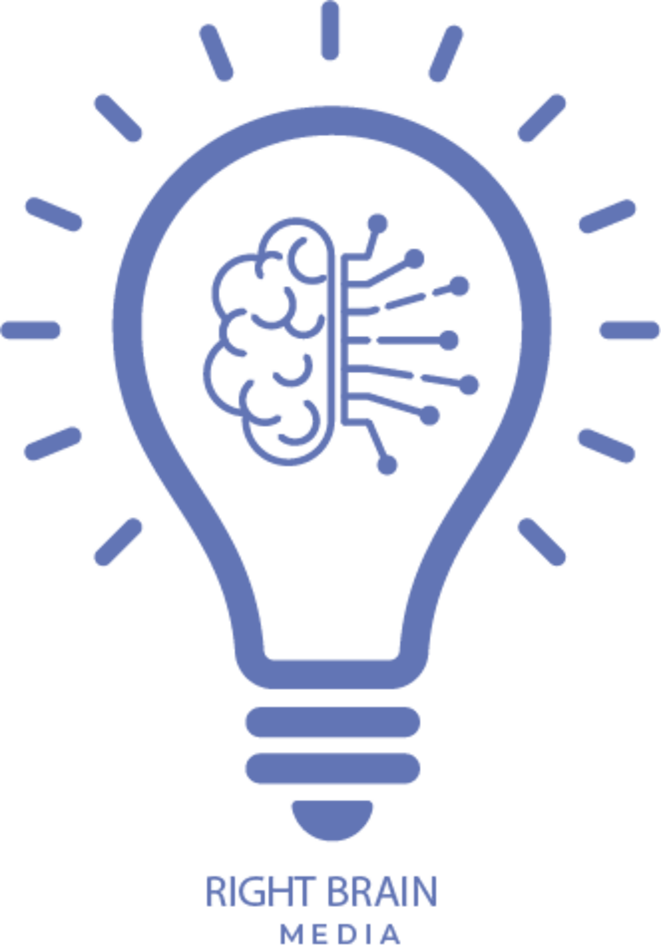Les tristes résultats des centres de bilan
Depuis l’accord interprofessionnel de 1970 et la loi de 1971 l’instituant comme une obligation légale, la formation professionnelle continue a été principalement conduite par les entreprises et les partenaires sociaux. Le rôle de l’État s’est affirmé progressivement dans ce domaine, au fur et à mesure de la montée du chômage à partir du milieu des années 70, après les premiers chocs pétroliers. Bien que les acteurs institutionnels aient en charge le contrôle de la formation professionnelle et fixent les normes légales et réglementaires, le responsable du système de formation professionnelle n'est pas toujours clairement identifié. Par conséquent, les compétences demeurent partagées. Ainsi, depuis 40 ans, les structures affiliées à l’AFPA ou l’AGEFIPH profitent de ce flou juridique pour transformer les handicapés en une main d’œuvre à bas coût pour les entreprises. Un spécialiste des questions de droit du travail témoigne : « L’AFPA et l’AGEFIPH travaillent en relation dans le réseau des CIBC (centres inter-institutionnels de bilans de compétences), collaborent avec la caisse primaire d’assurance maladie (en ce qui concerne les handicapés) et la Cotorep (gestion, évaluation et prise en charge des handicapés) pour mettre les personnes titulaires d’une RQTH au service des entreprises, les plaçant parfois n’importe comment sur des emplois précaires. » En effet, ce spécialiste de l'emploi évoque des dépenses démesurées ne bénéficiant pas réellement aux personnes titulaires d’une RQTH. « En 2020, selon les chiffres de L'Insee, les dépenses de formation continue et d’apprentissage s’élevaient à 19,9 milliards d’euros, en recul de 2,4 % par rapport à l’année précédente”. Les entreprises sont les principaux financeurs à hauteur de 34,1 % de la dépense totale (hors dépenses directes des entreprises). Néanmoins, de nombreux salariés en handicapés sont encore dans une situation de précarité scolaire et économique inquiétante. »
Un financement sur des secteurs en tension
Selon un rapport récent de La Cour des comptes, les principaux bénéficiaires des dispositifs de réinsertion professionnelle sont les demandeurs d’emploi (34,9 % des dépenses en 2020), puis les jeunes (33,2 %) et les actifs du secteur privé ayant un emploi (23,3 %). Néanmoins, la majorité de ces formations sont financées par des acteurs privés en quête d’une main d’œuvre rapidement opérationnelle. Le spécialiste des questions de droit du travail que nous avons rencontré se montre catégorique. « Allez demander à un Asperger de s’adapter à des métiers en tension où il sera constamment exposé au bruit et à la lumière, ou à un dys de faire un métier de bureau sans formation. Vous ne serez pas déçus. », clame-t-il sur un ton sarcastique. Enfin, ce marxiste assumé conclut que ce triste constat est lié à l’émergence du statut de cadre. « Comme l’expliquait parfaitement Frédéric Lordon dans son essai Capitalisme, désir et servitude, les cadres représentent le prototype du salariat que le capitalisme voudrait voir émerger, sans prendre en compte la contradiction manifeste qui, dans sa configuration néolibérale, tend aussi à régresser vers des formes plus brutales de coercition, notamment à l'encontre des personnes présentant des handicaps physiques ou invisibles tels que l’autisme et les troubles dys. Les différents partenariats que l’AGEFIPH signe avec de grands groupes tels que La Poste, Dassault ou Vente Privée en sont la preuve ».
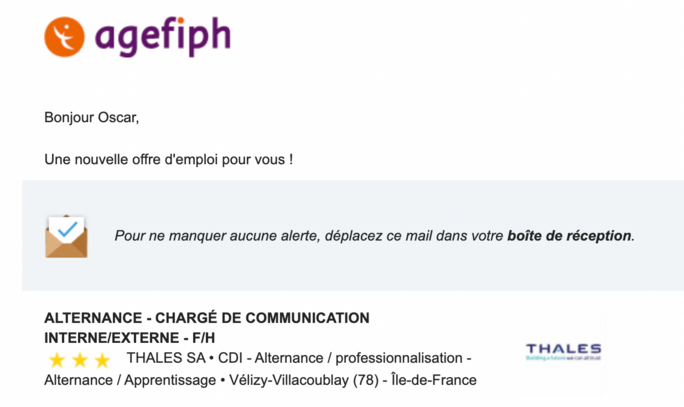
Agrandissement : Illustration 2
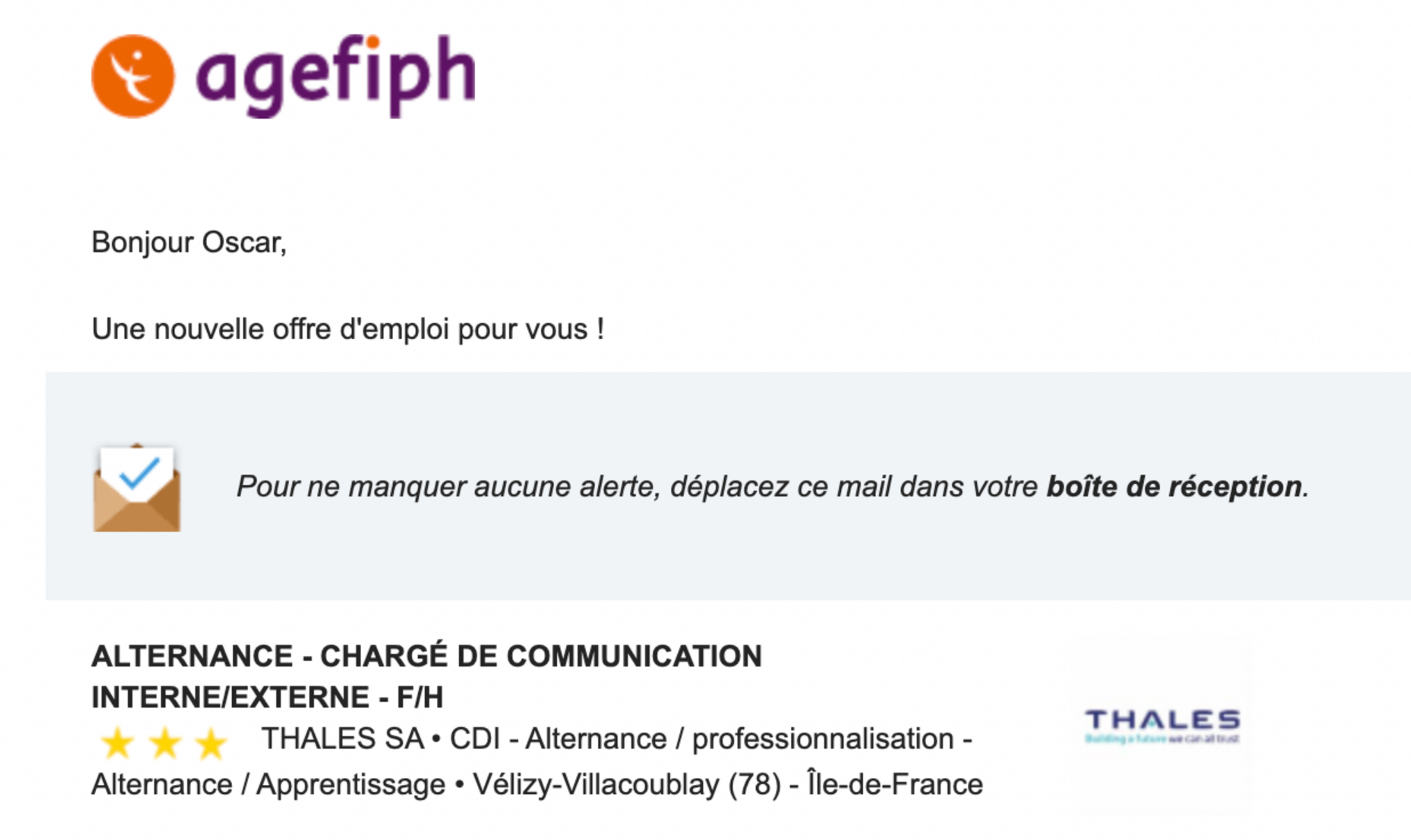
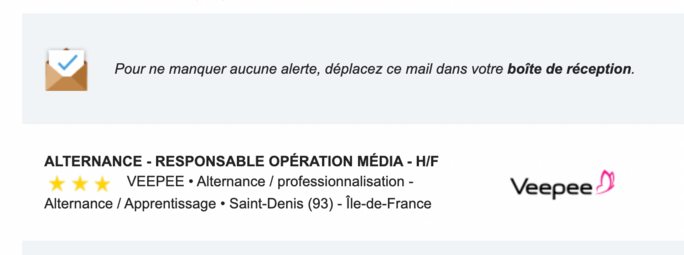
Agrandissement : Illustration 3
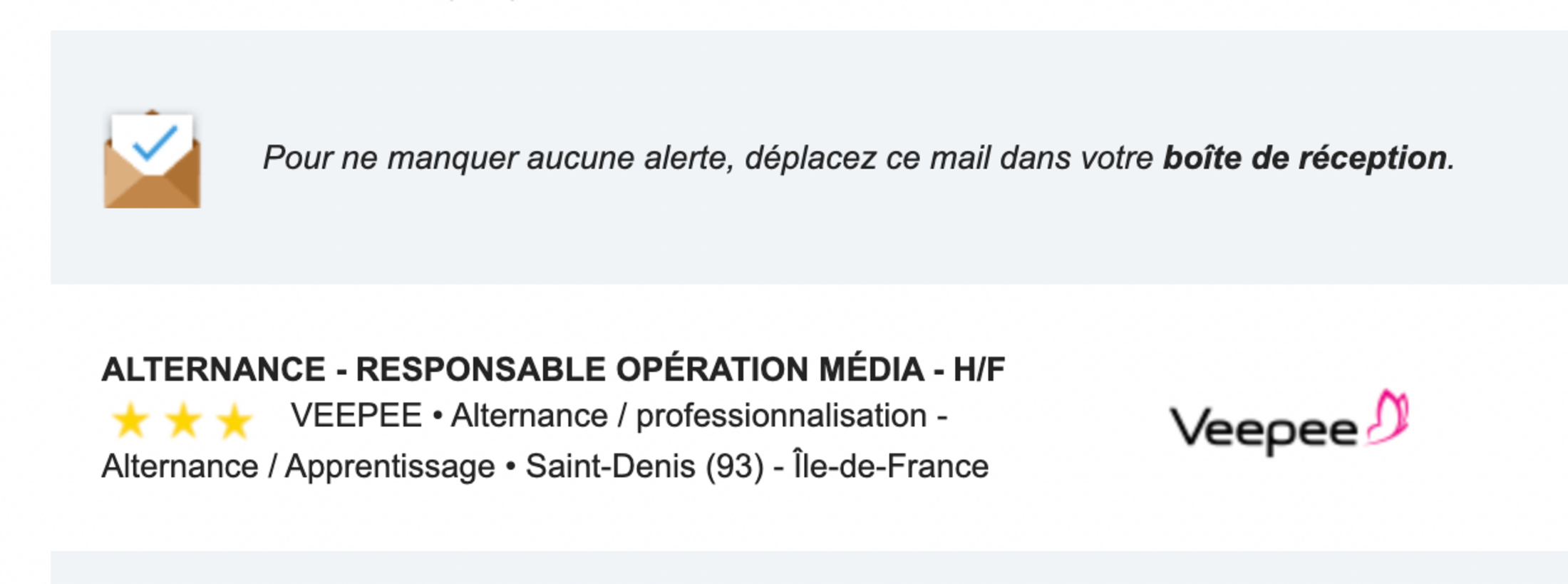
Une pluralité de formations inadaptées
Autoformation, formations organisées par l’entreprise, reprise d’études : l’offre proposée par l’État, les régions, les partenaires sociaux et les entreprises est vaste. Elle est dispensée dans de nombreuses structures (Greta, Afpa, Cnam…) et sous des formes variées, du stage présentiel au e-learning. Ainsi, en France, le nombre d'organismes de formation continue est en hausse constante. Selon la DARES, 45 777 établissements ont mené des actions de formation professionnelle, générant un chiffre d'affaires global de 8,9 milliards d'euros. Les organismes privés de formation, comme le groupe Omnes, représentent 94 % de ces structures et accueillent 85 % des stagiaires, générant 77 % du chiffre d'affaires total. Le marché de la formation professionnelle est ainsi prolifique et assez concentré : 2 % des organismes réalisent plus de trois millions d'euros de chiffre d'affaires, sans spécifiquement prendre en compte le handicap. Un avocat en droit du travail nous éclaire : « La durée maximale d'indemnisation d’un salarié en formation, qu’il soit handicapé ou non, est de 730 jours (24 mois). De plus, depuis le 1er février 2023 (hors Outre-mer), un coefficient réducteur de 0,75 (-25 %) est appliqué à la durée d'indemnisation, arrondie à l'entier le plus proche. La durée minimale d'indemnisation est de 182 jours. En fonction des situations, ces durées peuvent être ajustées, notamment jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein, que les salariés en situation de handicap atteignent rarement en raison des emplois précaires qu'ils occupent et des discriminations qu’ils subissent." À ce propos, un journaliste de Mediapart avait souligné dans une enquête que le fait d’être en situation de handicap en France multiplie par trois le risque de discrimination au travail. « Depuis bientôt cinq ans, le handicap est le premier motif de saisine de la Défenseure des droits en matière de discrimination, et l’emploi est le domaine principal où ces discriminations se manifestent », rappelait en 2021 Fabienne Jégu, conseillère auprès de la Défenseure des droits.
Des dispositifs d'insertion totalement bâclés
En France, tout est mis en place pour que la formation des salariés en situation de handicap soit organisée rapidement selon les souhaits du patronat, afin que les employeurs, face à une situation de handicap, disposent de la moindre information possible et ainsi évitent toute réticence. Un spécialiste des questions de santé au travail témoigne : « La durée d'indemnisation d’un salarié handicapé en formation est basée sur le nombre de jours calendaires, qu'ils soient travaillés ou non, compris entre le premier jour du premier emploi de la période de référence et la fin de cette période, qui correspond à la fin du contrat de travail. » Ainsi, les jours hors contrat et certaines périodes indemnisées - pouvant être utilisées pour diverses raisons (hospitalisation, séance d’ergothérapie, prise en charge de maladie professionnelle) - sont toujours déduits. De plus, les jours d'inactivité pris en compte pour le calcul de la durée d'indemnisation sont plafonnés à 75 % du nombre total de jours travaillés. Le juriste marxiste que nous avons interrogé conclut que ces politiques publiques ont favorisé la dépendance totale des personnes handicapées à la structure marchande du travail. « Depuis 200 ans, affirme-t-il, des économistes comme Karl Marx et Polanyi ont largement montré comment les conditions de la prolétarisation ont été établies, notamment par la fermeture des communs (enclosures). Après avoir orchestré un dénuement total des hommes, il ne restait d'autre choix que de vendre la force de travail, dépourvue de qualité et de qualification. » Ainsi, face aux idéologies néolibérales d'« enrichissement du travail », d'« autonomisation des tâches » et d'autres programmes de « réalisation de soi », ce juriste éminent rappelle qu'il ne faut pas oublier que le rapport salarial est, avant tout, un rapport de dépendance. « Dans ce rapport de force, structuré autour d'une lutte des classes, et notamment lorsque le salarié est en situation de handicap, son employeur et la mission handicap ont, avec le soutien de l'AGEFIPH et de l'AFPA, établi un rapport salarial basé sur la médiation de l'argent. » Nombre de salariés en situation de handicap vivent cette réalité au quotidien. L’un d'entre eux, ayant travaillé chez Sanofi, témoigne : « Dans les grands groupes, la transformation néolibérale avec ses spécificités suggère une rupture de la norme. Le numéro 2 du site de production où je travaillais, spécialiste du lean management et de l’optimisation des coûts, m’a recruté sans me demander si j’étais en situation de handicap. Ensuite, j’ai été isolé dans un bureau pendant toute mon année au sein du groupe, sans avoir de tâches précises à accomplir. » Les anciens managers du salarié, ainsi que les responsables de la mission handicap du site, n’ont pas souhaité répondre à nos sollicitations. Ainsi, avec le soutien de l'AGEFIPH, de l'AFPA et du gouvernement, un droit du travail dénué de moralité s’est imposé, ne reflétant qu'un rapport de force où certains détiennent tous les avantages et d'autres aucun, en défaveur des personnes handicapées. La capacité d'une entreprise comme Sanofi à mobiliser la force de travail en sa faveur, principalement par la réduction des coûts et le manque d'effort dans les stratégies d'inclusion menées par la responsable du groupe, Isabelle Senges, témoigne d'un désir hégémonique débridé.