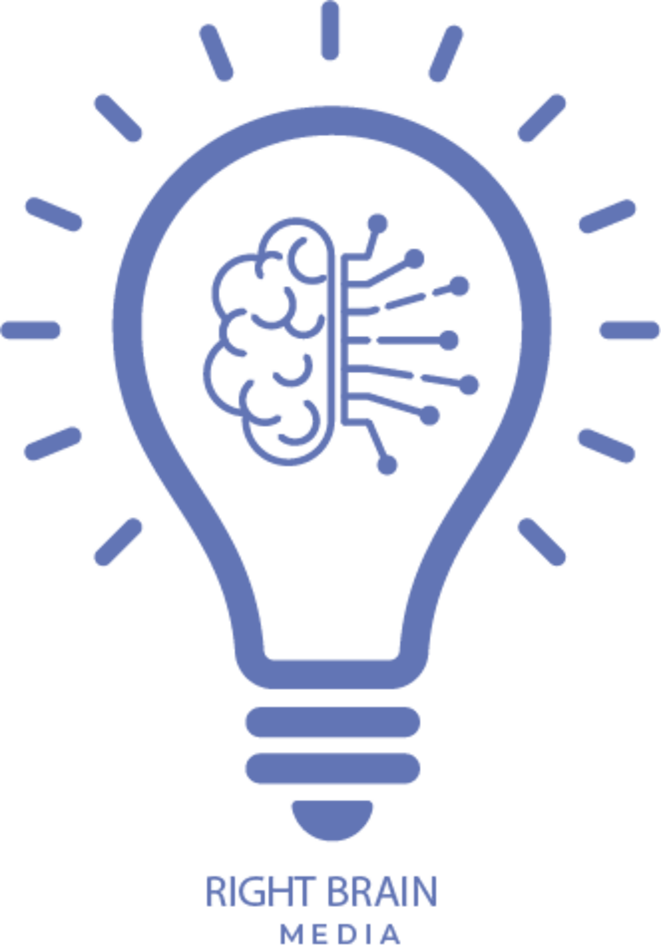Aux origines de l’Hindouisme
Dans son essai paru en 2021, intitulé "L'Inde : une société de réseaux", l'ethnologue Sandrine Prévot défend l'idée selon laquelle la quête des fondements de l'identité hindoue remonte à la période précédant la conquête musulmane de l'Inde, soit entre le IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Elle souligne que cette recherche des origines hindoues a entraîné une réécriture de l'histoire. Ainsi, l'ancienne civilisation de l'Indus est présentée comme une civilisation védique, remettant en question les racines indo-européennes des Veda et du sanskrit, et leur attribuant plutôt une origine indigène.
L’Hindouisme, un extrémisme religieux ?
En tant que notion religieuse restrictive, l'hindouïsme devrait assimiler chaque Indien à l'indianité, qui est une notion socio-culturelle plus vaste signifiant "être Indien" et englobant tous les Indiens, quelle que soit leur religion. Ainsi, Sandrine Prévot définit l'hindouïsme comme "une doctrine fondée sur l'attachement à la terre ancestrale, délimitée par l'Himalaya et les océans, considérée comme la mère-patrie. Les liens du sang, hérités des ancêtres, forgent l'appartenance à la "race hindoue, indépendamment des unions intercastes qui ont pu avoir lieu". Ainsi, la revendication d'appartenir à la culture et à la civilisation hindoues se construit en célébrant des figures historiques vénérées en tant que héros, en participant à des fêtes communes, en suivant des rituels et des sacrements partagés, ainsi qu'en respectant des lois communes. Un professeur de Sciences Politiques de l'université Lyon 2 témoigne: " Le phénomène hindouïste se révèle d'autant plus complexe qu'il se situe à l'intersection de plusieurs domaines : sociologique (statut social), idéologique (laïcité, liberté de conscience), mythologique (psychologie de masse identitaire, mythe fondateur), historique (perspective à long terme et sentiment de victimisation), culturel (identité nationale ou supranationale), et enfin, et surtout, conflictuel (terrorisme, invasion, violence épuratrice et sanctifiante)."
Un amalgame est ainsi établi entre identité religieuse et nationalité. Les extrémistes hindous font valoir la notion d'hindouïté (hindutva), introduite en 1923 par Vinayak Damodar Savarkar, alors emprisonné aux îles Andaman pour ses activités antibritanniques. Son ouvrage intitulé "Hindutva, Who is a Hindu?" pose les bases de cette notion. Dans son essai paru en 2022 aux éditions Ellipses, intitulé "La géopolitique au défi de l'islamisme", Alexandre Dénécé souligne que selon Savarkar, cette affirmation de l'identité hindoue est nécessaire non seulement vis-à-vis des autres religions présentes en Inde, mais aussi envers les musulmans et les chrétiens qui, du simple fait d'être nés en Inde, se considèrent comme Indiens. Ainsi, il est évident, poursuit Savarkar, que si de nombreux chrétiens et musulmans (dont les ancêtres étaient autrefois hindous avant leur conversion) peuvent revendiquer les deux premiers critères, ce n'est pas le cas en ce qui concerne le troisième critère. Par conséquent, les chrétiens et les musulmans ne peuvent être considérés comme faisant partie de la nation hindoue. Pour Savarkar, le problème est avant tout d'ordre culturel plutôt que religieux. Il précise même : "Certains d'entre nous sont monothéistes, d'autres panthéistes, certains sont théistes, d'autres athées - nous sommes tous hindous et partageons le même sang. Nous ne sommes pas seulement une nation, mais une race, une fraternité de naissance."
L'hindutva et la négation du social
Dans cette "autocratie électorale", l'objectif de l'idéologie hindutva est d'affirmer la suprématie des valeurs hindoues en Inde par rapport à celles des autres religions. Ainsi, ce suprémacisme entraîne une marginalisation croissante des minorités chrétiennes et musulmanes. À partir des années 90, des programmes éducatifs sont adaptés et modifiés : dans l'Uttar Pradesh, les empires moghol et britannique sont supprimés des manuels d'histoire, et au Rajasthan, le nom de Nehru, défenseur du sécularisme, est omis. En 1995, lorsque le parti nationaliste hindou Shiv Sena accède au pouvoir, Bombay est renommée Mumbai, en référence à ses racines marathis. Des initiatives similaires ont été prises dans d'autres régions du pays. Sandrine Prévot explique que cette volonté de renommer les lieux vise à réaffirmer l'identité hindoue et à effacer les influences perçues comme étrangères. Cependant, peu de mouvements radicaux se constituent en tant que partis politiques, à l'exception du BJP indien.
Les projets politiques de Modi
Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le BJP se réclame de l'hindouisme et de la doctrine hindutva. Cette théorie politique considère que la religion est le seul moyen de perception de la réalité sociale. Ainsi, ses défenseurs, souvent extrémistes, ignorent le fait que tous les individus appartenant aux différentes communautés religieuses sont socialisés au sein de la même société, fréquentent les mêmes écoles, évoluent dans le même environnement économique et juridique, partagent les mêmes codes sociaux, la même langue, ainsi que des pratiques alimentaires ou des goûts artistiques similaires, etc. En mettant l'accent sur l'identité confessionnelle, Modi encourage la ferveur religieuse et enferme les individus dans des positions partisanes. Cela peut conduire à un conservatisme rigide, alimentant ainsi la crainte de voir cette démocratie laïque se transformer en un État hindou théocratique. De nombreux intellectuels occidentaux, attachés aux libertés individuelles et aux droits de l'homme, s'opposent vivement à Modi et à l'idéologie hindoue. Ils soulignent que l'identité sociale des individus ne peut être réduite à leur seule affiliation confessionnelle.
"De nombreux autres critères, tels que le genre, la catégorie socio-professionnelle, la caste, l'âge, etc., interviennent également", explique Alexandre Dénécé dans son essai "La géopolitique au défi de l'islamisme". Hier, des journalistes du Monde entier révélaient également que tous les indicateurs illustrant la dérive autoritaire actuelle de l'Inde sont en hausse : l'ONG américaine Freedom House a rétrogradé la République indienne du statut de "démocratie libre" à "démocratie partiellement libre" en 2021. En raison de la multiplication des intimidations et des attaques contre les militants et les journalistes, Reporters sans frontières a classé l'Inde à la 161e place sur 180 pays dans son rapport de 2023. Enfin, il est remarquable de constater qu'il est totalement inédit dans l'histoire de l'Inde de voir un chef politique fusionner en quelque sorte l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Plusieurs indices témoignent du fait que l'Inde se dirige ainsi vers une forme de théocratie, en entretenant une confusion des genres au détriment des minorités musulmane et chrétienne. Cela se manifeste, par exemple, par un durcissement des lois anti-conversions à travers le pays. Narendra Modi lui-même est entré au RSS dès l'âge de 7 ans dans son Gujarat natal, et il a été marié enfant, afin de se consacrer pleinement à la cause de l'organisation depuis 2001 au Gujarat.