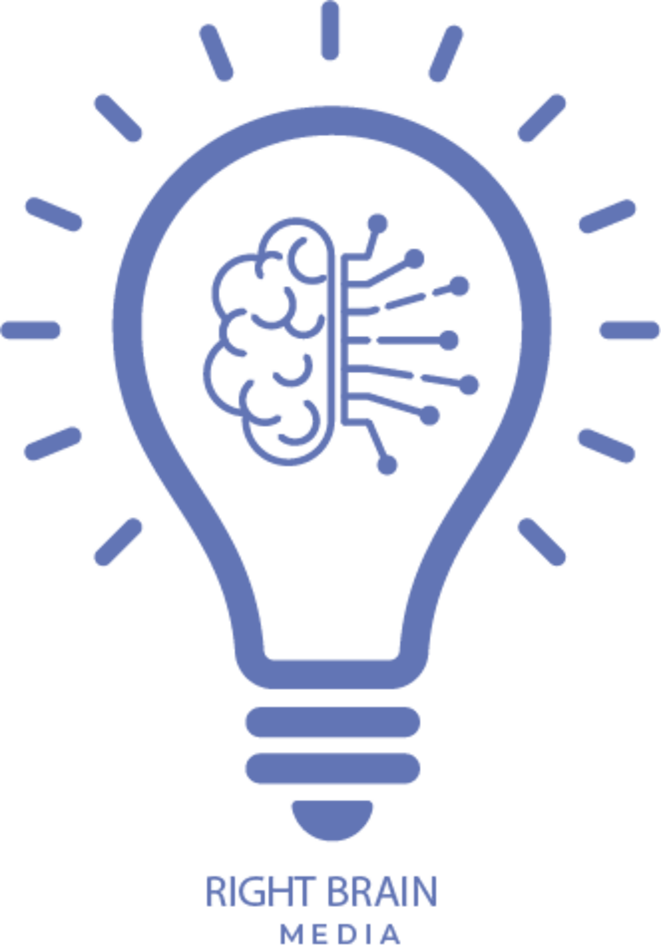Représentation de la vierge Marie dans le dictionnaire philosophique
« Des discussions persistent quant à la filiation de Jésus : serait-il le descendant de Marie plutôt que de Joseph ? De nombreux débats entourent les miracles du Christ, faisant référence à des penseurs comme Saint Augustin et Saint Hilaire qui ont souvent donné une interprétation mystique ou symbolique à ces événements. Toutefois, face à ces remises en question, la foi se renforce et reste indéfectible. » Dans cet extrait de son dictionnaire philosophique publié en juin 1764, Voltaire donne une perspective sur la naissance du messie. Il argumente en faveur de l'idée que Jésus aurait vécu en suivant la loi juive, honorant chacune de ses règles et festivités. « Il n'a jamais évoqué sa naissance immaculée auprès des Israélites, déclare-t-il, ni créé de structure cléricale. Pareillement, il n'a jamais mentionné les sept sacrements ni dévoilé les profonds mystères de son essence divine. Sa vie entière a été vécue en respectant la tradition de ses prédécesseurs, se positionnant comme un homme vertueux persécuté et finalement exécuté. C'est l'Église fondée après lui qui a pris la suite. » De ce fait, Voltaire admet, à l'instar d'Éric-Emmanuel Schmitt dans sa dernière œuvre Le Défi de Jérusalem (Albin Michel, 2023), que Dieu demeure impalpable ; nous ne le percevons qu'à travers ses actions. Par conséquent, pour cerner sa véritable essence, Voltaire suggère dans son dictionnaire philosophique de se pencher sur ses réalisations. « Bien que nos croyances puissent toutes être fondées, insiste-t-il, leur pertinence diffère. Célébrer la magnificence de Dieu n'est pas crucial, mais il est impératif pour la société et ses citoyens de comprendre et d'adhérer aux devoirs que la loi divine impose envers les autres et envers soi. C'est ce savoir que nous devons perpétuellement diffuser et que les générations futures doivent hériter. » En fin de compte, à travers cet hommage appuyé au Christ et à son créateur, Voltaire affiche sa dévotion envers les icônes du christianisme, souvent négligée par les critiques de son temps pour des raisons idéologiques. Certains experts, majoritairement critiques envers le catholicisme, préfèrent se pencher sur une œuvre moins complexe de Voltaire, perçue comme anticléricale, telle que « Candide ou l’Optimisme ».
Candide : une œuvre anticléricale dans la pensée de Voltaire ?
François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire, explore les thèmes religieux dans son célèbre roman "Candide ou l’Optimisme", étudié par des générations de lycéens. Dans son guide essentiel de la littérature, intitulé "101 Repères", Francis Collet ( Ellipses, 2022) indique que Voltaire s'oppose, dans ce livre, à la théorie de Leibniz qui postule que nous existons dans "le meilleur des mondes possibles". « Selon Leibniz, précise-t-il, chaque chose a une raison d'être et l'univers suit une "harmonie préconçue". Cependant, à travers Candide, Voltaire se moque de cette idée en soulignant la prévalence du mal. ». Ainsi, Francis Collet, avec l'appui d'un autre agrégé de lettres modernes, Gérard Loridan, suggère que pour Voltaire, il est essentiel de s'attaquer aux véritables maux, notamment les problèmes sociopolitiques tels que la guerre ou l'extrémisme religieux. « Voltaire, affirme Loridan, croit que même si nous ne pouvons parvenir à une perfection, nous avons le devoir d'agir pour un monde plus équitable. ». De plus, Francis Collet interprète la célèbre phrase "Il faut cultiver notre jardin" comme une illustration de la pensée voltairienne qui conteste tout fanatisme. « Le "jardin", interprète Collet, représente la sphère personnelle, ses frontières, et l'acceptation que l'idéal est inatteignable. » À l'intérieur de ces frontières, Voltaire percevait une harmonie et un développement contraire aux préceptes ecclésiastiques. « Le mot "notre" souligne l'effort collectif nécessaire. L'humain se doit ainsi de "cultiver" activement son "jardin", c'est-à-dire de contribuer au bien-être individuel et collectif. » Bien que cette idée puisse évoquer l'esprit des Lumières, elle ne préfigure pas forcément des courants fortement anti-religieux comme l'existentialisme. Même s'il a mis en lumière l'importance de la liberté individuelle et de la responsabilité personnelle, Voltaire demeurait un fervent catholique, contrairement à Rousseau qui s'est souvent opposé à l'église.
Rousseau l’anticlérical
« Bien que les nuances théologiques, telles que la conception de la Vierge Marie ou la doctrine trinitaire de Dieu, puissent paraître cruciales, elles ne touchent pas directement la réalité humaine. Les traditions religieuses, qu'il s'agisse de rites ou de jeûnes, relèvent du choix individuel. » Ce passage, tiré de l'ouvrage renommé l’Émile ou De l'éducation (1762), met en lumière la pensée de Rousseau : l'essentiel réside dans l'adhésion à un Dieu supérieur, garant de notre destinée, qui nous invite à agir avec justice, bienveillance et à honorer nos promesses. « Ces principes fondamentaux, insiste-t-il, doivent être inculqués et solidement établis parmi la population. Ceux qui les remettent en cause déstabilisent la cohésion sociétale. ». Ces lignes laissent entrevoir les prémices d'une œuvre majeure, fréquemment étudiée en cours de philosophie ou lors de la préparation au prestigieux concours de Sciences Po Paris : Du Contrat Social. Un érudit de Rousseau, également formateur en philosophie et préparateur aux épreuves communes de Sciences Po, nous confie : « Dans le dernier livre Du Contrat Social, Rousseau argue que l’Église a autrefois défendu l'idée d'une communauté spirituelle qui s'est concrétisée. Cependant, il assimile cette communauté à une variante de paganisme car, selon lui, l'Évangile ne préconise pas de religion nationale, rendant ainsi les croisades inenvisageables pour les chrétiens. » Par conséquent, le distingué professeur conclut que, lorsque les monarques ont embrassé le christianisme, cette ardeur s'est dissipée, marquant un déclin de la vertu romaine.
Retour à la théorie politique
L'expert en philosophie que nous avons interrogé perçoit chez Rousseau une profonde considération pour les fondements du droit. « Lorsqu’il écrit Du Contrat Social, il argumente que la prérogative du souverain ne devrait s'exercer sur ses citoyens qu'en faveur du bien commun. De cette manière, Rousseau postule que les convictions personnelles n'engagent l'État que lorsqu'elles contribuent bénéfiquement à la collectivité. » De ce fait, il en conclut, contrairement à Voltaire, que tout individu devrait embrasser une foi promouvant la civilité, cependant les spécificités de ses croyances demeurent secondaires tant qu'elles ne portent pas préjudice à la communauté. Toutefois, le distingué théoricien nous souligne que, selon Rousseau, l'intolérance en matière de foi exerce inévitablement une répercussion sur la société.
« Quand la religion influence la politique, les prêtres dominent, et les dirigeants deviennent secondaires. »
« La parole du Christ illustre une acuité d'esprit impressionnante, une précision et une pertinence dans ses propos inégalées. Son contrôle sur ses émotions est sans pareil. Quel sage ou mortel peut revendiquer agir, endurer et trépasser avec autant de ténacité et de discrétion ? Lorsque Platon dépeint son homme intègre, injustement diffamé malgré toutes ses vertus, il semble évoquer Jésus. La similitude est tellement frappante que nombre d'intellectuels l'ont notée. » Tirée de l’œuvre L’Émile ou De l'éducation, cette profonde réflexion de Rousseau renvoie tant à l'existence de Jésus qu'au livre VI de "La République", où Platon discute de la formation des philosophes, vus comme les seuls compétents pour gérer les enjeux politiques. De ce fait, pour Rousseau, Jésus, tout comme Socrate et quelques autres, appartient à cette élite d'individus ayant une perception élevée du bien. L'expert que nous avons sollicité confirme. « Cette perception est centrale tant pour Platon que pour Rousseau, car ils plaident en faveur d'une direction juste et éthique du peuple. » Ainsi, Rousseau en arrive à se questionner : peut-on juxtaposer Socrate et le Christ ? « Même si le trépas de Socrate fut sans souffrance ni déshonneur, il aurait pu être vu comme un simple rhéteur si sa fin n'avait pas consacré sa vie. D'un autre côté, d'où le Christ a-t-il puisé cette éthique si noble qu'il n'a pas seulement professée, mais aussi incarnée ? Comment un tel discernement a-t-il pu jaillir de l'ardeur du zèle ? ». Par conséquent, Rousseau suggère que, à l'image des dialogues de Platon concernant son mentor, les témoignages des Évangiles sont peut-être construits. Cependant, les faits relatifs à Socrate, communément admis, sont moins bien établis que ceux du Christ. De ce fait, il déclare dans L’Émile. « Soutenir que l'Évangile est une fiction collective soulève davantage d'interrogations qu'il n'apporte de réponses. L'Évangile démontre une sincérité et une exactitude telles que son auteur serait davantage prodigieux que son protagoniste. Néanmoins, il renferme également des aspects qui défient la logique. » Face à ces ambivalences, Rousseau s'interroge dans L’Émile sur la démarche du philosophe et affirme. « La réserve et la circonspection sont primordiales. Nous devons vénérer ce que nous ne pouvons ni contester ni saisir, et nous incliner devant la toute-puissance de Dieu, dépositaire de la vérité ultime. »