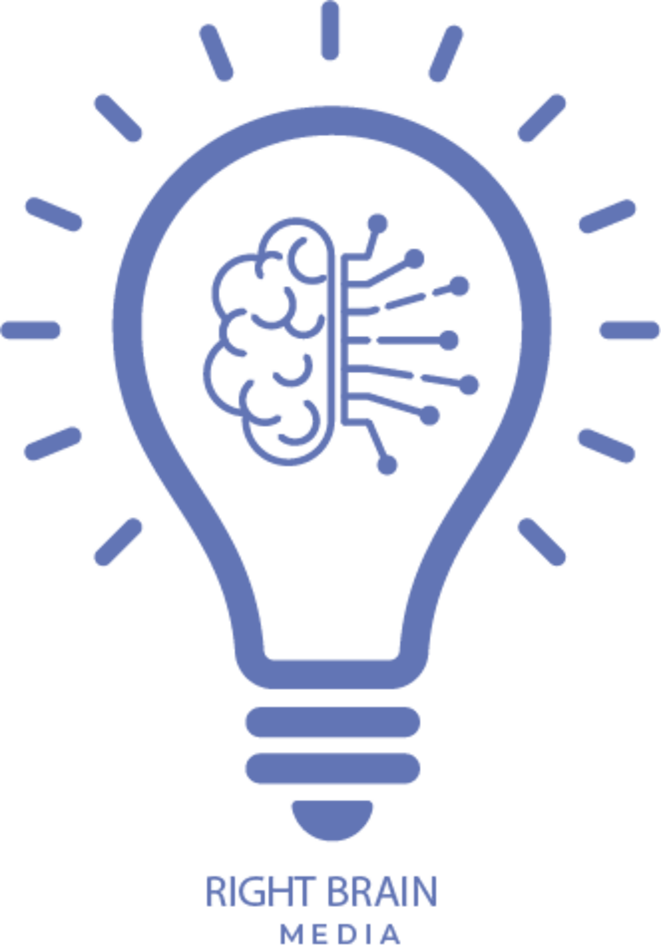Beaucoup de documents stratégiques ont été validés sans contrôle de la Dreets
Cette semaine, la Cour des comptes a livré un rapport critique sur la politique d'égalité entre les femmes et les hommes initiée par le gouvernement depuis 2017. Malgré l'affirmation constante d'Emmanuel Macron de faire de cette thématique la grande cause de son quinquennat, en 2017, 2020 et 2022, l'impact est jugé trop modeste, notamment au sein des entreprises du CAC40. La Cour pointe notamment un manque de coordination entre les différentes initiatives lancées. Bien que de nombreux documents stratégiques aient été rédigés pour établir une feuille de route interministérielle et que le budget pour les droits des femmes ait augmenté, ces fonds restent jugés limités. Des organisations comme Oxfam France, CARE et le Planning familial soulignent le manque de résultats du premier quinquennat d'Emmanuel Macron en matière de droits des femmes et de luttes. Un enseignant du Cevipof nous indique qu'elles mettent en avant des déficits dans la mise en place des mesures. Beaucoup d'entre elles étant dépourvues de moyens, de calendriers précis, d'indicateurs de performance ou de cibles, compliquant ainsi leur évaluation. Amanda, référente diversité et inclusion dans un groupe pharmaceutique majeur, témoigne : « Les stratégies d’égalité homme/femme sont dictées par des accords d’entreprise contenant des clauses spécifiques sur l'égalité professionnelle. Si ces obligations ne sont pas respectées, des sanctions sont prévues, mais rarement appliquées. » La jeune cadre diplômée d'HEC nous rappelle toutefois que les entreprises comptant plus de 1 000 salariés ont l'obligation de publier annuellement les écarts de représentation entre les sexes dans leur encadrement et leurs instances dirigeantes (C. trav. art. L 1142-11). Les données comprennent le pourcentage de femmes et d'hommes parmi ces cadres (C. trav. art. D 1142-15). Ces informations doivent être divulguées au plus tard le 1er mars pour l'année précédente, soit sur le site internet de l'entreprise, soit par un autre moyen de communication aux salariés. Elles doivent également être transmises à l'administration via une téléprocédure et partagées avec le CSE (C. trav. art. D 1142-16, D 1142-19).
Petits arrangements tacites entre les syndicats des holdings françaises
Amanda précise que les employeurs ont la possibilité de négocier avec les délégués syndicaux un plan spécifique à l'égalité professionnelle, envisageant ainsi des mesures favorisant les femmes en termes d'emploi et de qualification (C. trav. art. L 1143-1). Cependant, bien souvent, ces négociations n'aboutissent pas. Selon Amanda, on observe une augmentation des accords d'égalité professionnelle non ratifiés par la Dreets, fruit de compromis entre les représentants des salariés et du patronat, ces derniers évitant de trop perturber l’image de l'entreprise. Elle estime que les plans soumis par les entreprises du CAC 40 à la Dreets manquent d'ambition. « Aujourd'hui, il est rare que la Dreets approuve les plans d'égalité hommes/femmes proposés par les grands groupes. De ce fait, l'acceptation tacite de ces plans est devenue courante (C. trav. art. L 1143-3 et D 1143-6). » Elle note d'ailleurs qu'il lui est difficile d'identifier un plan d'une entreprise cotée en bourse qui intégrerait des mesures comme des formations exclusivement destinées aux femmes ou des objectifs de nomination spécifiques pour elles (Circ. du 2-5-1984 no3-2-3-2). Néanmoins, la nouvelle ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, exprime sa détermination à adopter une nouvelle méthode et approche, contrastant avec celle de sa prédécesseure, Marlène Schiappa, qui avait initié 119 initiatives entre 2017 et 2019. Elle faisait récemment valoir à des journalistes de Mediapart que, selon sa lecture, la Cour des comptes reconnaît des progrès accomplis, mais suggère qu'il faut "améliorer la coordination des efforts." Toutefois, la Cour des comptes exprime des inquiétudes concernant les futurs plans du gouvernement. Bien que Bérangère Couillard ait fait notamment référence au nouveau plan interministériel pour l'égalité femmes-hommes présenté en mars dernier par la première ministre, Elisabeth Borne, peu d'éléments concrets ont été donnés. La Cour des comptes critique ce plan présenté à Elisabeth Borne, estimant qu'il se contente de formuler des annonces générales sans véritablement répondre à des besoins spécifiques qui n'ont pas encore été clairement définis. Pour conclure son rapport, la Cour des comptes recommande la création d'un plan d'action clair, accompagné d'objectifs quantifiés pour assurer la mise en œuvre effective des initiatives en faveur de l'égalité femmes-hommes. La ministre Bérangère Couillard a répondu à cette recommandation en s'engageant, lors d'une interview à Mediapart, à suivre cette directive.
De fortes disparités hommes/femmes subsistent
Le rapport présenté ce jeudi pointe du doigt une progression lente de l'égalité salariale au sein des grands groupes et de la fonction publique. L'écart salarial, qui est de 14% entre hommes et femmes, est resté constant entre 2015 et 2020. En effet, depuis 2019, 42 000 interventions ont été faites par l'inspection du travail sur l'égalité professionnelle, menant à 695 mises en demeure et 42 sanctions pour non-publication ou absence de mesures adéquates.Pour une meilleure mise en application de la politique d'égalité, la Cour préconise l'élaboration d'une feuille de route concrète et évaluable pour le plan interministériel 2023-2027 relatif à l'égalité des sexes. Bérangère Couillard plaide également pour un programme qui évalue les actions menées par l'État ainsi que par les organismes qu'il subventionne. Pourtant, selon Amanda, des programmes favorisant la parité ont déjà été adoptés. « À compter du 1er mars 2026, les grandes entreprises seront tenues d'atteindre un certain quota de femmes parmi leurs cadres dirigeants, qui sera fixé à 30% en 2026 et qui augmentera à 40% en 2029 », nous explique cette responsable diversité/inclusion d'un groupe pharmaceutique. En effet, dès 2026, les entreprises avec une note inférieure à 85/100 devront fixer et publier des objectifs sur leur site. Si elles ont moins de 75/100, elles doivent établir et publier des mesures correctives. Sans publication ou en cas de mesures inefficaces, elles risquent une pénalité de 1% de leur masse salariale annuelle. Pour les aider, le ministère du Travail a créé un site de questions-réponses (egapro.travail.gouv.fr). Des référents, peu efficaces selon Amanda, sont aussi disponibles pour soutenir les entreprises. Olivier Dussopt, ministre du Travail, clamait même il y a quelques jours : " En 2023, les écarts salariaux inexpliqués entre sexes sont inacceptables. Les entreprises doivent aussi favoriser une meilleure représentation de chaque sexe." Cependant, tous les dispositifs législatifs ont déjà été mis en place. D'ici le 1er mars 2029, toutes les entreprises ne respectant pas ces règles s'exposeront à une amende pouvant s'élever à 1% de leur masse salariale (C. trav. art. L 1142-11, L 1142-12, L 1142-13). Amanda ajoute que cette condition s'applique également aux aides d’État : « Pour bénéficier d'une subvention de l'État sous forme de contrat, les entreprises doivent avoir démontré un engagement en faveur de l'égalité professionnelle ou de la diversité des emplois, par exemple en signant un accord d'égalité ou en mettant en œuvre des mesures en faveur de la diversité des métiers, comme le stipule le Code du travail (C. trav. art. D 1143-8)." Une obligation très peu respectée par les entreprises françaises cotées au Cac40 selon Amanda.
Des contrats peu concluants
Amanda, experte en égalité professionnelle, souligne l'importance du suivi lorsqu'une grande entreprise s'engage en matière d'égalité et de mixité au travail. Conformément à l'article D 1143-16 du Code du travail, le comité de direction des entreprises cotées en bourse est dans l'obligation d'informer le Comité Social et Économique (CSE) sur l'avancée des engagements pris. Amanda insiste sur le fait que cette communication devrait s'aligner avec le calendrier de distribution des aides financières, comme stipulé dans la Circulaire du 2-5-1984. Cependant, la spécialiste regrette le manque de validation des rapports transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et au responsable départemental chargé des droits des femmes et de l'égalité, tel que mentionné dans l'article D 1143-17 du Code du travail. Elle observe que les grandes entreprises accumulent des sanctions financières en raison de leur faible engagement envers la parité. « Nous constatons une tendance où ces entreprises préfèrent s'acquitter des amendes associées à l'index d'égalité hommes/femmes, comme le définit l'article L 1142-10 du Code du travail. Enfin, il est à noter, selon l'Instruction DGT du 25-1-2019, qu'un employeur déjà sanctionné pour des résultats insatisfaisants sur cet index ne peut subir une seconde pénalité pour le même grief. » Enfin, concernant les sanctions liées à la non-divulgation des indicateurs de l'index ou à l'absence d'un plan de réajustement salarial, Amanda précise que des dispositions spécifiques sont en place.