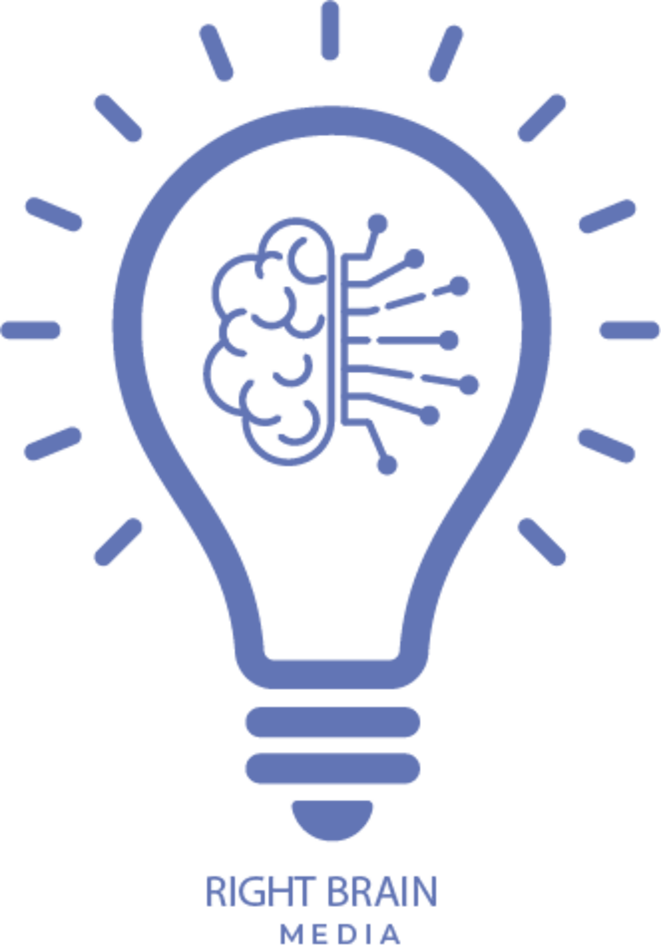Un adolescent romantique et tourmenté
L'auteur de "Madame Bovary" est souvent présenté comme un écrivain misanthrope, ressentant un isolement et une différence vis-à-vis des autres, tout en ayant un désir intense de briser cette solitude en cherchant l'amitié et l'amour. Avant de faire sienne cette vie solitaire, rappelant celle des autistes ayant des troubles sociaux, Flaubert a voulu briser une coquille pour plaire et complaire à son entourage. C'est ainsi que cohabitent en lui les deux Flaubert : le bruyant écolier qui fanfaronne ses expériences avec des prostituées, multiplie les calembours et invente des blagues scatologiques – en un mot, un jeune homme qui aime la vie et semble très aimé d'elle ; et d'un autre côté, le garçon tourmenté, renfermé et constamment stimulé sur le plan intellectuel. Puis, au stade terminal de sa jeunesse, Flaubert s'isole pour mettre fin à la hurle métaphysique et à l'exorde romantique tout en commençant à privilégier son travail sur le style, similaire à celui qu'un autiste pourra faire sur une machine ou un calcul mathématique complexe. Bien qu'elles puissent être considérées comme un premier procès contre les poètes romantiques, ses premières nouvelles contiennent de nombreuses fioritures stylistiques et autres mièvreries discursives typiques de l'époque romantique.
L’émancipation du romantisme
Comme beaucoup d'écrivains de sa génération, Flaubert use également de procédés rhétoriques pour peindre les pensées-images qui le hantaient et les hallucinations qui ne le quittent plus. La scène inoubliable de sa première rencontre amoureuse racontée à l'aide d'une hypotypose le montre bien: « Bien vite, d'un bond joyeux, elle sauta jusqu'à moi et me serra dans ses bras. Ce fut là pour nous une de ces étreintes frissonnantes, telles que les amants, la nuit, doivent en avoir dans leurs rendez-vous, quand, après avoir longtemps, l'œil tendu dans les ténèbres, guetté chaque froissement des feuilles, chaque forme vague qui passait dans la clairière, ils se rencontrent enfin et viennent s'embrasser » (I, p.792-793). Enfin, même si Flaubert essaie déjà à travers ces textes de dépouiller le style de "Madame Bovary" et de chasser le plus que possible métaphore et comparaison, son tempérament autistique s'impose, et des problèmes relatifs à l'écriture des images qu'il tentera de chasser toute sa vie réapparaissent inéluctablement comme des obsessions. Ne pouvant écrire des vers, Flaubert corrige dans un premier temps ceux de Louise Colet. Puis, quand il entame le projet de son premier roman, il aspire à une nouvelle prose en voulant lui appliquer les règles de l'art poétique, le rythme, la sonorité et la consistance du vers. Le premier auditeur de ses phrases fut son éditeur, Louis Bouilhet. Il écrit dans une correspondance à Louise Colet au sujet d’une correction qu’il vient de rédiger :« Je passerai la semaine encore à relire tout cela et à le recopier et, de demain en huit, je dégueulerai tout au sieur Bouilhet [1]».
Une plongée progressive dans la grande solitude
Certains biographes de Gustave Flaubert racontent qu’il s’est rapidement enfoncé dans des contes philosophiques très noirs, dans lesquels il recherche la proximité familière de la mort. Du fait de ses troubles sociaux, cela paraît inexprimable pour lui, et c’est justement là aussi qu’il faut chercher les raisons de son trouble autistique, et de son don extraordinaire et si puissant pour l’écriture. Cette introspection qu’une écrivaine comme Adèle Van Reeth ne cesse sa vie durant de mener pour tenter de donner un sens à une existence parfois absurde ou incompréhensible lorsqu’on est confronté à des choses aussi douloureuses que les envies suicidaires, les troubles sociaux, la discrimination ou la mort d’un proche. On peut donc laisser entendre que, comme beaucoup de personnes qui auraient pu présenter des troubles autistiques, Gustave Flaubert éprouve des difficultés à exprimer ses pensées et ses émotions. Cela ne l'empêche pas d'éprouver un puissant désir d'écriture qui ne le quitte jamais. En effet, du fait de son besoin d’être constamment stimulé sur un plan intellectuel, Flaubert passe ses journées à écrire puis réécrire ses phrases. Il semble insatisfait du résultat qu’il obtient et n’arrête pas de raturer, de modifier et de tâtonner entre plusieurs mots qui peuvent parfaire la musicalité de la phrase pendant plusieurs semaines afin qu’elle soit parfaite. Cette hésitation nous laisse soulever plusieurs interrogations sur ses potentiels traits autistiques.
Un extraordinaire sens du détail
En retrouvant les manuscrits de "Madame Bovary", des linguistes ont démontré que, du fait de son souci du détail, Flaubert ne cessait de biffer plusieurs fois le même mot en le réécrivant à plusieurs reprises en interligne. Il usait également d’une autre rature dont la fonction n’est plus la suppression, la substitution ou même le déplacement, mais la désactivation. Un professeur spécialiste de la littérature du 19ème siècle explique : « La rature de Flaubert n’a pas la même fonction que chez d’autres écrivains, qui n’avaient probablement pas ce sens du détail fréquent chez les personnes autistes. Ce type de rature révèle le tâtonnement qui marque l’écriture de Flaubert, chez qui l’accomplissement de la phrase dans sa dimension musicale demeure un art parfait. " Ainsi, le chercheur en littérature comparée laisse entendre que chez Flaubert, cette recherche de la perfection transforme sa littérature en une sorte d’art total d’une grande précision où la musique, le théâtre et les arts graphiques se mêlent facilement. « Flaubert soumettait tous ces textes à la diction, à la répétition et à l’évaluation. À ses yeux, l’acte scriptural s’avère un travail tellement perfectible et insatiable qu’il est pratiqué paradoxalement et inversement dans le "jeu" de l’exercice oral, et l’étude d’œuvres non romanesques ou d’essais de sciences sociales ou d’histoire pour des œuvres comme "L’Éducation Sentimentale" ou "Salammbô" ». La soumission du texte à la déclamation orale est une autre preuve de ce que nous avons révélé précédemment, à savoir la dimension oratoire de l’écriture de Flaubert. Le Gueuloir reflète la manie de cet écrivain pour la grandiloquence, sa nature lyrique, sa passion pour la poésie et le théâtre. « C’est de ce lyrisme refréné, constate Thibaudet, que la phrase de Flaubert tire sa nourriture, c’est cette nature oratoire qu’elle exploite et discipline, et fait passer pour l’amplificateur du Gueuloir ». Ce choix fut très judicieux, puisqu’aujourd’hui, les sciences cognitives prouvent qu’on ne peut plus penser l’acte scriptural sans saisir les liens entre l’écriture et la lecture, la lecture et la diction, la diction et l’écoute, qu’a longuement analysé Meschonnic, lorsqu’il laisse entendre que la littérature est l’oralité maximale. « C’est ce fait inévitable qui nous motive à conférer au rythme une prééminence dans notre étude du style de Flaubert, qui comprend parfaitement que le rythme ne se manifeste qu’au niveau de la prose oralisée. »
[1] 1Guy de Maupassant, « Souvenirs d’un an », Le Gaulois, le 23 août 1880.