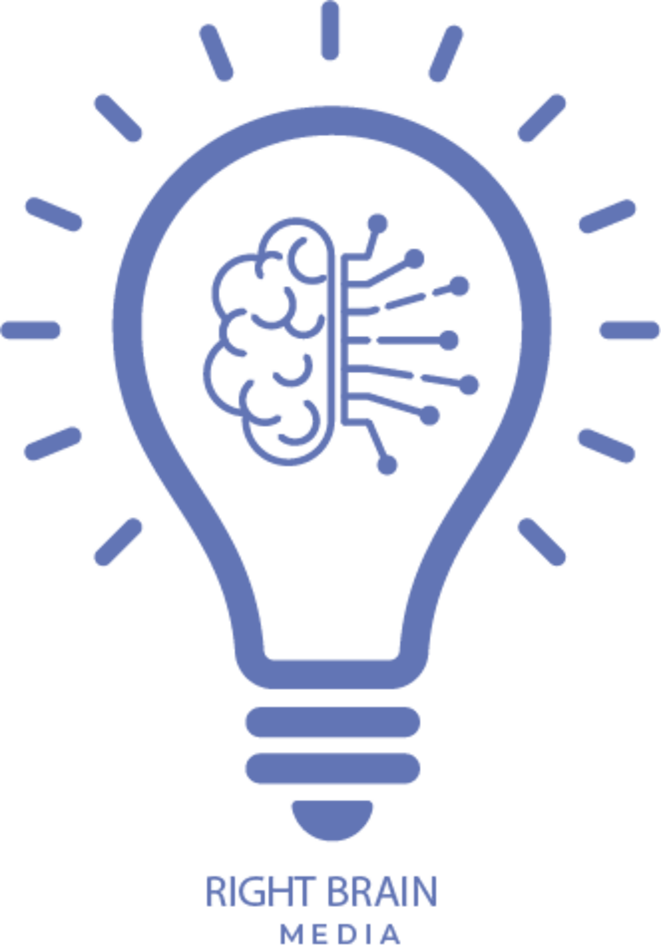Les succès d’une politique sociale favorisant les génériques
Dans un document datant de 2016, une triple entente ministérielle a qualifié la détermination des coûts des médicaments comme étant « […] Une stratégie globale alignée à la fois sur la pérennité de la distribution d’un traitement et une rentabilité pour les fabricants ». Pour instaurer cette stratégie, un Comité dédié à l'économie des produits de santé a vu le jour, supervisé par les autorités ministérielles compétentes. Un juriste expert en droit médical précise : « Il s’agit d’une instance interministérielle sous l’égide des ministres en charge de la santé, de la Sécurité sociale et des affaires économiques ». Aujourd'hui, la plupart des médicaments couverts sont des génériques pouvant être achetés en pharmacie à moindre coût. Les tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR) ont favorisé le déploiement de la pratique « tiers-payant en échange de génériques ». Un observateur du système de santé commente. « Dès 2013, cette initiative a engendré une économie de 448 millions d’euros pour la Sécurité sociale. Par ricochet, une montée significative des ventes de génériques s’est observée dans un pays où même l’Aspirine et le Doliprane sont parmi les moins onéreux à l'échelle mondiale. » Cependant, Bercy tente de prouver le contraire. Le ministre en est même venu à démontrer que l'augmentation du prix des génériques pourrait être une source d'économie dans le prochain budget qui sera présenté dans les deux chambres en Octobre. Comme le révélaient en une dimanche les journalistes du Parisien, dans le cadre de la prochaine loi budgétaire de la Sécurité sociale (PLFSS) de 2024, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, envisage une révision de cette tarification en majorant la franchise médicale, actuellement fixée à 50 centimes d'euro par boîte de médicaments remboursable. « Concernant les interventions paramédicales et les déplacements sanitaires, selon Bercy et le ministère de la santé, cette franchise est aussi applicable, soit 50 centimes et 2 euros respectivement. »
Bercy jette les français à la mer
Des groupes associatifs se montrent résolument hostiles à cette suggestion, plaidant qu'un tel ajustement, cumulé aux actuels défis d'accès aux soins, accentuerait la charge financière sur les patients. Effectivement, en stabilisant les prix des génériques, la compensation se ferait par une hausse des volumes vendus. Un expert en politiques sanitaires analyse : « Plutôt que d'augmenter la franchise médicale de 50 centimes, si Bruno Le Maire réduisait les tarifs des génériques, Bercy instaurerait un cercle vertueux : Pourquoi privilégier un princeps lorsque, selon l'Institut national de la consommation, son équivalent générique coûte en moyenne 40% de moins ? » D'autant que d’après des spécialistes, la commercialisation d'un générique diminue le coût du princeps d'environ 20%. Un juriste spécialisé en santé souligne : « L'essor des génériques en France a effectivement modéré les coûts, générant une économie de près de 27 milliards sur une décennie, dont 3 milliards en 2018. » Cependant, l'économiste Thomas Olivier constatait dans son essai Fiches des problèmes économiques contemporains ( Ellipses, 2021) qu’il y a encore du chemin à parcourir dans la mise en place de politiques sociales favorisant le développement des génériques. « Comparativement à nos voisins, la France reste en retrait sur l’usage des génériques : 37,3% en 2018 contre 80% en Allemagne et 83% au Royaume-Uni. Ainsi, en 2023, seuls 49% de nos traitements peuvent être transformés en générique et payés à moindre coût. Par ailleurs, une évolution inquiétante est apparue dès 2017 : une baisse des ventes de génériques, confirmée en 2018. »
Une politique de l’innovation freinant le développement des génériques
En 2008, à la suite de l'adoption d'une loi sur le financement de la sécurité sociale qui instaure des franchises pour les médicaments, actes médicaux et déplacements médicaux assorties de plafonds quotidiens et annuels, le processus de fixation des prix des médicaments a été revu. Un représentant du groupe Sanofi basé à La Boétie commente : « Cette correspondance, élaborée en collaboration avec les laboratoires nationaux, visait à établir un rabais qui assurerait à la fois l'efficacité du produit et un impact budgétaire gérable, sujet sur lequel Bruno Le Maire souhaite se pencher dans le nouveau PLF. » De cette manière, le contrôle de ces « coûts supplémentaires » offrirait des alternatives conventionnelles pour stimuler les innovations médicales et les biosimilaires soumis à l'approbation de mise sur le marché par Big Pharma. Comme l'indiquait une information de 2021 de Challenges, lors de leur dernière entente, le Leem (fédération des industries pharmaceutiques) et l'organisme interministériel chargé de déterminer les prix des soins de santé ont proposé des mesures favorisant l'investissement et encourageant la relocalisation. Dans cette optique, le Leem soulève l'idée d'attribuer un prix standard européen élevé aux médicaments, sans les transformer en générique au fil des années. Un économiste de Paris IV Sorbonne perçoit dans cet accord une stratégie influencée par l'offre, orchestrée par des délégués médicaux financés par des laboratoires tels que Sanofi, qui investit massivement dans ce secteur depuis les années 80. Le but est d'encourager les médecins à recommander des non-génériques, en utilisant des incitatifs si nécessaire.
Médicaments prescrits : Une psychiatrie sous influence ?
Fervent défenseur des droits des handicapés, en tant que père d'un enfant autiste sans déficience cognitive, l'économiste que nous avons rencontré regrette l'usage de médicaments tels que le Valium dans les unités d'urgence psychiatrique de l'APHP où son fils est régulièrement pris en charge. « Dans les hôpitaux d'Île-de-France, des professionnels de santé reconnus, tels que Nathalie Giraud, ont promu l'utilisation d'anxiolytiques peu efficaces et mal remboursés.” Pour illustrer ce phénomène, il prend l’exemple de son fils autiste de 22 ans.” Il a récemment été confiné pendant cinq heures sous Valium dans une salle de l'APHP par l'équipe de Nathalie Giraud alors qu'il avait une crise d’épilepsie. » Cependant, pour cet économiste, il est évident que les tentatives de séduction de l'industrie pharmaceutique sont massives, poussant les services hospitaliers à prescrire des molécules onéreuses pour les caisses de l'État. « Selon l'OMS, affirme-t-il, l'influence du lobby pharmaceutique peut conduire à une prescription non adaptée, compromettant ainsi la santé du patient. » Dans l'Hexagone, les effets de tels choix médicaux sur des troubles tels que l'autisme sont indéniables. Par exemple, en 2019, les personnes autistes en France consommaient 80 % de médicaments de plus que leurs homologues italiens, alors que leur taux d'intégration scolaire et professionnelle est nettement plus élevé en Italie, notamment grâce à des initiatives comme Pizzaut.
Un avocat spécialisé en droit de la santé nous confie : « Les Français consomment trois fois plus d'anxiolytiques que les Allemands et deux fois plus d'anticholestérols que les Britanniques. 97 % des visites médicales aboutissent à une ordonnance, contre 40 % aux Pays-Bas. » Il conclut que ces prescriptions de médicaments non génériques et mal remboursés, influencées par des géants comme Sanofi, sont dévastatrices pour le traitement de certaines maladies, comme le TDAH ou les troubles du spectre autistique. « Chaque prescription en France, signale-t-il, contient en moyenne 4 médicaments. Or, les risques d'interaction médicamenteuse augmentent dès 3 médicaments. » Ces pratiques bénéficient-elles vraiment aux professionnels de santé ou aux patients ? Pas nécessairement. Compte tenu des défis budgétaires auxquels sont confrontés les pays occidentaux, il est surprenant que cette surconsommation soit encore négligée. Elle ne contribue en rien à l'amélioration de la santé publique et pourrait même lui nuire.