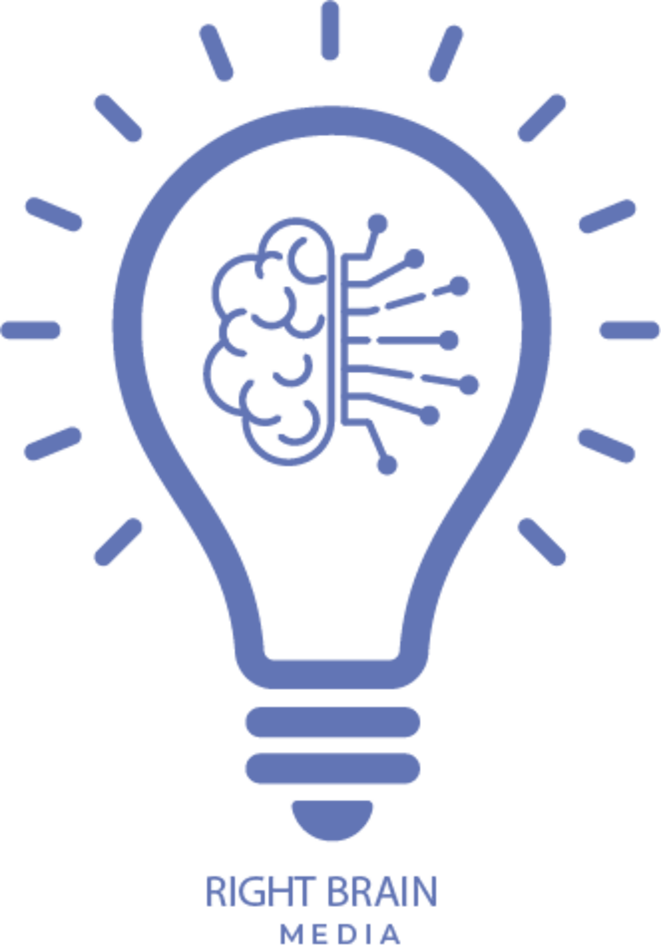Rappel des faits
Depuis la création, par Claude Allègre, alors ministre de l'Éducation nationale, de 3 000 postes d'enseignants en Seine-Saint-Denis, malgré l'opposition de son administration centrale, la stratégie adoptée par les gouvernements successifs et l'administration en général consiste à remettre en cause cette promesse et à revenir sur les acquis obtenus grâce à la mobilisation des syndicats enseignants (FO, CGT, Sud...)[1]. Puis, en octobre 2019, Edouard Philippe, alors Premier ministre, avait annoncé un plan visant à renforcer l'État en Seine-Saint-Denis, avec des engagements de rattrapage dans les domaines de la police, de la justice, de la santé et de l'éducation. Les autorités gouvernementales furent alertées par des habitants souhaitant un État plus fort, des services publics plus efficaces, mais également plus réactif, réduisant l'écart entre l'annonce des mesures et leur mise en œuvre.
Quatre ans après, la Seine-Saint-Denis continue d'accumuler des retards concernant les effectifs d'enseignants et rencontre des difficultés pour lutter contre l'échec scolaire, ce qui suscite l'inquiétude d'un membre du Snes : « Le 93, affirme-cet enseignant en français, est un département où l'école occupe une place particulière parmi les habitants pour plusieurs raisons : il s'agit du département français avec la plus forte proportion de jeunes, ainsi que de la population la plus pauvre et la moins diplômée de France. » Ainsi, la promesse d'émancipation portée par l'éducation, au cœur du projet social français depuis La Troisième République et les lois Ferry, résonne de manière plus intense qu'ailleurs. Pourtant, la Seine-Saint-Denis reste le département français où l'école reproduit de plus en plus les inégalités sociales et territoriales. Un chiffre suffit à tout expliquer : en moyenne, un élève de la Seine-Saint-Denis perd un an de sa scolarité en raison du manque d'enseignants. « On ne peut plus compter, explique un professeur d'histoire, engagé politiquement, les exemples de classes qui, pendant des semaines voire des mois, se retrouvent sans professeur des écoles, sans enseignant d'histoire, de mathématiques ou de langue. »
Des inégalités subsistant dès les premières classes
Selon plusieurs enseignants, le dédoublement des classes de la grande section de maternelle au CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire a eu un impact positif sur les écoles du département. "C'est l'une des mesures les plus positives de la politique éducative de Jean-Michel Blanquer lors de son premier quinquennat, même si, en réalité, elle a prélevé des postes sur le dispositif 'plus de professeurs que de classes' du quinquennat de François Hollande", nous explique le professeur d'histoire-géographie en collège que nous avons rencontré. Les premières difficultés se manifestent au collège. En Seine-Saint-Denis, l'orientation est subie plutôt que choisie et la réussite de tous les élèves n'est plus au cœur du système éducatif. "Je vis dans une cité où on ne compte même plus le nombre de jeunes de 12 ou 13 ans déscolarisés qui se tournent vers l'économie de la drogue ou la petite délinquance, au point d'en devenir violents", affirme cette mère d'un enfant autiste habitant à Aulnay-sous-Bois (93), qui se dit terrifiée pour son fils.
« Doté d'une ouïe et d'un odorat très sensibles, mon fils diagnostiqué au Centre Ressource Autisme d’Aubervilliers est profondément perturbé par l'agitation bruyante en bas de notre immeuble, l'odeur de la drogue et les petits voyous qui l'agressent dès qu'il sort seul, simplement parce qu'ils le trouvent différent ». Une situation insoutenable pour la jeune-mère, déjà très sollicité la journée où elle occupe un poste d’assistance sociale. « Certains jours, mon fils de 13 ans est tellement terrorisé qu'il refuse de quitter sa chambre. Et dans ces moments-là, je ne peux même plus l'accompagner à sa classe Ulis où il est scolarisé." Pour préserver l'anonymat de son fils et le sien, cette mère refuse de fournir des détails sur son identité ou sur l'établissement fréquenté par son enfant. D'autres habitants du quartier se disent également consternés par la situation. "Récemment, témoigne un ancien du quartier ayant réussi à s'émanciper de la misère de sa classe sociale grâce à l'école, un jeune de mon immeuble tombé dans la petite délinquance m'a expliqué comment, avec le RSA, son frère aîné, qui a neuf ans de plus que lui, a pu se payer un permis de conduire, l'assurance et l'essence de sa voiture en seulement quelques années. Ce cercle vicieux attire trop de jeunes de mon quartier, c'est lamentable."
Une désinsertion scolaire fortement liée au racisme
En Seine-Saint-Denis, le racisme "savant" de personnalités telles qu'Éric Zemmour imprègne toujours le contexte culturel dans lequel les discours des élèves des établissements sont imprégnés. "Y a-t-il un lien à établir, témoigne le professeur d'histoire que nous avons rencontré,entre les idées de Gobineau ou d'Ernest Renan et cette phrase entendue par le sociologue Aurélien Aramini lors d'un entretien : « on va dire que dans la société d'aujourd'hui, on a les blancs et on a les noirs ?'". Ce travail de sociologie démontre que, dans un cadre scolaire, les adolescents inscrits dans des établissements de Seine-Saint-Denis considèrent que leurs camarades racisés, sont différents. Ainsi, la race constitue ainsi l'un des clivages parmi d'autres, tels que le genre, l'origine sociale, l'apparence physique ou le quartier de résidence. "Plus ces clivages se chevauchent, comme dans le collège REP où j'enseigne, témoigne le professeur d'histoire que nous avons rencontré, plus le racisme s'impose comme une forme de relation avec autrui." Dans certains établissements de Seine-Saint-Denis, un racisme latent aurait même émergé. L'origine, la couleur de peau, le nom de famille, la religion et les conditions sociales sont régulièrement stigmatisés au fil des interactions entre les enseignants et les élèves. Face à ce racisme diffus, les enseignants interrogés par Aurélien Aramini doivent s'adapter. À titre d'exemple, nombreux sont ceux qui observent le rapport de leurs élèves à la religion. "Quand j'interroge mes élèves sur le port du hijab ou de l'Abaya à l'école, explique le professeur d'histoire que nous avons rencontré, la majorité des lycéens se déclarent opposés » Ainsi, ce professeur estime que le sociologue Antoine Biristelle a eu raison de souligner, dans son livre Que Veulent Les Français, qu’aux yeux 43 % des lycéens, les lois laïques restent discriminantes. « Ce pourcentage monte à 89 % chez les lycéens musulmans, contre 36 % chez les lycéens catholiques et 31 % chez les lycéens sans religion, clame-il. »
C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux enseignants de Seine-Saint-Denis restent hostiles à la loi de 2004, qu'ils considèrent comme hostile à l'islam et liberticide. "Bien que les profs peu expériementés sont majoritairement hostiles à cette loi de 2004 elle reste assez acceptée ", expliquait Antoine Biristelle. Néanmoins, il est frappant de constater que le soutien des enseignants de Seine-Saint-Denis à la loi de 2004 a considérablement augmenté. Les problèmes soulevés par le port de signes religieux ostentatoires semblent s'être atténués et les incidents qui en découlent semblent principalement résolus par la conciliation. « Pour certains enseignants, affirme le prof d’histoire que nous avons rencontré, cette loi est perçue comme un "outil disciplinaire". D'autres la voient concrètement comme le dernier rempart contre l'essor de l'islam radical dans les cités de Seine-Saint-Denis. »
Bibliographie
[1] Les Echos, seine-saint-denis-allegre-annonce-la-creation-de-3000-postes-sur-3-ans, 1998, https://www.lesechos.fr/1998/05/seine-saint-denis-allegre-annonce-la-creation-de-3000-postes-sur-3-ans-791501