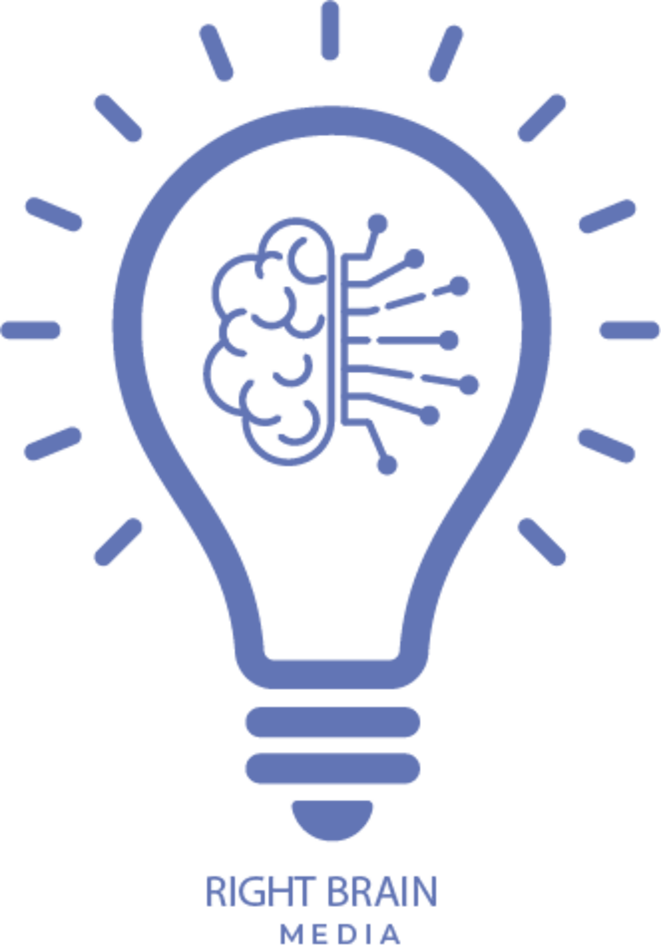La création du « Comité d’orientation restreint »
Lorsqu’il est mis en place par Rachida Dati, alors ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, le COR n’est qu’une version légèrement remaniée du Comité d’orientation stratégique (COS), instauré en 2001 par sa prédécesseuse socialiste, Marylise Lebranchu. Les similitudes entre ces deux instances sont troublantes. Non seulement par leur composition, mais aussi par les personnalités choisies, certaines ayant déjà siégé au sein du COS. La convergence est également frappante en matière de recommandations : du développement des peines non privatives à l'encellulement individuel à partir d’une « loi pénitentiaire » les recommandations des deux instances se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ainsi, le COR crée par Rachida Dati, comme son homologue antérieur, le COS, avait l'allure d'une réunion de sommités du monde pénitentiaire : des syndicats, des magistrats, des avocats, et même des associations qui n’ont jamais abordé la question du handicap mental, et de la violence que pouvait représenter une interpellation ou une garde à vue pour un autiste, un épileptique ou une personne atteinte du syndrome de Tourette.
A ce moment, une perception indélébile semble pourtant s'imposer au ministère de la Justice : la prison n'est plus l'apanage des arcanes secrets des cabinets ministériels. Néanmoins, l’annonce en 2007 de ce projet de loi pénitentiaire par Dati a provoqué un séisme au sein des députés socialistes. Michèle* (changement de prénom pour des questions d’anonymat), chercheuse au Cevipof et spécialiste de l’histoire des socialismes témoignent. « Tels des loups affamés, lorsqu’ils apprennent la création du COR, les députés de gauche ressortent leurs amendements et leurs contre-propositions, formant une coalition inédite au Parlement, où la question du handicap mental est vaguement abordée par quelques députés de gauche ayant confié leur volonté de modifier certains articles du code pénal pour épargner certaines sanctions à des personnes sous antidépresseurs ou sous neuroleptiques. ». Néanmoins, comme nous l’indique Michèle, les enjeux étaient plus profonds : rallier des soutiens, nouer des alliances, et surtout faire entendre une voix alternative face à la rhétorique de l'UMP. C'est ainsi que des figures notables, comme Robert Badinter, Marylise Lebranchu et Élisabeth Guigou, ont été mobilisées, appuyées par des nouveaux venus tels qu'Aurélie Filippetti, qui a pointé les maux carcéraux sans réellement proposer d’amendements sur la situation des handicapés mentaux interpellés pour des petits délits ou sanctionnés pour des crimes. « Le temps pressait, clame Michelle, car la saga de la loi pénitentiaire avait déjà connu des chapitres tumultueux. ». Annoncée avec fracas en 2007 par Rachida Dati, la création du COR a subi report sur report, jouant avec les nerfs des parlementaires impatients. Et comme dans tout bon thriller rythmant la vie politique française, des avant-projets se sont glissés sous les portes. Avec le départ imminent de Dati et les souvenirs amers de 2002, le doute s'est installé : la saga de la loi pénitentiaire serait-elle une histoire sans fin ? Néanmoins, aucun mot sur le handicap mental ne sort de la bouche de Rachida Dati et des autres ministres.
La création d’une chimère bureaucratique par le gouvernement de François Fillon
L’idée même qu'une loi pénitentiaire puisse voir le jour commençait à ressembler à une chimère bureaucratique. La « loi pénitentiaire », parée de son aura salvatrice, semblait n'être brandie que comme un mirage pour apaiser les esprits des agents pénitentiaires que Nicolas Sarkozy défendait depuis son arrivée au ministère de l’intérieur sous la présidence de Jacques Chirac. Néanmoins, le projet de loi pénitentiaire, après des mois d’atermoiements, est finalement mis sur la table du Sénat en mars 2008, au crépuscule du mandat de Rachida Dati Place Beauvau. Quant à la situation des handicapés mentaux lors d’une interpellation lorsqu’ils présentent quelques troubles légers comme des formes d’Autisme sans déficience intellectuelle, elle n’est toujours pas abordée. De plus, c'était sans compter sur la pression internationale, notamment du Comité européen de prévention contre la torture (CPT), qui lançait un avertissement cinglant à la France. L’ONU, elle lançait déjà des alertes sur la situation des handicapés mentaux en France au gouvernement de François Fillon. Quant aux tensions politiques, elles ne cessaient de monter. La bataille s’intensifiait entre le Parlement et le ministère de la Justice autour de l'urgence de la loi. Le gouvernement de François Fillon, pressé par le temps, souhaitait expédier le projet de loi, usant de procédures accélérées.
Les sénateurs socialistes montèrent au créneau, rapidement rejoints par le président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Pourtant, malgré cette déclaration d'urgence, le texte demeurait enlisé dans les limbes parlementaires à la fin de l’année. Le 11 décembre 2008, la frustration se lisait sur les visages lors des rencontres parlementaires sur la prison. Ainsi, la prison et les interpellations, longtemps oubliées par la classe politique, semblait désormais occuper une place prépondérante dans l'esprit des plus hautes instances parlementaires. Quant au texte pénitentiaire, tel un Saint Graal législatif, il fut dévoilé, en première lecture, dans sa seconde chambre d'examen, en septembre 2009. Une éternité, un an et demi, s'était écoulée depuis son entrée dans l’arène du Sénat. À l’assaut, c'était Michèle Alliot-Marie, nouvelle garde des Sceaux, qui, le défendait face aux députés, sans aborder dans un aucun amendement de son ordonnance la situation des handicapés mentaux lorsqu’ils sont emprisonnés, ou qu’ils commettent un délit.
Le parlement intervient enfin, sans parler du handicap mental
Réécrire cette loi emblématique devenait possible, notamment grâce à la révision constitutionnelle de juillet 2008. Un souffle nouveau pour le Parlement. Ce nouveau pouvoir, autrefois impensable, a été inauguré lors de l'examen de ce texte au Sénat en mars 2009. La transformation était radicale : d'un simple calque des Règles pénitentiaires européennes (RPE), une véritable réforme en profondeur du droit pénitentiaire français avait été mise en place. Sous l’impulsion du président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, et du sénateur UMP du Nord, Jean-René Lecerf, ce projet de loi s'est vu augmenter de quatre-vingt-quinze amendements.
Une métamorphose saluée par les initiés, un pas de géant pour le Parlement, mais aucun progrès au sujet du handicap mental. En toile de fond, le pouvoir se redéfinissait, le Parlement renforçait sa position, et la prison, autrefois mise à l'écart, retrouvait enfin sa place dans le débat national, sans donner aucune place aux personnes atteintes de troubles psychiques, régulièrement incarcérés lorsqu’ils font des crises dans des lieux bruyants, ou qu’ils commettent des délits pouvant être condamnés par de lourdes peines. Comme l’indique Olivier*, chercheur en Sciences Politiques au CNRS et spécialiste des questions pénales, le texte proposé était loin d’être anodin : « formation des détenus, "aide en numéraire" pour les plus précaires, droit d'expression des prisonniers, supervision extérieure des audiences disciplinaires, et la question, très sensible, des fouilles corporelles. Tout y était. Néanmoins, j’admets que ni le président Sarkozy, qui ne s’intéressait pas à la question, ni les groupes politiques à l’Assemblée, n’ont évoqué la situation des personnes ayant des troubles psychiques ou du comportement. »
Le rôle des acteurs externes et associatifs dans le vote de cette loi validiste
Parallèlement, l'intervention d’acteurs extérieurs, comme le Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (GENEPI), ajoutait une dimension supplémentaire à ce débat, durant lequel les handicaps mentaux comme l’autisme, la schizophrénie, l’épilepsie ou la bipolarité n’étaient jamais évoqués. Fondé en 1976, le GENEPI œuvrait dans l'ombre, proposant une éducation et des activités aux détenus en oubliant leurs troubles psychiques. Ainsi, ce qui semblait n’être qu'une simple réforme pénitentiaire organisée par le gouvernement de François Fillon s’avéra être un champ de bataille contrôlé par Rachida Dati, les failles du système pénal et psychiatrique français, et l'émergence d'acteurs autrefois silencieux. En se positionnant comme interlocuteur direct lors des débats et auditions organisés par le très fermé Comité d'orientation restreint (COR), créé par la garde des Sceaux Rachida Dati en 2007, Le (GENEPI) et la garde des sceaux du président Nicolas Sarkozy ont intégré des députés et sénateurs proches de L’UMP dans leur stratégie assez fine. Aujourd’hui, de nombreux handicapés mentaux, et autres personnes ayant des troubles invisibles estiment que les conséquences de ces choix politiques de Rachida Dati sont désastreuses. L’art. 112-1, al. 2 CP évoque à titre d’exemple une réalité troublante : la rétroactivité des "peines" est interdite pour les handicapés mentaux, mais que dire des mesures de sûreté qui anticipent une dangerosité future d’une personne développant des troubles psychiques en cellule, sans pour autant sanctionner une culpabilité passée ? Un avocat pénaliste témoigne. « L’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, par exemple, n'est pas une "peine", mais une mesure préventive. »
Boite noire :
Michèle et Olivier ont préféré rester anonymes
Les proches de madame Dati au groupe des Républicains à la ville de Paris et le service presse du parti n'a pas souhaité témoigner