
Agrandissement : Illustration 1
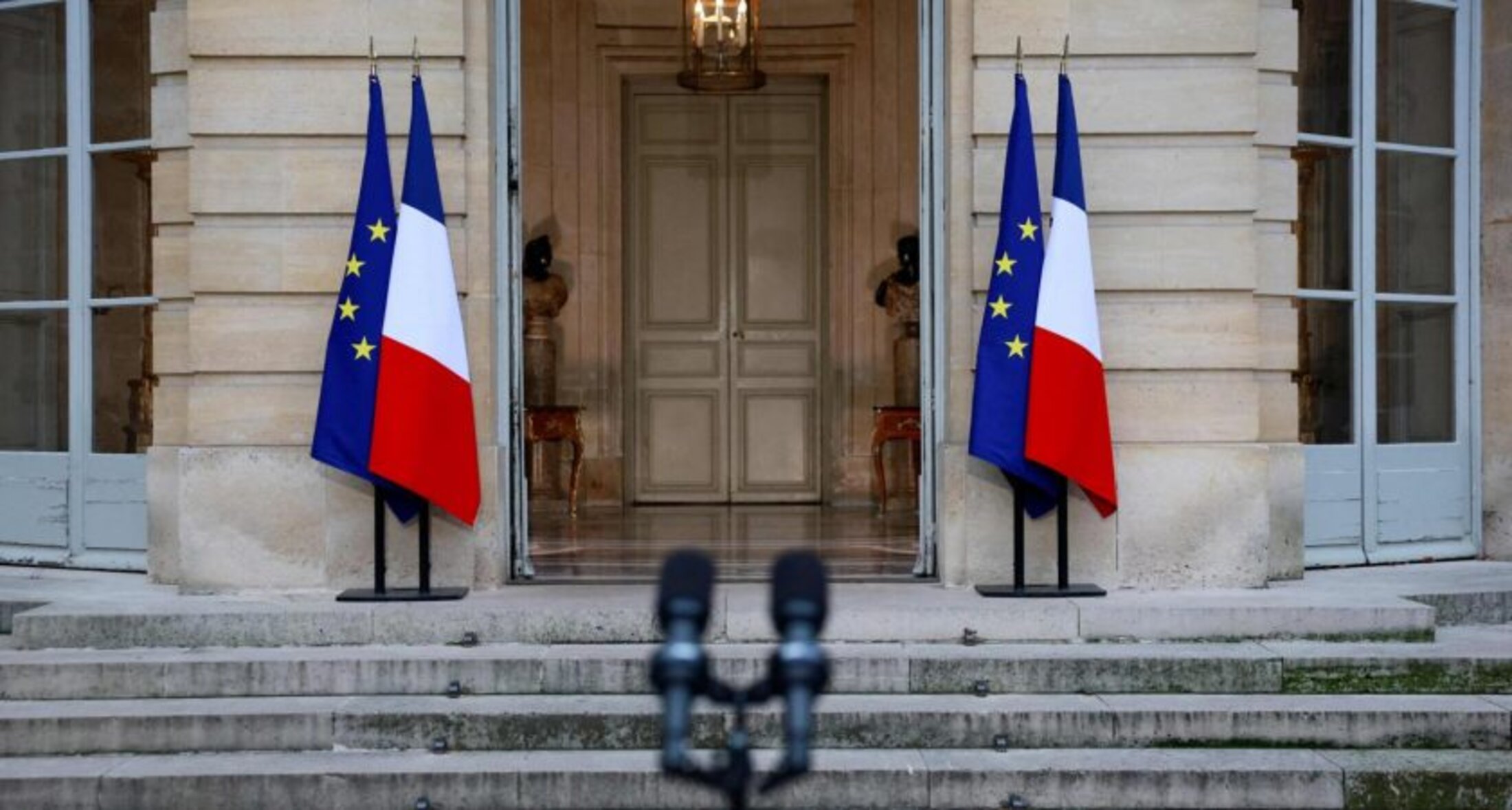
À première vue, ce qui s’effondre en ce moment n’est ni une équipe ministérielle ni même une majorité : c’est la fiction du pouvoir lui-même – la croyance selon laquelle quelqu’un, quelque part, tiendrait encore les rênes de la Nation. La démission du Premier ministre est le dernier symptôme d’un État spectral, qui hante le monde sans savoir qu’il est mort. Un État qui signe, qui décrète, qui parle – mais dont la voix ne fait plus rien. Qui persiste sans chair, et agit sans présence. Dont la force réside seulement par habitude – par inertie bureaucratique, laquelle prolonge le geste du pouvoir à la vue de sa fuite. L’État est toujours là, et l’État est nulle part : visible dans sa trace, absent partout ailleurs. Autoritaire, bien sûr, par jeu de dispersion – dans un réseau de décisions qui manquent de visages. Gouverner sans gouverner, gérer sans vision : ainsi se dissout le monde politique dans une forme molle de contrôle symbolique – fait d’effets d’annonce et de postures formelles.
Ce n’est plus le pouvoir qui dirige, c’est la gestion du vide. L’État devient algorithmique – saturé de capteurs. Il produit, il formate – et efface ainsi l’idée d’une décision. Hannah Arendt parlait de « banalité du mal » pour dire la force mortifère d’une obéissance sans pensée, la puissance mortelle de la vacuité morale de celles et ceux qui exécutent sans réfléchir ; nous comprenons aujourd’hui – sans aucune volonté – ce en quoi consiste la banalité du vide. Non pas le vide métaphysique des mystiques ou des poètes mais un vide administratif, quotidien, parfaitement fonctionnel. Un vide (paradoxalement) plein, ordonné dans sa saturation – de discours, d’injonctions et de simulacres démocratiques. Trop de paroles, trop d’images, trop de gestes creux – par lesquels l’État prolifère sans plus aucune essence.
Tout le monde est impliqué, personne n'est responsable ; dans cette banalité, le néant s’est fait principe de vie. Néant statistique, néant langagier, néant humain : nous habitons un vide domestiqué – où réside, précisément, la forme la plus subtile de notre disparition. D’une rationalité sans pensée devenant vite inhumanité douce : si le mal tend à surgir de l’absence de jugement, le vide, lui, naît de l’absence du monde.
Le vide comme méthode
Le vide est la méthode d’un pouvoir sans imagination. D’un pouvoir sans corps, d’un corps sans organe – qui gère, qui ajuste, et jouit de sa technique. Parler sans rien dire, durer sans exister. La mesure ne nous laisse aucun lieu de promesse : tout est affaire d’équilibre, de flux à contenir et de risques à prévoir.
Ce pouvoir-là rêve de stabiliser – de maintenir le monde dans une semi-vie, de maintenir la vie dans un demi-monde. « Un chemin est possible, mais il est difficile », nous dit un revenant au JT de France 2[1]. Un seul chemin, bien sûr – zéro alternative. Optimiser, rentabiliser : dans cette logique froide, tout autre est menaçant. Ainsi s’étend le vide – qui rassure celles et ceux qui sans cesse le produisent.
Le pouvoir, pour survivre, simule son écrasement. Défaillances prévues, retards codifiés, silences stratégiques : sous prétexte d’être vraie, la politique s’en va – et laisse un vide technique comme seule forme suprême.
Ce vide est un produit. Il fait signe d’un monde qui prolifère sans cesse – et sans point d’origine. Tout circule, tout s’échange – mais plus rien ne s’attache. Le monde explose de signes qui ne signifient rien – jamais le réel n’a paru si lointain. Nous parlons du vide comme d’un effondrement, comme d’un creux à la suite d’une disparition. Mais le vide, le vrai – celui que nous vivons – est l’effet secondaire d’une terre en excès. Il est le symbole d’une élimination – celle de l’incertitude, et de l’altérité. Ce vide contemporain est le vide d’un monde plein – d’un monde tout à fait lisse, sans dehors et sans risque. Nous voilà noyés de paroles infinies; dans un monde trop visible – et donc disparu. Aucune médiation ni aucune épaisseur : nous habitons une vie sans recul et sans ombre. Une vie programmée pour enlever du ciel tout ce qui touche au rêve – et ne garder de nous qu’un contour fonctionnel. Le vide que l’on vit est vide industriel : il bourdonne constamment, se fabrique et se vend. Son grand paradoxe est d’être au nom du lien : que tout le monde soit proche, tant que chacun est seul.
Le triomphe du désastre
Le gouvernement tombe avant même de naître, sa langue reste la même. Crise économique, crise politique, crise migratoire… la rhétorique de la crise est notre seul point commun. Au nom de l’urgence, elle excuse l’inaction ; et fait de chaque suspension du pouvoir une preuve de sa nécessité. Loin d’être une exception, la crise est devenue le régime normal de notre gouvernance. Un décor sans issue, un mot sans horizon.
La crise comme grand prétexte – instrument de pouvoir et alibi moral. On gère les symptômes sans toucher à leurs causes – ainsi se donne à voir le cycle mortifère. Saturation de crises, qui nous apprend à vivre dans l’attente de la chute – comme si notre condition était celle du fracas.
Il ne reste rien d’autre que la résignation : croire que gouverner c’est tenir l’équilibre entre tous ces désastres. Alors, sans raison d’être, on prend des décisions, on prononce des phrases, on perpétue des normes. Et puis on nous répète, du haut d’un beau pupitre, qu’il nous faudra tenir, s’unir, avancer malgré tout – en serrant nos ceintures. Mais avancer vers quoi ? s’unir vers quel but ? Peut-être faudrait-il plutôt se demander : pourquoi donc accepter la crise comme notre seul langage ?
Dans ce théâtre de la vacance, un vertige se donne sous forme de question : qui parle encore au nom de qui ? Des paroles circulent – et glissent sur le réel. Dire : pour produire l’illusion d’une présence, pour simuler un lien là où il n’y a plus rien. Redire : non pas pour faire croire mais bien pour faire taire – par épuisement de sens. Ici gît le génie du pouvoir moderne : dans la tyrannie qu’il crée, dans la torpeur qu’il suscite. Dans sa domination feutrée et procédurale. Et nous, nous restons là : spectateurs et complices d’un système qui vit de nos inattentions. Habitants d’un pays peuplé de gens fantômes – réduits à des chiffres ou des foules sans voix – à qui on donne la tâche de croire encore un peu. Entretenus, donc : tenus entre les gestes factices des mêmes têtes fermées – reproduisant un monde qui fonctionne sans nous.
Le vide du pouvoir n’est pas une anomalie mais son cœur le plus pur. Malgré les apparences, jamais mieux le pouvoir ne se montre que dans la persistance d’un système fonctionnant malgré l’absence de sens. Un pouvoir qu’on ignore tant il est visible. L’incarné ne vaut rien face à l’idéologue – et l’idée que ça tourne prouve qu’il faut continuer. Le moment que l’on vit est une vérité : le triomphe d’un pouvoir qui ne peut fonctionner que par son effacement. Qui s’obsède du désordre alors qu’il y a bien pire : le règne du néant.
La politique du creux
Le vide a mauvaise presse. Dans un monde plein d’objets, d’images et de données, il s’est fait symbole d’un manque ou d’un échec. L’histoire de l’esprit est celle de la lutte contre l’horreur du vide. On parle de lui comme la trace d’une défaite. Nous vivons des lieux où le silence fait peur. Où la moindre interstice est aussitôt comblée. Le réel lui-même se trouve recouvert – si bien saturé qu’il ne laisse plus penser. Société transparente, qui croule de ses jeux – qui vomit toute lenteur et chasse tout secret. Le monde contemporain s’épuise à conjurer : on produit, on produit, pour tenter d’échapper à l’abîme du manque. Nous remplissons sans fin un ventre qui gargouille – sans voir qu’un trop-plein détruira l’appétit. Incapables, un instant, de suspendre nos gestes et de se laisser être – nous vivons alors pour toujours encombrés.
Pour conclure ce texte, retournons cette logique : et si l’enrayement constituait une aubaine – une faille où s’engouffrer pour resouffler, ensemble ? C’est toujours par le vide que quelque chose advient ; c’est toujours là où le pouvoir se dérobe qu’émergent de nouvelles formes. Il ne faut oublier qu’un peuple sans scène peut refaire le langage – en saisissant enfin que le pouvoir réside dans son propre tissu. Le vide du pouvoir est un trou symbolique – où la politique, vivante et conflictuelle, peut enfin faire retour. Il s’agirait alors de traverser le vide pour habiter le gouffre. Transformer la torpeur en conscience politique. Ne plus attendre quelqu’un ; devenir nous-mêmes les acteurs du bug – pour que refasse surface ce qu’on nous a volé.
La question, dès lors, n’est pas tant de combler que d’interrompre le flux. De contrer la logique de marchandisation – qui signalise nos mots et traite nos mouvements. Ne pas croire au retour d’un petit plein perdu – désapprendre à remplir, réapprendre à stopper. Retrouver, ainsi, la puissance de l’arrêt – pour enfin se refaire « grand peuple politique »[2].
Là où c’est déjà fait, plus rien ne peut venir. Le vide véritable se trouve dans la clôture, dans la boucle éternelle d’un monde qui continue. C’est de cette clôture qu’il nous faudra sortir – non pas par le bruitage, mais bien par le creusement. Revenir au vide, pour retrouver le souffle. Non pas le vide qui chute, mais celui qui promet – qui promet un accueil, une suspension de soi, une autre apparition. Il s’agirait alors de cultiver le vide – pour retrouver ailleurs la chair de notre monde, et le seuil d’un devenir.
Le vide n’est pas la fin, il entame un comeback. Engageons, alors, une politique du creux – car tout ce qui « fait sens » est toujours en retrait. Sans silence, pas de mots ; sans marge, pas de texte ; sans vide, pas de monde. Ainsi le courage consisterait à dire : il ne nous reste rien – recommençons alors.
[1] Interview de Sébastien Lecornu, Journal télévisé de 20h, France 2, Mercredi 8 septembre 2025.
[2] Interview de Sébastien Lecornu, Journal télévisé de 20h, France 2, Mercredi 8 septembre 2025.



