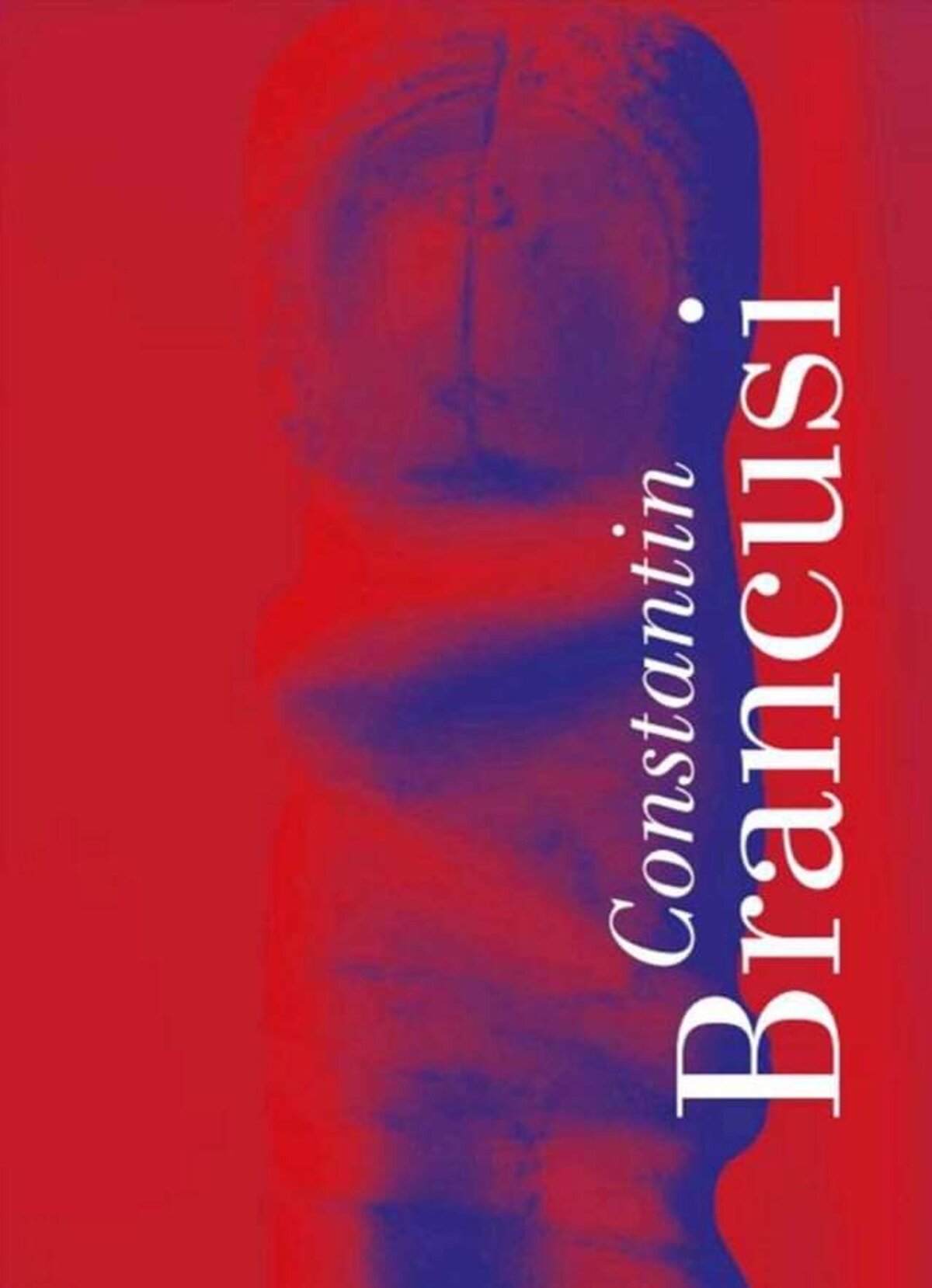
Agrandissement : Illustration 1
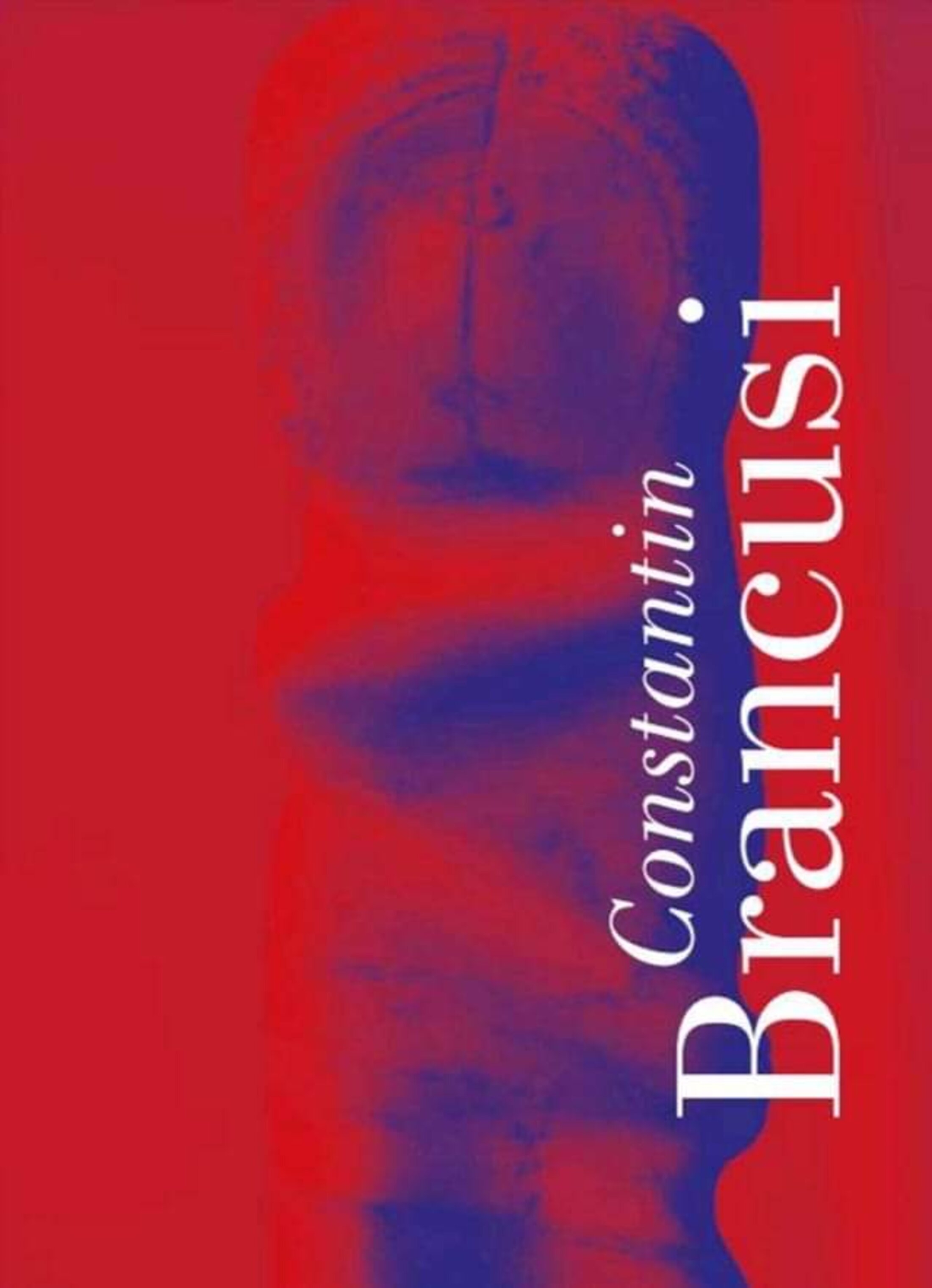
Qu’entend-on exactement par marché de l’art ? Comment l’œuvre se trouvant devant nos yeux dans un musée peut aujourd’hui se trouver sur ce mur ? Pourquoi telle entreprise met en évidence un tableau de Picasso dont elle est particulièrement fière dans son hall d’accueil ? et enfin quels sont les intermédiaires entre l’artiste (qu’il soit vivant ou non) et l’acquéreur ?
Tout d’abord, il n’y a pas d’œuvre sans artiste. En 2009, on en dénombrait près de 50.000, actifs dans des disciplines comme la photographie, la peinture, la sculpture… le double du nombre de personnes actives dans un métier artistique à titre principal depuis 1990. Ensuite, il convient de présenter les œuvres des artistes. A ce titre, près de 2200 galeries d’art contemporain proposaient leurs œuvres en 2012. Le succès de leurs œuvres passe souvent par les avis des critiques d’art, autres acteurs sur ce marché. Si elles ne sont pas acquises directement dans les galeries, elles passent alors par des salles de ventes qui les proposent lors d’enchères passionnant souvent les foules. Dernier phénomène en croissance continue : les enchères en ligne. Eh oui, le monde digital pénètre également le marché de l’art depuis de nombreuses années. Enfin, il n’y pas de marché de l’art sans les collectionneurs. Qu’ils soient privés ou publics, ils voient dans l’achat d’œuvres non seulement le plaisir de détenir une création unique et riche, mais également un investissement qui peut rapporter gros.
Nous ne faisons mention ici que de l’art contemporain, mais il serait illusoire de passer sous silence le marché des œuvres d’artistes aujourd’hui disparus comme Picasso, Brancusi, Dali, Monet ou Basquiat. Chacune des expositions de leurs œuvres attire les foules, quel que soit l’endroit où elles prennent place. Elles attirent d’ailleurs parfois d’autres types de « publics », des « Arsène Lupins » qui les subtilisent ou les copient, tant leur valeur peut être important à la revente.
Le marché de l’art a connu une croissance importante depuis 2015. Tout d’abord, les œuvres s’échangent à un prix toujours plus stratosphérique. « Les Femmes d’Alger » de Picasso atteint la somme record de $175M (Christies, mai 2015), tandis qu’en 2017, le « Salvator Mundi » attribué à Léonard de Vinci s’acquiert pour $450M. En 2018, on notait une croissance de +4% du marché de l’art au niveau mondial et ceci pour la troisième année consécutive avec un volume de 539.000 lots vendus, mené par les échanges d’œuvres contemporaines.
Alors que nous abordons en cette première moitié de 2020 une période critique pour l’économie mondiale, ayant amené galeries, musées et maisons d’enchères à fermer leur porte, les acteurs du marché de l’art se réinventent pour poursuivre leurs activités en ligne. Il est désormais courant de découvrir les œuvres dans des « online viewing rooms » (augmentation de 400% des ventes en ligne depuis 2017 pour la galerie David Zwirner). Bien sûr, elles ne seront livrées qu’une fois les mesures de confinement assouplies, mais nous observons clairement désormais l’amorçage d’une nouvelle ère, celle du marché de l’art 2.0.



