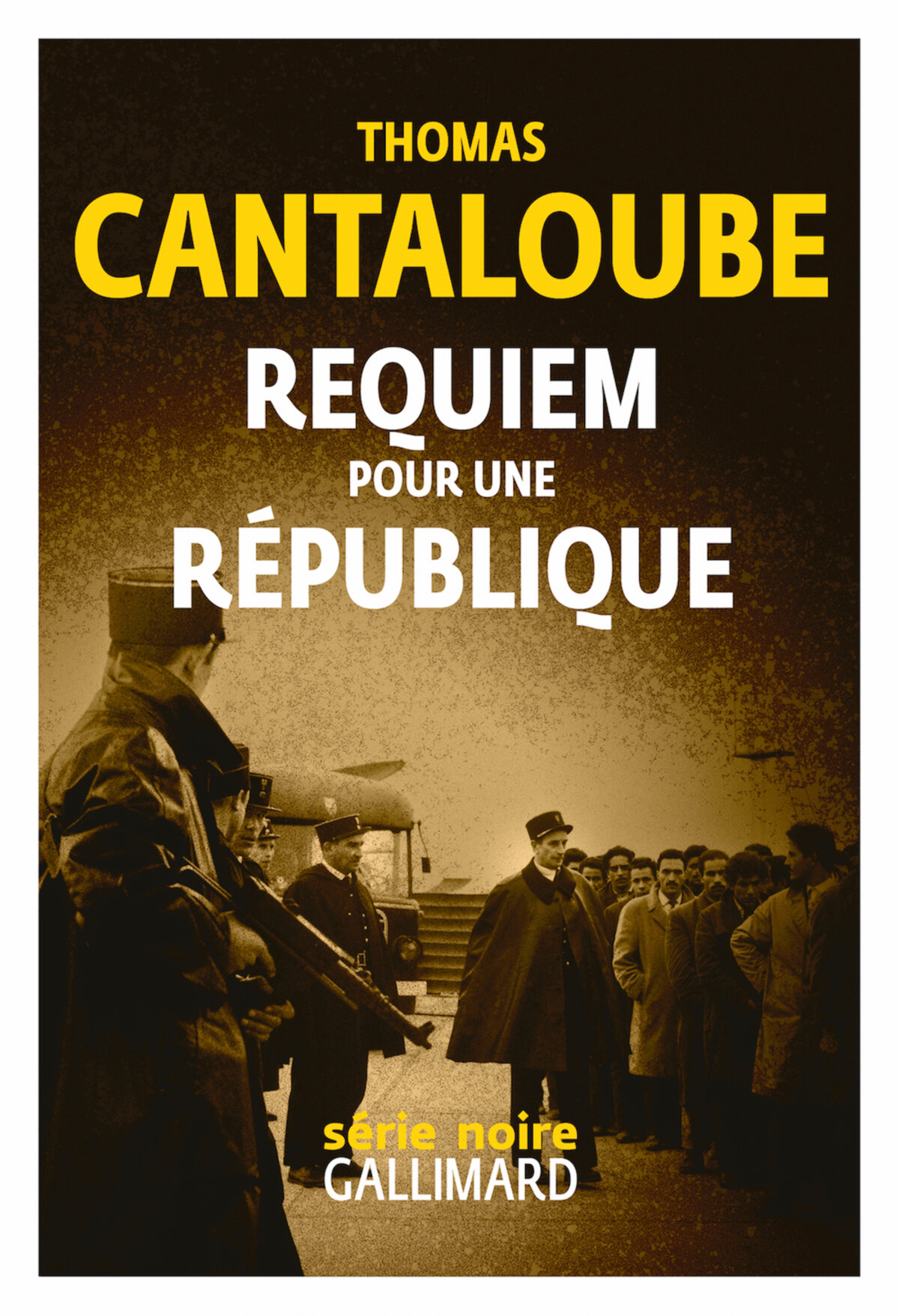
Agrandissement : Illustration 1
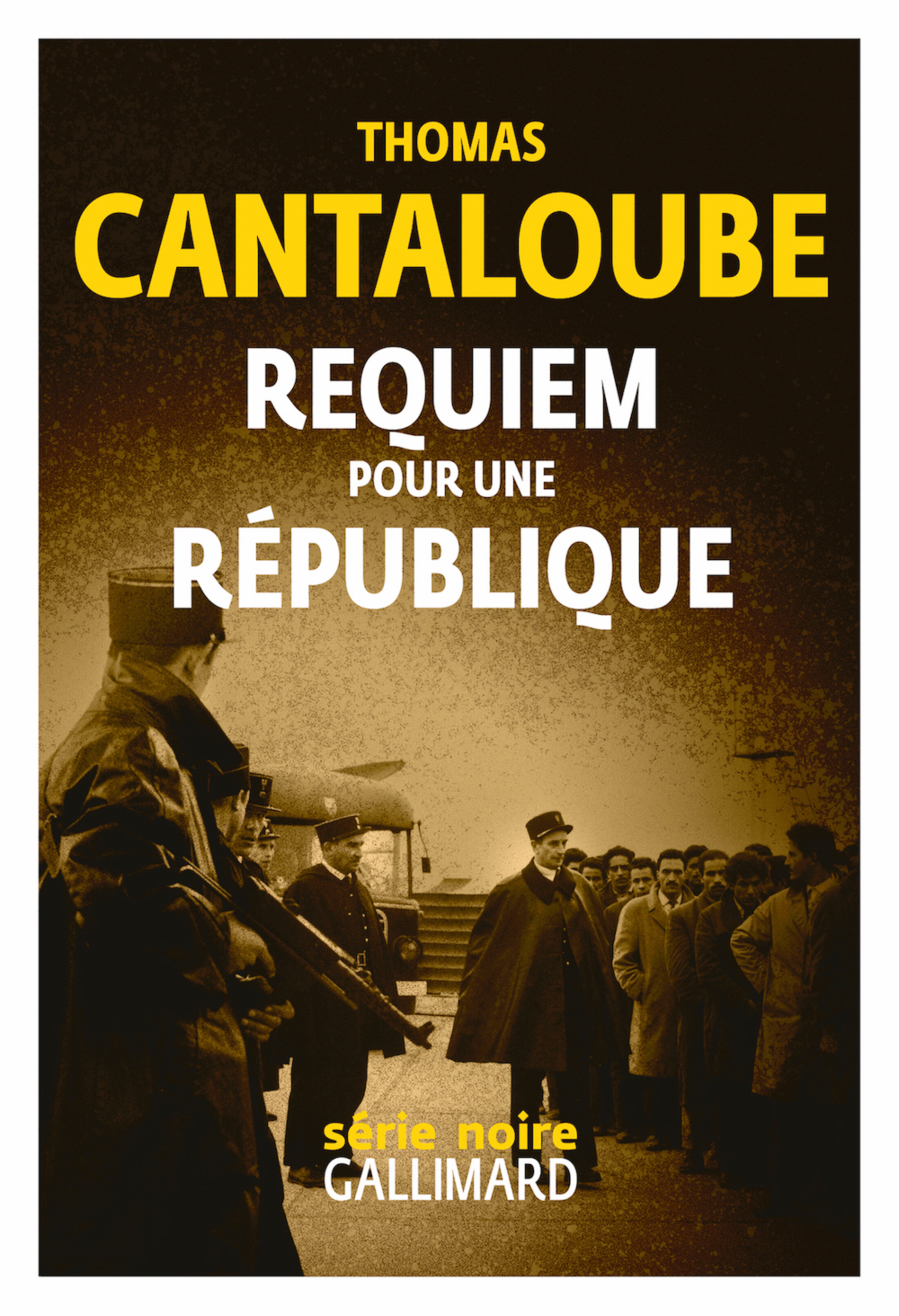
Pourquoi écrire un roman lorsqu’on est journaliste ?
Ou, plus précisément : pourquoi se lancer dans la fiction pour revisiter des événements réels quand on pourrait composer une enquête journalistique ?
Il existe plein de réponses à cette question, la vanité n’étant pas la moins courante. À titre personnel, je n’ai jamais érigé la littérature sur un piédestal qui surplomberait l’écriture journalistique. Certains des livres qui m’ont le plus marqué en termes de style ou de récit sont d’ailleurs des œuvres de reporters : « Dispatches » de Michael Herr sur la guerre du Vietnam ou bien « Nous avons le plaisir de vous informer que, demain, nous serons tués avec nos famille » de Philip Gourevitch, sur le génocide des Tutsis au Rwanda.
Au moment où sort mon premier roman, « Requiem pour une République » (Gallimard - Série Noire), ma réponse à la question du choix de la fiction est plus prosaïque : la liberté d’écriture. Une liberté que, sincèrement, je n’avais pas connue depuis les “rédactions” au collège et au lycée. Tout ce qui est venu après, les devoirs universitaires, les mémoires, les rapports de stages, les premiers articles de presse où l’on sent le souffle du rédacteur en chef sur son épaule, les reportages lointains ou au long cours, et même les essais (j’en ai commis trois) se sont insérés dans une contrainte de forme et de style. Peut-être parce que je n’ai jamais eu l’audace de les briser, même à Mediapart où il n’existe pourtant nul critère de longueur ou de style “maison”. Le seul espace qui m’a apporté autant de liberté fût mon propre blog sur la politique américaine, dans les années 2000.
Cet affranchissement par le roman m’a permis non pas de tordre les personnages et les événements historiques qui m’intéressaient, mais de les aborder de biais, de les imaginer, de deviner l’inconnu – tout ce qui est banni à juste titre dans le cadre d’un journalisme digne de ce nom. Et puis la construction d’un récit – surtout dans le cadre d’un polar, qui est le genre que j’ai choisi – autorise d’embrasser large et de s’écarter sur des chemins de traverse et des ambiances multiples, alors que l’écriture pour un journal obéit, quel que soit la longueur, au principe : « un article, un angle ».
Grâce à la fiction, j’ai pu démarrer mon récit en 1959 et le terminer en 1962 ; j’ai pu y insérer l’attentat de l’Observatoire, le déraillement terroriste du train Paris-Strasbourg, l’enterrement de Céline, la nuit sanglante du 17 octobre 1961 ; j’ai pu jouer avec les caractères de Maurice Papon, de François Mitterrand, d’Alfred Hitchcock et de quelques truands notoires, mais surtout leur adjoindre des sous-fifres inventés, des admirateurs inexistants, des zélateurs presque trop vrais. Et même rendre hommage à deux photoreporters qui ont bel et bien vécus en les fondant en un seul et même personnage.
Il n’y a pas que le journalisme qui permette de retranscrire la vérité des faits. La fiction peut y conduire aussi : elle prend les voies détournées de l’imaginaire et de l’évocation, la recréation d’ambiances qui n’ont pas existées mais qui auraient pu, l’ajout de personnage fictifs dans des situations réelles. Pour, si l’on réussit son coup, refléter les événements historiques, petits ou grands, aussi bien qu’un bon reportage. Le tout étant bien évidemment de ne pas confondre les deux et de respecter le sens de circulation des flux : le journalisme peut irriguer le roman, l’inverse ne doit jamais se produire.
J’ai vécu deux ans à Los Angeles, en Californie, à la fin des années 1990. Bien que je sache que le L.A. des années 50 de James Ellroy n’a jamais vraiment existé, en tout cas pas de manière aussi brutale et manichéenne, et qu’il est aujourd’hui enterré, combien de fois ai-je eu le sentiment de reconnaître un lieu alors que j’y mettais les pieds pour la première fois, combien de fois ai-je eu l’impression que les nouvelles du LA Times du jour me renvoyaient au Quatuor de Los Angeles ? Comme le proclamait Blaise Cendrars, qui n’a jamais prétendu être journaliste, à propos de son poème La prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France : « Qu’importe si je ne suis jamais monté dans le Transsibérien pourvu que je vous l’ai fait prendre. »
Enfin, il y avait pour moi un critère essentiel qui unit mon métier depuis 25 ans à cette aventure romanesque : écrire pour parler d’aujourd’hui, du monde dans lequel nous vivons. La fiction ne m’intéresse que rarement lorsqu’elle est déconnectée d’un ancrage contemporain (au sens d’une ancre qui relie l’imaginaire, même le plus débridé comme parfois dans la science-fiction, à notre ère). Dans « Requiem pour une république », j’ai choisi de raconter le passé, un passé qui passe mal, celui des origines de la Vème République, pour évoquer la société française de ce début de XXIème siècle, de la même manière que j’ai pu partir au fin fond de l’Amazonie en reportage sur l’extinction des Indiens au XVIème siècle afin d’appréhender l’impératif écologique des années 2010.
Le cinéaste Jacques Rivette avait défini il y a longtemps (je ne me rappelle plus où j’ai lu cela) les critères d’un bon film, de son point de vue en tout cas : un film qui dit à la fois quelque chose du cinéma et quelque chose du monde. On peut facilement transposer cette citation à la littérature. C’est ce que j’ai essayé de faire avec mon premier roman.



