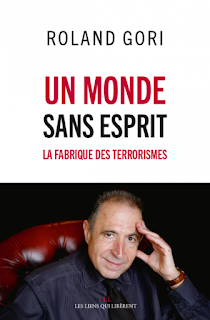
Roland Gori, Un monde sans esprit, Les Liens qui libèrent, 2017
Au point de départ, il y a le constat de la crise structurelle dans laquelle nous sommes plongés : crise économique, bien entendu, mais aussi crise culturelle qui se cristallise dans deux idéologies en apparence opposées : le retour des nationalismes et du repli identitaire d'un côté, l'islamisme radical matrice des mouvements djihadistes de l'autre. Roland Gori les renvoie dos à dos sans faire de détour sous l'appellation de « théofascismes », qui sont les enfants du néolibéralisme et non des formes de résistance à celui-ci :
« Cette crise est celle d'une vision néolibérale du monde porteuse de bonheur pour tous à laquelle plus personne, ou presque, ne croit. L'économisme qui légitime cette vision « entrepreneuriale » de l'humain a drainé le malheur des peuples contraints à l'austérité, […] l'accroissement des inégalités sociales, la violence de la globalisation, et la fragmentation des nations parfois jusqu'au chaos, qui a fait le lit des terrorismes. […] Nous voilà confrontés à deux globalisations, la marchande et la théofasciste qui, depuis quelques temps, ne cessent de se renforcer. » (p.165)
Le néolibéralisme (la généralisation à l'ensemble de la sphère sociale des logiques de marché) et le discours économiste qui le prône et le justifie se sont imposés, à la fin du XXe siècle, comme le seul horizon intellectuel et social. Ils se sont ainsi attaqués à ce qui leur résistait : la conception du bien commun, des droits sociaux, mais aussi toute forme de symbolisation autre que « le langage technico-financier » selon lequel le marché fonctionnerait de manière mécanique, à la manière d'une loi naturelle :
« Par exemple, depuis des années nous entendons les mêmes rengaines : il n'y a pas d'alternative que la croissance et la compétitivité, il n'y a pas d'autre alternative que la baisse du coût du travail pour réussir, […] il n'y a pas d'autre alternative que la baisse des déficits publics pour « dégraisser » nos finances [...] » (p.33)
Il en résulte « un monde sans esprit » dans lequel les sujets ont été privés de toute possibilité de penser autrement que dans ces catégories la réalité sociale qui est la leur, ni d'inventer des fictions collectives qui créeraient entre eux et avec le personnel politique un lien. D'où la défiance à l'égard du vote, à l'égard des partis, des syndicats… Seuls les nationalismes exacerbés et la propagande millénariste du djihad semblent offrir une voie de salut à ces être dépolitisés et désocialisés. Le néolibéralisme a ainsi produit les monstres qui s'offrent à présent de le détruire. Il s'y est employé dans le monde entier, en s'aidant non seulement de sa rhétorique et des politiques publiques, mais aussi des tapis de bombes que ces dernières ont déversés sur le Moyen-Orient, comme seule réponse à une crise globale dont elles étaient directement responsables. Nihilisme et « rationalisme économique morbide » (p.40) semblent dès lors les seules solutions, alors qu'aucune des deux ne répond au rôle réel de la politique (au sens noble) : permettre à chaque sujet singulier de passer du « je » au « nous ».
Armé de patience et d'une solide érudition, Roland Gori décortique les discours gouvernementaux et les articles de presse, débusque le sens caché des divertissements, replace les événements récents dans le temps long. Sous sa plume, Freud s'allie à Tolstoï, Kracauer à Montesquieu et Kafka à Anders pour montrer comment le marché s'est introduit à l'école, à l'hôpital et même dans nos têtes, comment sa logique pénètre jusqu'au cœur des discours annonçant le combattre et comment cette crise culturelle ne pourra en aucun cas se résoudre en mettant toujours plus à bas les services publics et les notions d'œuvre et de métier. Mais ce n'est pas qu'un énième constat tragique qu'il nous propose : nous pouvons nous en sortir en revenant aux idéaux des Lumières que le libéralisme, qui en est issu, a trahis :
« La théologie néolibérale, aujourd'hui, a fait son temps, elle doit céder la place à une démocratie renouvelée par l'humanisme. […] La thèse de cet essai est que la sortie de ce paradigme monstrueux […] passera par le viatique d'une réorganisation du travail et de l'emploi dans une « société du travail ». Il convient en premier lieu de mettre un terme à « l'organisation scientifique » de Taylor et de ses dérivés, de […] réintroduire la dimension de l’œuvre et de la parole dans le monde du travail […], en sauvant les métiers, en valorisant l’œuvre et l'artisanat, […] en politisant l'intelligence » (p.171-173)
Véritable programme politique qui ne demande qu'à ce que des citoyens et des candidats s'en emparent, Un monde sans esprit apparaît comme une arme pour sortir de la peur et de l'impuissance dans lesquelles nous demeurons, hébétés, depuis quelques temps. C'est un ouvrage riche, mais écrit de manière fluide et dynamique, comme si l'indignation et la révolte de son auteur transpiraient à chaque page. A lire par tout ceux qui, comme lui, refusent de se résigner au pire.



