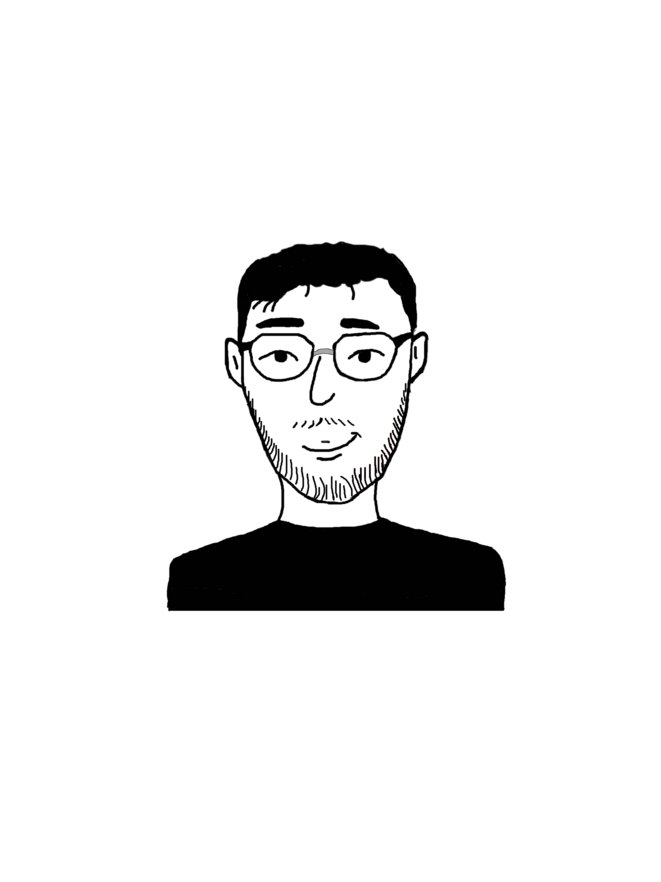Agrandissement : Illustration 1

En moins d’un siècle, la société a bien évolué. Dans les années trente, le monde était différent du nôtre à bien des égards. Qui pourrait prédire avec exactitude dans quel état sera notre planète, et notre civilisation, dans une centaine d’années ? Il semble qu’un homme ait réussi cet exploit il y a quatre-vingt-dix ans. En 1932, alors que la Grande dépression perdurait, que la production commençait à croître, et que les progrès scientifiques devenaient de plus en plus fréquents, Aldous Huxley eut une idée qui se révéla prophétique, mais à quel point ?
L’objectif de ce texte n’est en rien de vous conter la vie de l’auteur, et encore moins de vous proposer un résumé détaillé de l’oeuvre. L’intérêt est plutôt celui de vous convaincre de jeter un œil à ce grand roman, et ce, grâce à quelques détails.
Initialement voulu comme une parodie à l’Utopie de H.G. Wells (Men Like Gods, 1923), le monde décrit par Huxley dans les années trente est, en bien des points, comparable au monde dans lequel nous vivons tous aujourd’hui. Le travail, la consommation et le capitalisme sont, comme chez nous, les bases de la société imaginée par l’auteur. Selon les dirigeants de ce monde dystopique, le bon fonctionnement même de la société repose sur la consommation des citoyens, et pour permettre cela, il faut donc une production tournant à plein régime. Le travail est alors vu comme le stabilisateur de l’ensemble.
Dans ce monde, il y a une nouvelle vénération, surpassant toutes les religions actuelles : Henry Ford. L’industriel britannique occupe alors le rôle d’un Dieu tout-puissant, si bien que l’intrigue ne se déroule pas en 2540 après Jésus-Christ, mais 632 après Ford (ce qui facilite le jeu de mot avec « dear God »).
Derrière cette nouvelle forme divine, on retrouve un gouvernement également tout-puissant, qui contrôle tous les aspects de la vie quotidienne. Ainsi, les familles également n’ont plus de raison d’être. Un enfant ne naît plus, il est conçu en laboratoire. Rien n’est laissé au hasard, tout est décidé avant même le début de la vie. La société est divisée en classes et sous-classes, les « Alpha + » au sommet, les « Epsilon - » tout en bas. Tout cela dépend de la richesse, et chaque embryon, attaché à une classe, reçoit des attributs génétiques bien déterminés, lui permettant de réaliser les tâches qui lui seront demandées, mais pas plus. Le marché du travail fonctionne alors « parfaitement », tout le monde connaît sa tâche.
L’on pourrait alors croire en une lutte des classes, mais c’était sans compter sur l’omnipotence du gouvernement. De la naissance au passage à l’âge adulte, tous sont soumis à la même propagande, avec quelques distinctions selon les classes, de façon à laisser croire à chacun qu’il occupe une position idéale dans la société.
En réalité, ce monde, comme le nôtre, est construit et tourne autour d’illusions. Dans cette société, les individus se croient libres, heureux. Ils pensent accomplir ce qu’ils souhaitent, alors que dans les faits, ils ne font que répondre aux besoins des plus puissants et plus riches. Tout cela est tellement intériorisé que personne ne se révolte contre la surveillance permanente mise en place pour s’assurer du «bien commun».
Malgré les nombreuses fêtes orgiaques, et l’illusion de pleine liberté, ce monde est également très solitaire. L’usage quasi institutionnalisé de la drogue récréative, soma, vise concrètement à masquer cette solitude imposante. Les parallèles avec la société actuelle sont nombreux, avec des réseaux sociaux qui n’ont de « social » que le nom, l’illusion de relations démultipliées mais tout aussi enrichissantes, ou même le besoin de s’affirmer. Aujourd’hui, chacun est invité à vendre son personnage public en permanence, pour mieux s’aligner avec les cadres de la société, alors que chez Huxley, tout le monde est désespéramment identique.
Mais que se passe-t-il quand un individu diffère de la norme ? Voilà justement là tout l’intérêt de ce livre, avec des personnages comme Bernard Marx, un Alpha au physique de Gamma qui ne veut pas de cette société superficielle et déteste l’objectification des femmes, ou John «le Sauvage», qui a grandi hors de l’État mondial dans une des rares «réserves», et qui découvre avec horreur ce «monde nouveau», où même Shakespeare est interdit.
Dans la dernière partie du livre, John, à l’occasion d’une discussion avec un des puissants, assume sa volonté de « pouvoir être malheureux », et revendique aussi « le droit de devenir vieux, laid et impuissant ; le droit d'avoir la syphilis et le cancer ; le droit de ne pas manger à sa faim, le droit d'être mal nourri ; le droit de vivre dans l'appréhension constante de ce qui peut arriver demain ; le droit d'attraper la typhoïde ; le droit d'être torturé par des douleurs indicibles de toute sorte ».
Si dans 1984, George Orwell craignait que la peur allait être la fin de l’Homme, Huxley nous alerte sur les dangers d’une société construite sur le désir et un «bonheur» capitaliste.
- Dorian Vidal