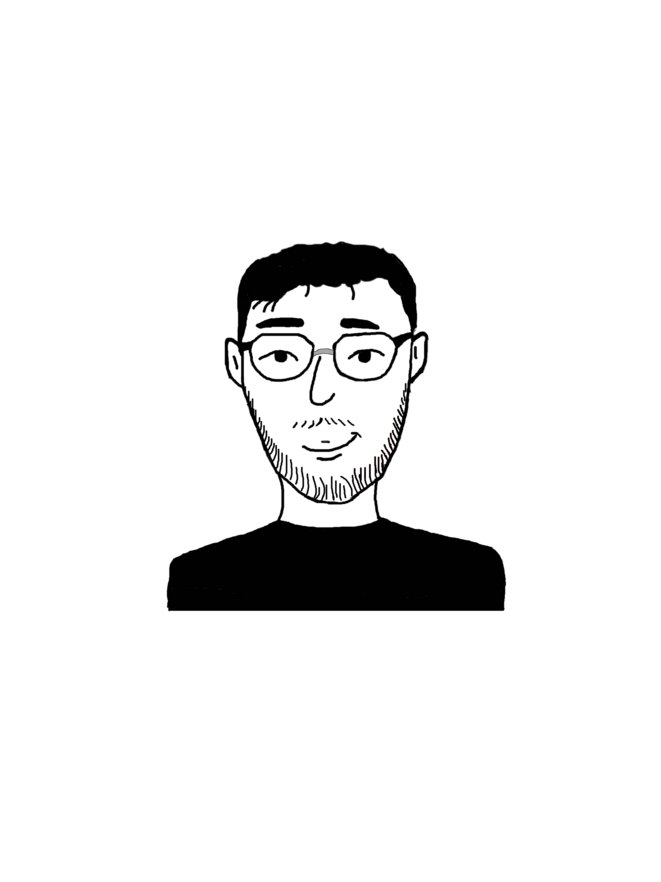Agrandissement : Illustration 1

Une question de perspective. Y a-t-il «une seule Chine» ? À quoi correspond la République populaire de Chine quand la République de Chine se trouve de l’autre côté du détroit ? Quelle nation correspond véritablement à cette Chine «unique» ? Ces questions, vieilles de plusieurs décennies, sont à l’origine de fortes tensions entre Pékin et Taipei. Dans un monde des plus mondialisé, où les alliances et groupements internationaux foisonnent, ces tensions finissent par se répercuter bien loin des territoires directement concernés.
Cependant, à une époque où la conscience de l’état changeant de la planète, et de la nécessité d’agir, est plus partagée que jamais, la question des efforts à mener pour mettre terme à cette spirale infernale est souvent reléguée bien loin dans les placards de l’actualité. Pire encore, la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique, semblent être de simples pions à manier lors de négociations diplomatiques, ou même de quelconques objets de chantage. Les derniers conflits, que ce soit celui entre la Russie et l’Ukraine, ou celui entre la Chine continentale et Taïwan, illustrent justement cela.
La relation entre l’île de Taïwan et Pékin est un sujet complexe, et relativement ancien. À peine plus vieille que la cinquième République française, la République populaire de Chine est proclamée le 1er octobre 1949, par Mao Zedong, sur un balcon donnant sur la place Tian’anmen. Le Parti communiste chinois (PCC) triomphe officiellement du Kuomintang (KMT), le parti nationaliste, qui dirigeait le pays depuis les débuts de la République de Chine, proclamée en 1912. C’est alors de l’autre côté du détroit, sur l’île de Taïwan, que les nationalistes du KMT se réfugient. Taipei devient la capitale de la République de Chine, en opposition à Pékin, capitale de la République populaire de Chine.
Rapidement, la tension monte entre les deux entités. Ainsi, quand débute la guerre de Corée en 1950, et que la République de Chine se range du côté des sudistes avec l’appui des États-Unis – à l’opposé de Pékin, qui soutient le nord communiste – les différences entre les deux nations semblent être au plus haut. Dans cette relation, les États-Unis ont également un grand rôle à jouer, comme ce sera vu plus tard. Mais comme de nombreuses relations, tout est une question de perspective et d’interprétation.
«一个中国», ou le «One China principle»
Prenons l’exemple du principe d’une seule Chine. Défendue par la Chine continentale, cette position avance qu’il n’existe qu’une seule Chine unifiée, et que, par conséquent, Taïwan en fait parti. Ce principe, son acceptation, est la base même des relations entre la RPC et la RC. Elle est d’autant plus importante qu’elle représente la base de la diplomatie pékinoise avec le reste du monde. Tout pays qui n’accepterait pas ce principe ne pourrait justifier de relations avec la Chine continentale.
Les États-Unis en arbitre
Pour beaucoup de nations, il est alors nécessaire de marcher sur des œufs quand il est question de discussion avec la République populaire de Chine. Un des exemples les plus parlant reste l’approche choisie par les États-Unis d’Amérique depuis plus de quarante ans. Outre-Atlantique, la Maison-Blanche multiplie les prises de position en faveur de Taïwan, tout en essayant de maintenir des relations diplomatiques cordiales avec Pékin. Un véritable jeu d'équilibriste, qui se poursuit aujourd'hui.
Ainsi, en réponse au discours de Xi Jinping lors du 20e congrès du Parti Communiste Chinois, Antony Blinken, US Secretary of State, a réitéré le soutien étasunien à Taïwan, tout en rappelant la politique d’une seule Chine.
«Nous sommes déterminés à tenir nos engagements envers Taïwan, en vertu de la loi sur les relations avec Taiwan, et déterminés à soutenir leurs capacités à se défendre. Mais nous restons également fermement attachés à la politique d’une seule Chine.»
- Antony Blinken, le 17 octobre 2022
Un jour plus tôt, le président Xi abordait de nouveau la question de Taïwan, soulignant qu’elle serait «résolue par le peuple chinois» de manière pacifique. Cependant, la Chine ne «renoncerait jamais à l’usage de la force», et un conflit direct reste encore possible.
Après la période d’accalmie dans les années 1970-1980, la situation reste quelque peu ambiguë entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Les tensions que l’on observe aujourd’hui entre les deux puissances économiques ne sont pas récentes, et elles se sont même amplifiées depuis la moitié de la dernière décennie. Il y eut des accusations de cybers-attaques en 2014, suivi par des suspicions de vols de technologies et de propriétés intellectuelles quatre ans plus tard, tout cela menant à la «guerre économique» que l’on peut observer en ce moment.
À une époque où il semble difficile de trouver des terrains d’entente entre les démocrates et les républicains, les suspicions et l’ambiguïté envers la Chine sont un élément commun aux dernières administrations politiques, de celle de Barack Obama à Joe Biden, en passant par Donald Trump.
Refroidissement entre la Chine et les Etats-Unis
Cependant, l’animosité entre les deux nations paraît être à son apogée depuis peu de temps.
En 2020, John Ratcliffe, alors directeur du renseignement national, qualifiait la République populaire de Chine «plus grande menace aux États-Unis». La même année, ce fut Mike Pompeo, secrétaire d'État de Donald Trump, qui accusa Pékin de crime contre l’humanité et de génocide, concernant la politique de répression et d’internement des Ouïghours.
Cette attitude et ces accusations ont été prolongées par l’administration Biden, allant jusqu'au boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février 2022.
Nancy Pelosi, «l’une des amies les plus dévouées de Taiwan»
Pour Pékin, la goutte de trop aura été la visite de Nancy Pelosi à Taipei. En atterrissant sur l’île au début du mois d’août, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis souhaitait réaffirmer le soutien étasunien au gouvernement et à la population taïwanaise. «La solidarité étasunienne avec les 23 millions de Taïwanais est plus importante aujourd'hui que jamais, car le monde fait face à un choix entre l'autocratie et la démocratie», déclarait l'élue.
Si cette visite a été chaleureusement accueillie par la présidente Tsai Ing-wen et par une grande partie des 23 millions d’habitants de l’île, la réaction fut tout autre de l’autre côté du détroit. Immédiatement après le départ de Pelosi, Pékin a enclenché de nombreux exercices militaires de grande envergure à proximité de la République de Chine, avec certains prenant place à moins de 16 kilomètres des côtes de l’île, dans des zones correspondant aux eaux territoriales de Taiwan.
Le gouvernement chinois a également accusé les États-Unis d’utiliser Taïwan pour «contenir le Chine», et pour empêcher la RPC de compléter la «réunification» avec l’île. Parmi les menaces et sanctions brandies par la Chine contre les États-Unis, se retrouvait la lutte contre le changement climatique.
La protection de l’environnement, simple objet diplomatique comme un autre ?
À peine Nancy Pelosi posait ses bagages sur l’île, le gouvernement chinois annonçait ses contre-mesures. Ainsi, Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la RPC, affirmait le 3 août que ces mesures seraient «fermes, vigoureuses et efficaces, et [que] la patrie américaine et les forces d'indépendance de Taïwan continueront à les ressentir».
«Depuis un certain temps, les États-Unis ont dit une chose et en ont fait une autre, en tordant constamment, en déformant, en annulant et en évidant le principe d'une seule Chine».
- Xie Feng, vice-ministre des Affaires étrangères de la RPC
Après avoir accusé le gouvernement américain de ne pas tenir sa parole et de se moquer de la politique d’une seule Chine, Pékin a annoncé rompre toute coopération avec les États-Unis, que ce soit dans le domaine militaire, ou même dans la lutte contre le changement climatique.
Jusque-là, l’environnement était un domaine qui semblait, des deux côtés, comme essentiel et donc a priori à l’abri de toute rupture diplomatique. Cette décision unilatérale prise par le gouvernement de la RPC montre alors à quel point les relations entre les deux puissances sont tendues.
La planète s’embrase, le monde diplomatique se tend, et l’environnement passe à la trappe
Dans un monde où les effets du dérèglement climatique ne sont plus niables, l’arrêt de toute coopération entre les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre ne pouvait pas advenir à pire moment. Dans la lutte contre le changement climatique, principale priorité pour la sauvegarde de l’humanité, les intérêts individuels, qu’ils soient étatiques, entrepreneuriaux, industriels, ou même ceux de quelques individus avec un ego surdéveloppé, devraient être mis de côté. Toute l’humanité est concernée par la crise qui s’annonce, riches comme pauvres, vieux comme jeunes. Les actions individuelles sont encouragées et vont dans le bon sens, mais sans véritable coopération internationale, la situation ne pourrait radicalement s’améliorer.
Après le retour de la guerre en Europe, fruit de la volonté d’un seul homme, alors que des guerres ne semblent jamais pouvoir prendre fin en Afrique et au Moyen-Orient notamment, un nouveau conflit pourrait attirer l’attention des leaders de ce monde.
Les conséquences d'un conflit armé sont nombreuses, mais ceux qui les souhaitent sont généralement bien à l'abri. Les populations civiles, les soldats, ainsi que l'environnement dans son ensemble sont directement touchés par ces décisions politiques. Eugene Stakhiv, chercheur pour l'UNESCO, l'écrivait pour le magazine Foreign Policy, la destruction de l'environnement devrait être considérée comme un «crime de guerre».
Herbert Hoover, 31e président des États-Unis, déclarait que si ce sont «les hommes plus âgés [qui] déclarent la guerre, ce sont les jeunes qui doivent se battre et mourir». L’histoire lui donne raison, et l’actualité encore plus.
Aujourd’hui, les plus jeunes sont également les premiers concernés par les effets du changement climatique. Les plus âgés sont ceux qui prennent les décisions pour leur avenir, avec le plus souvent, leurs propres intérêts personnels en tête. Les guerres n’ont jamais rien résolu, les conséquences des multiples conflits qui ont marqué l’histoire résonnent encore aujourd’hui, et si l’on veut vraiment assurer l’avenir des générations à venir, il serait plus que temps que de sortir de ce cercle vicieux.
Les guerres ne servent que l’intérêt de quelques-uns, la lutte contre le changement climatique doit servir toute l’humanité.
- Dorian Vidal