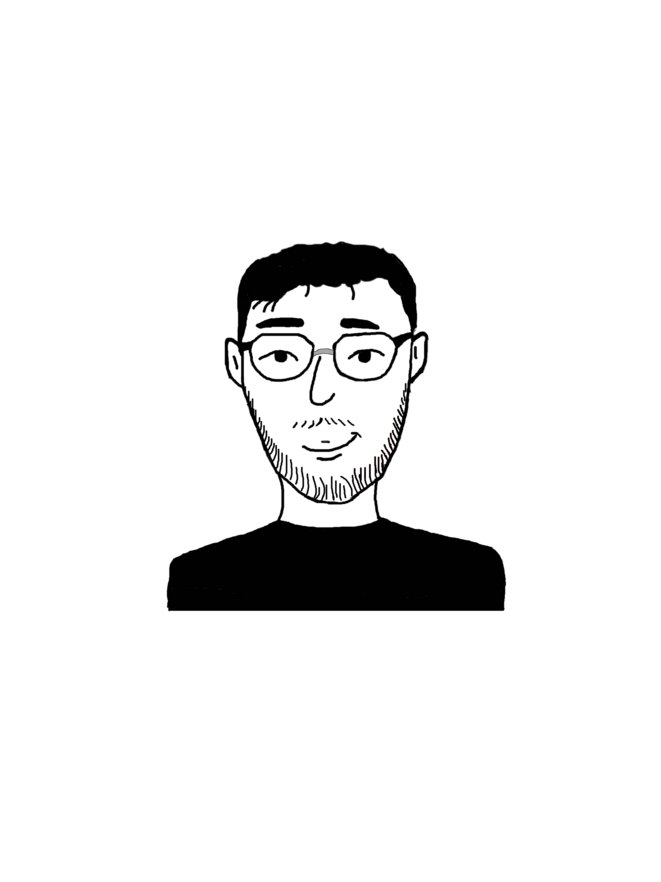Agrandissement : Illustration 1

Après un vote le 1er mai dernier, la Writers Guild of America, principal syndicat représentant les auteurs et scénaristes derrière vos films et séries préférées, entrait en grève. Depuis la prise de pouvoir des plateformes de streaming, c’est le premier mouvement d’envergure.
Il y a quinze ans, la WGA faisait déjà entendre sa colère. Dans ce qui semble être un monde totalement différent de celui que l’on connaît aujourd’hui, le mouvement a tenu 100 jours. En 1988, ce fut pendant 153 jours que les scénaristes étasuniens cessèrent toutes activités. Un record.
Le métier de scénariste en danger
Cette décision est bien réfléchie. Avec l’arrivée récente, et quelque peu effrayante, des intelligences artificielles, et le poids de plus en plus important des plateformes de streaming, la W.G.A. est formelle. Il s’agit d’une crise «existentielle», qu’il ne faut pas prendre à la légère.
En 2013, Netflix, qui arborait jusque-là le costume du gentil postier/collectionneur de DVD, lançait une adaptation des romans de Michael Dobbs, House of Cards. Dix ans plus tard, l’entreprise se voit comme un pilier majeur de l’industrie.
Un article originellement publié sur ma newsletter. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement pour ne rien manquer!
Toujours plus de «contenu»
Petit à petit, les plateformes de streaming se sont imposées dans nos vies. Si Netflix peut-être crédité de l’initiative, le mouvement a rapidement été suivi. Il est aujourd’hui rare de trouver un studio sans sa plateforme attitrée. Aux côtés des Paramount, HBO, Disney, des géants du numérique et des technologies n’ont pas voulu se sentir rejetés: Apple, Amazon essayent tant bien que mal de s’affirmer.
À la manière de Youtube, ces sites rassemblent une quantité sans cesse grandissante de créations. Chaque semaine, de nouvelles séries, de nouveaux films, sont distribués directement sur chaque plateforme. Chacune a construit sa clientèle, son réseau de consommateurs, sur une certaine idée de «l’originalité», et surtout, autour de la promesse de toujours plus de contenus.
Du «second-screen content»
L’arrivée de séries et autres créations télévisuelles à portée de clics faisait déjà peur aux scénaristes en 2007. L’on peut légitimement penser que leurs cauchemars sont malheureusement devenus réalité.
Si l’on a pu connaître «l’âge d’or» des séries télévisées, avec des créations originales comme Breaking Bad, Mad Men, ou encore Atlanta, il semble que cette ère se rapproche de son crépuscule. Actuellement, l’heure est plus aux reprises, avec l’ambition de coller aux dernières tendances.
Lila Byock, scénariste ayant travaillé sur The Leftovers et Watchmen, résume la situation pour The New Yorker. «Quand on arrive avec un script original, ils te disent ‘Oh, on ne peut pas faire ça, mais faites votre choix parmi nos prochains projets Batman!’»
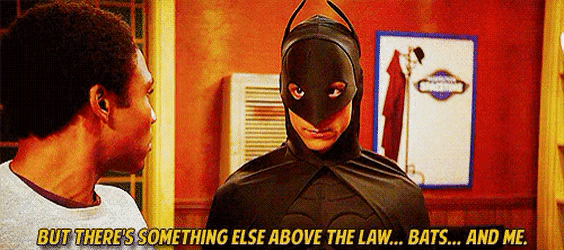
À la recherche du prochain «blockbuster» style Marvel/Stranger Things, l’originalité n’a plus la cote chez les grands studios et leurs plateformes. La stratégie de Disney en est l’exemple parfait, avec la multiplication des séries spin-off tirées des différents univers en sa possession.
«Les studios cherchent uniquement du ‘second-screen content’», explique Lila Byock. On ne cherche pas la qualité, mais quelque chose de facile à regarder. Du «contenu» que l’on consommerait sans le digérer, comme une musique d’ascenseur, pour tuer le temps, ou se donner l’impression de faire quelque chose (alors que l’on est collé à son téléphone, ou sur une autre tâche).
L’objectif des studios n’étant globalement que la recherche du profit, ils n’ont que faire de la manière choisie par chacun pour «consommer».
L’abondance a ses limites
Fut un temps, les sorties de films dans les salles obscures faisaient l’événement. Les rendez-vous devant les postes de télévision pour suivre sa série préférée étaient immanquables. Aujourd’hui, il semble que tout cela soit terminé.
Marvel a essayé, avant même le début de la décennie 2010, puis a tout gâché en multipliant films, comme séries. Établie par Disney, cette stratégie est rapidement élargie à la saga Star Wars, et à l’ensemble du catalogue du groupe.
Chaque semaine, sur toutes les plateformes, des «nouveautés», originales ou pas, sont poussées en avant. Devant ces buffets sans fin, l’on perd rapidement l’appétit. Vendue comme telle, cette «démocratisation» de la culture a sûrement du bon, mais ses défauts sont difficiles à ignorer.
Je soutiens lebreak par un don
Binge-watcher, quoi de plus étrange?
En plus de publier chaque semaine LA nouvelle série qu’il ne faudrait louper pour rien en monde, le côté épisode qui faisait l’identité même des séries semble être passé aux oubliettes. Une série ne devrait pas s’expérimenter comme un film, sinon, à quoi bon?
Une bonne série télévisée se différencie par la qualité de son écriture notamment, mais surtout par la gestion du temps du récit. Le suspens et la frustration générée quand on sait que l’on doit attendre une semaine, voire plus, pour découvrir la suite, est un des essentiels du monde de la narration épisodique.
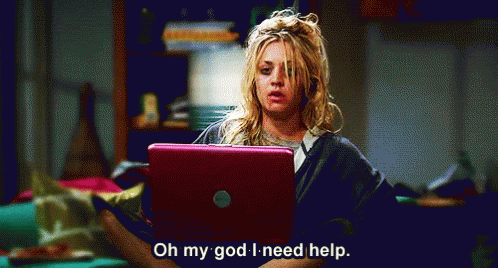
Seulement, avec l’arrivée des plateformes, un nouveau phénomène a fait son apparition. Le «binge-watching», ou «visionnage boulimique» pour la CELF, devient la norme. En diffusant tous les épisodes d’un même coup, les sites de streaming encouragent cette consommation mécanique, surtout quand on sait qu’une nouvelle série sortira prochainement.
Il faut alors se dépêcher de finir telle ou telle série, pour s’attaquer à la dernière nouveauté en date. On ne profite alors plus vraiment des différentes créations, ce qui n’empêche pas les plateformes d’en profiter, à un autre niveau.
L’environnement toujours en danger
À l’échelle individuelle, une heure de visionnage de contenu sur une plateforme comme Netflix n’a pas un impact effrayant. Cela n’autorise cependant pas de dire que le streaming n’est pas dangereux pour le vivant. Non, vous n’êtes pas seul sur cette planète. Plus de huit milliards d’êtres humains peuplent la Terre, et ce chiffre croît vitesse grand V.
En 2020, et seulement durant les 28 premiers jours suivant les parutions des 10 séries les plus populaires sur Netflix, ce sont plus de 6 milliards d’heures de visionnage qui sont cumulés. Selon les calculs du Carbon Trust, cela reviendrait à la pollution générée par un trajet en voiture, long de 1,8 milliard de kilomètres. L’équivalent de la distance séparant la Terre de Saturne.
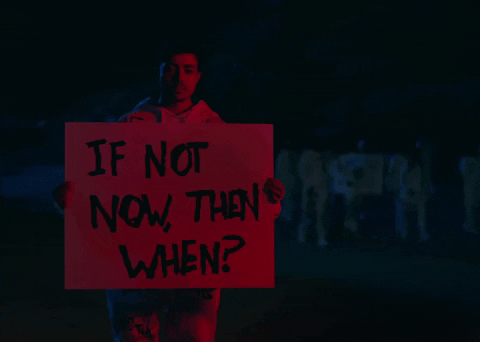
Il est néanmoins évident que le streaming vidéo est loin d’être le secteur le plus polluant. L’énergie, le logement, les transports ou encore l’agriculture nécessitent des refontes totales si l’on veut préserver une vie sans trop de dangers pour tous. Mais, si l’on commence à voir chaque problème sous cet angle - «oui, mais bon, il y a pire à côté» - ce n’est pas comme cela que l’on va faire avancer les choses.
Le capitalisme à son paroxysme
Les nouvelles technologies sont sans doute derrière ce nouveau besoin d’immédiateté. Quand on veut quelque chose, on le veut maintenant, ou jamais. La patience est rare aujourd’hui. Tout comme la capacité à rester concentré, mais ça c’est une autre question (sur laquelle lebreak se penchera sûrement).
L’e-commerce, les réseaux sociaux, les applications de rencontre… tout cela joue sur les mêmes propriétés. Les différentes plateformes de streaming l’ont bien compris, et appuient à leur manière sur ces mêmes mécanismes. Habitués à un catalogue toujours plus rempli, les utilisateurs font pression sur les plateformes, qui font tout pour sortir chaque semaine des nouveautés, et ainsi de suite.
Ce cercle vicieux est l’exemple même des dérives du système capitaliste. La qualité n’importe peu, tant que l’on peut donner quelque chose de «nouveau» aux consommateurs, la mission est accomplie. Ainsi, le nombre de nouvelles créations télévisuelles ne cesse de bondir: les 200 nouvelles séries parues en 2010 paraissent bien ridicules face au plus de 600 dévoilées en 2023. Et ce, aux États-Unis seulement.
Une grève qui pourrait bien durer
Pour permettre ce rythme diabolique, il a bien fallu faire des sacrifices. Adieu saisons longues d’une vingtaine d’épisodes, bonjour séries bouclées en dix épisodes.
Tout cela, la diminution du temps de travail, de la qualité et de la créativité, ainsi que la demande sans cesse grandissante, sont au coeur des revendications de la WGA. Avec le streaming, les scénaristes ont perdu d’importantes sources de rémunérations. Les sorties DVD sont rares, et comme les plateformes ne comptabilisent pas officiellement les (re)visionnages de tel ou tel épisode, un auteur ne peut plus vivre confortablement de sa création.
Le processus d’écriture à l’ère du streaming se rapproche de celui d’une «ligne d’assemblage» d’une usine fordienne, ironise Alex O’Keefe, jeune scénariste de la série The Bear.
-Dorian Vidal
Retrouvez tous mes autres articles gratuitement ICI.