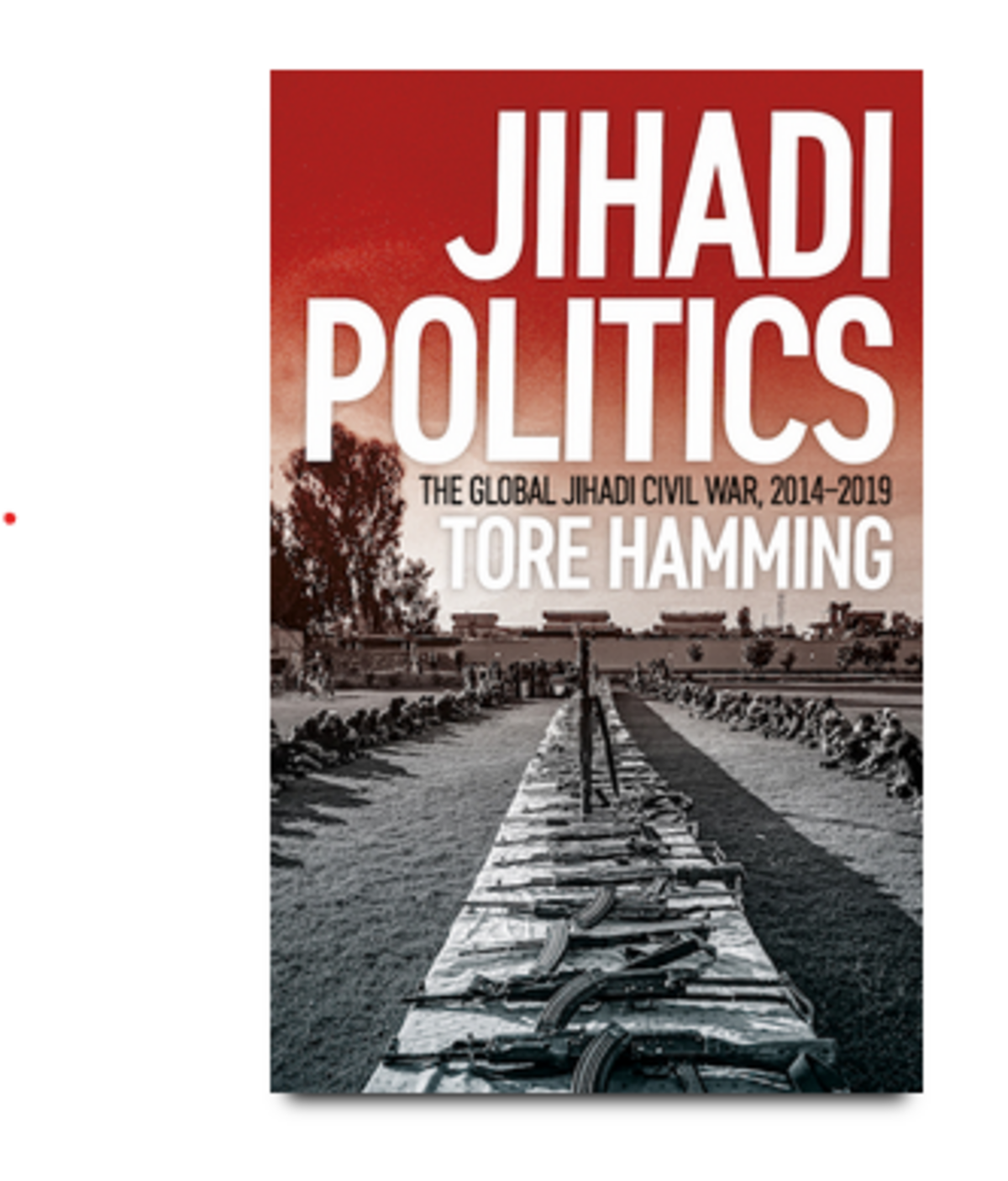
L’ouvrage de Tore Hamming raconte comment et pourquoi des groupes qui a priori ont bien plus de points d’accords que de divergences se sont livrés une guerre si contre-productive pour les militants du Jihad. C’est une guerre civile qui a causé aux alentours de 8000 morts entre 2014 et 2019. Du Sahara à l’Afghanistan, son épicentre était la Syrie où des factions salafo-jiahdistes se sont livrées à des affrontements violents sur fond de rivalités politiques et de débats théologiques. Contrairement à l’idée répandue qu’Al Qaida et Daech se sont mutuellement combattus pour des raisons d’interprétation religieuse, le chercheur danois avance que c’est avant tout leur quête pour l’hégémonie qui les a conduit à se séparer, se détester et s’entretuer. Si leur pratique du Jihad diffère fondamentalement, cet aspect demeure secondaire dans leur combat fratricide par rapport à la lutte pour s’assurer la suprématie au sein du Mouvement Sunniste Jihadiste (Sunni Jihadist Movement, SJM dans le livre).
Il faut remonter aux fondements du Salafo-Jihadisme moderne pour comprendre comment différentes visions au sein d’un même groupe peuvent mener à la séparation puis à l’affrontement direct. Tore Hamming replonge d’abord dans l’histoire des débats et des conflits idéologiques entre Jihadistes dans les années 1980 et 1990. Il évoque «l’école de Jalalabad » qui marqua une première fracture au sein du SJM en raison de son « extrémisme » notamment en excommuniant (Takfir) les Taliban. L’école de Jalalabad influença par ailleurs le Groupe Islamique Armé (GIA) algérien qui adopta lui aussi une posture de rejet à l’égard de ceux ne partageant pas ses méthodes, y compris l’organisation fondé par Ben Laden. Cependant, le premier grand précédant qui mit au grand jour les logiques d’alliance puis de de rupture entre groupes jihadistes se trouve en Iraq avec la proclamation de l’Etat Islamique en Irak[1] par Zarqaoui. D’abord adoubé par Al Qaida et un de ses principaux idéologues, Al Maqdisi[2], le groupe mené par le terroriste jordanien s’autonomisa progressivement de l’autorité de Ben Laden et Zawahiri avant de se faire renier par ce dernier.
Le 11 septembre exposa Al Qaida comme principale organisation au sein du SJM. Cette domination dura jusqu’à la prise de Mossul par Daech qui devint à son tour le groupe de référence dans le mouvement jihadiste, pouvant adopter une posture plus agressive à l’égard de Zawahiri dont l’entreprise était déjà fortement affaiblie. Si Daech est historiquement né en Iraq de l’ancienne branche d’Al Qaida, c’est en Syrie que la guerre contre les autres Jihadistes prit place. La franchise qaïdiste Al Nosra et son émir al Jolani refusa de prêter allégeance (Baya’a) à Daech après avoir réaffirmer son engagement auprès de Zawahiri. C’est ensuite par discours interposés d’idéologues, de déclarations de chefs et de débat sur réseaux sociaux que la Fitna (sédition, discorde) donna place à une authentique guerre entre Jihadistes. La violence inouïe utilisée par Daech pour défendre et étendre son califat en fit un mouvement de masse séduisant à travers le monde. Cette surenchère était également un moyen de se distinguer de ses rivaux en Syrie qui conservaient un agenda limité à la chute du régime Assad et l’établissement d’une société nationale régie par la Charia. Cette dichotomie entre objectif califal et universel couplé à une politique communautariste avec un usage du Takfir (excommunication) étendu et jihadisme local se retrouvera au-delà du levant.
Tore Hamming expose également le rôle majeur des idéologues tout au long de son livre. La légitimisation ou déligitimisation de telle action ou de tel groupe par des personnalités reconnues par les Jihadistes comme Abu Mohamed Al Maqdisi ou Abu Qatada al Filistini demeure un aspect crucial quant à la capacité d’un groupe à s’affirmer à long terme. Daech a été globalement désapprouvé par ces légendes vivantes du Jihad, mais réussit à compenser ce manque de légitimité savante par une communication plus maitrisée. Enfin, c’est à l’intérieur même des groupes jihadistes que des scissions s’opèrent et que les idéologues s’opposent. On apprend par exemple dans le livre qu’à partir de 2016 Daech, pourtant d’habitude décrit comme relativement uniforme, connaissait deux tendances internes : la première était celle que son idéologue principal Turki al-Binali avait prônée et qui était celle des cadres de l’Etat Islamique dont al Adnani, relativement « modérée » (ie qui ne considère pas le Takfir comme un fondement de la religion). Les défaites militaires et les assassinats successifs de ses cadres au cours de 2016 favorisèrent la montée en puissance d’Ahmad al-Hazimi et de sa vision encore plus extrémiste prêchant que le Takfir est un pilier de l’Islam.
D’autres points importants du livre:
- Les Jihadistes et surtout la jeune génération considère de plus en plus normal le fait qu’ils combattent d’autres Jihadistes, ce qui demeurait un sujet tabou dont l’évocation était très délicate avant les années 2010.
- La rivalité intra-jihadiste est une aussi une lutte pour acquérir des ressources et recruter des militants qui sont le fer de lance de la cause ; chaque groupe cherche à capter et donc à priver ses concurrents de ses ressources.
- Daech n’a jamais accepté la coopération d’autres groupes et demandait l’allégeance de ceux-ci.
- Al Qaida a survécu et reste aujourd’hui un mouvement jihadiste important grâce à ses liens sociaux créés avec des individus importants.
- Le contexte local influence l’idéologie des groupes, poussant certains à sortir même d’une logique de Jihad pour retrouver un paradigme salafiste. L’ancienne branche d’Al Qaida en Syrie qui a rompu avec sa maison mère mène contrôle désormais un territoire et une population significative et cherche à apparaitre aux yeux des habitants et de la communauté internationale comme une autorité légitime.
[1] Originellement Al Qaida en Irak
[2] Qui fut par ailleurs le mentor de Zarqaoui
Pour acquérir le livre: https://www.hurstpublishers.com/book/jihadi-politics/



