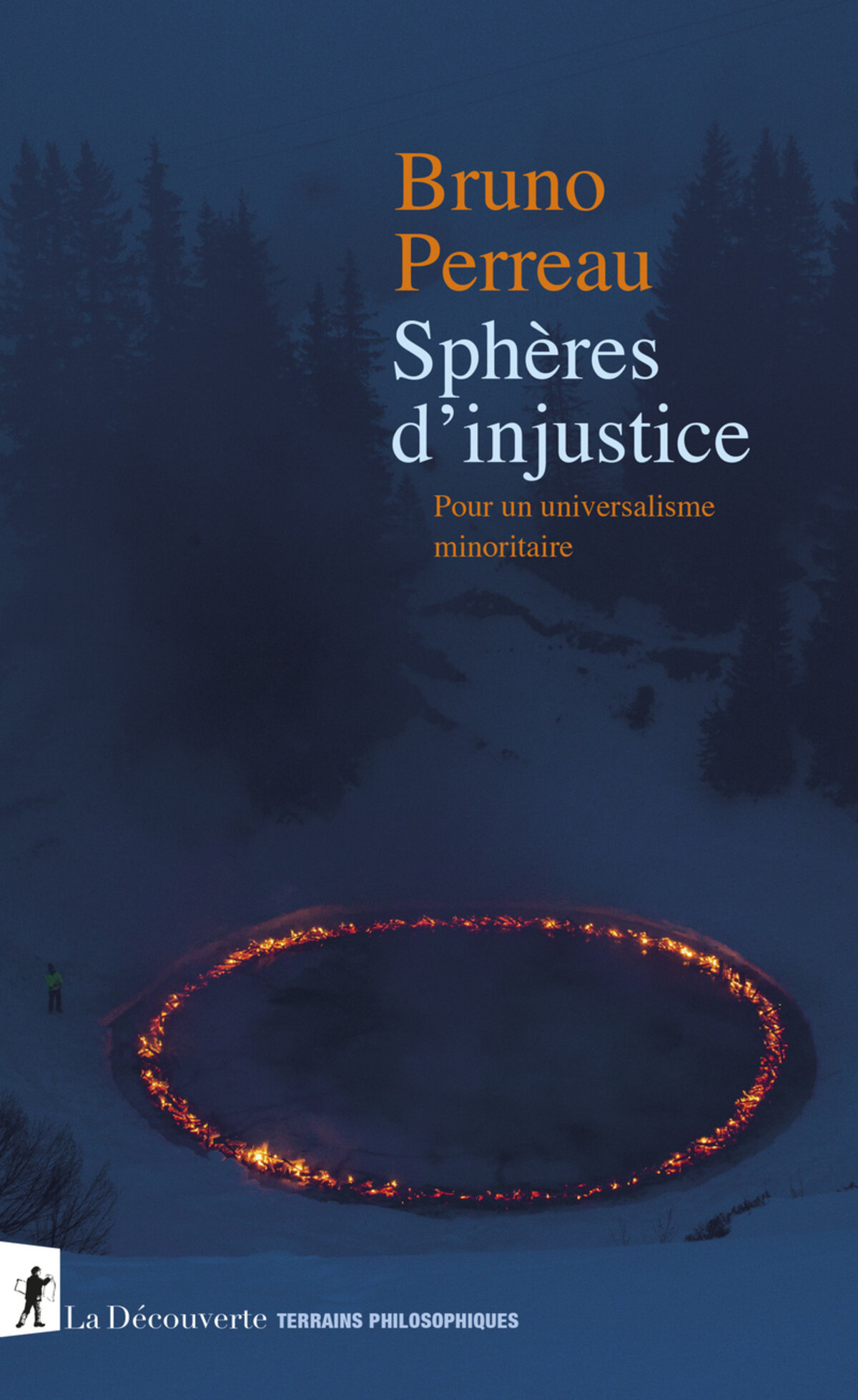
Agrandissement : Illustration 1

« Je n’attribue [aux minorités] aucune vertu dont la majorité ne pourrait se targuer. L’expérience de l’exclusion ne confère aucune supériorité morale ». Ce n’est pas l’exclusion qui scelle une vie minoritaire mais une mutilation dans l’attachement à cette vie. Toute l’audace de Bruno Perreau pour renouveler la théorie de la justice sociale est contenue dans cette proposition : puisque, selon la formule du poète Hölderlin, « là où croît le péril croît aussi ce qui sauve » – quand et là où « résonnent les traces d’autres vies minoritaires bafouées », cette mutilation est le ressort même d’une insurrection vers une société plus juste.
Pour développer son éthique du minoritaire et écarter les écueils évidents de sa démarche, Perreau dessine une éthique de la réciprocité amplement redevable à Judith Butler : se laisser toucher par l’autre autant que nous pourrions nous laisser toucher par nous-mêmes, par-delà l’opacité qui nous constitue. Le minoritaire est ce qui vient différer notre croyance que ce que nous sommes coïncide avec ce que nous nous représentons que nous sommes. Le trouble avec la norme ou le normal est l’emblème non pas de « la rétention d’une identité mais sa mise à disposition », une humanité augmentée quasi par effraction, par démultiplication irrésumable de ce qui est proprement humain. Le minoritaire n’est donc que dans le majoritaire la part qui, face à lui, s’expose dans « la honte de désirer une autre vie et de ne pas aimer suffisamment la nôtre ». L’attachement à sa vie, parce qu’elle n’est qu’une infime sélection des possibilités empêchées en elle, engage d’emblée la collectivité : « le “moi élargi”, pour reprendre les termes de [Michael] Sandel, est “redevable” envers une communauté dont il a besoin pour se réaliser en tant qu’être doté de différentes identités ».
Se dégage ici la mission d’un universalisme minoritaire, dont je suspends l’exploration pour faire part de mes exaspérations de lecteur. La lecture que Bruno Perreau fait des dynamiques de revendications minoritaires ressemble à une hagiographie : prenons pour exemple le combat autour d’Adama Traoré, qui donnerait la formule d’une manière réussie de mobiliser en « faisant toute sa place aux personnes non minoritaires ». On a vu par ailleurs (avec George Floyd) dans quels délires de repentance celles-ci ont pu s’engouffrer, l’auteur n’en fera nullement mention, alors qu’enseignant aux Etats-Unis, il les a sous les yeux. L’indigénisme français a ses faveurs, mais il le regarde avec les yeux d’un américain lui-même aveugle à ce qui l’entoure.
Cette distorsion du regard trouve à s’illustrer d’une manière encore plus éclatante : choisir la fusillade du Pulse à Orlando comme démonstration que « la présence des minorités perturbe, en tant que telle, l’ordre social » en passant sous silence la motivation djihadiste de son auteur (« les journaux télévisés évoquent la piste terroriste », point-barre). Certes, concède-t-il, « une minorité peut être ciblée par une autre, qui se donne ainsi l’illusion d’être, une fois n’est pas coutume, du côté dominant ». Aussi, la violence n’est pas nécessairement offensive, mais défensive parfois, côté opprimés, ce qui la légitime : « une réponse par anticipation de l’adversité ». En résumé, l’auteur ne va pas jusqu’à dire que le mal dont est capable « l’opprimé » est une compensation symbolique face à l’oppression qu’il subit ; mais rien n’empêche de le penser.
L’islamisme ? Rien que le cancer cultivé par « les mouvances contre-minoritaires » pour pathologiser les autres minorités avec la musulmane, jamais un mal endogène à la minorité musulmane elle-même. Ainsi, discriminer parmi les revendications minoritaires ce qui relève de revendications islamistes (le burkini, etc.) n’est même pas envisageable. Je force encore le trait : une minorité a bien des griefs à nous faire connaître ; par contre, elle ne saurait jamais nous causer du tort.
Bref, un livre précieux et irritant. J’ai voulu en rendre compte dans l’inachèvement de ma lecture et l’écartèlement dans mon ressenti. Au final, je me demande comment une « société décente », dont l’auteur dit souhaiter l’avènement et auquel son travail théorique contribuera sans conteste, s’accompagne d’un déni de la violence quand celle-ci embarrasse. Aujourd’hui, et singulièrement parmi les milieux engagés contre les discriminations, ce partage obscène entre la violence qu’on réprouve et celle qui embarrasse est une mécanique entièrement intégrée dans la « fabrique de l’humiliation ».



