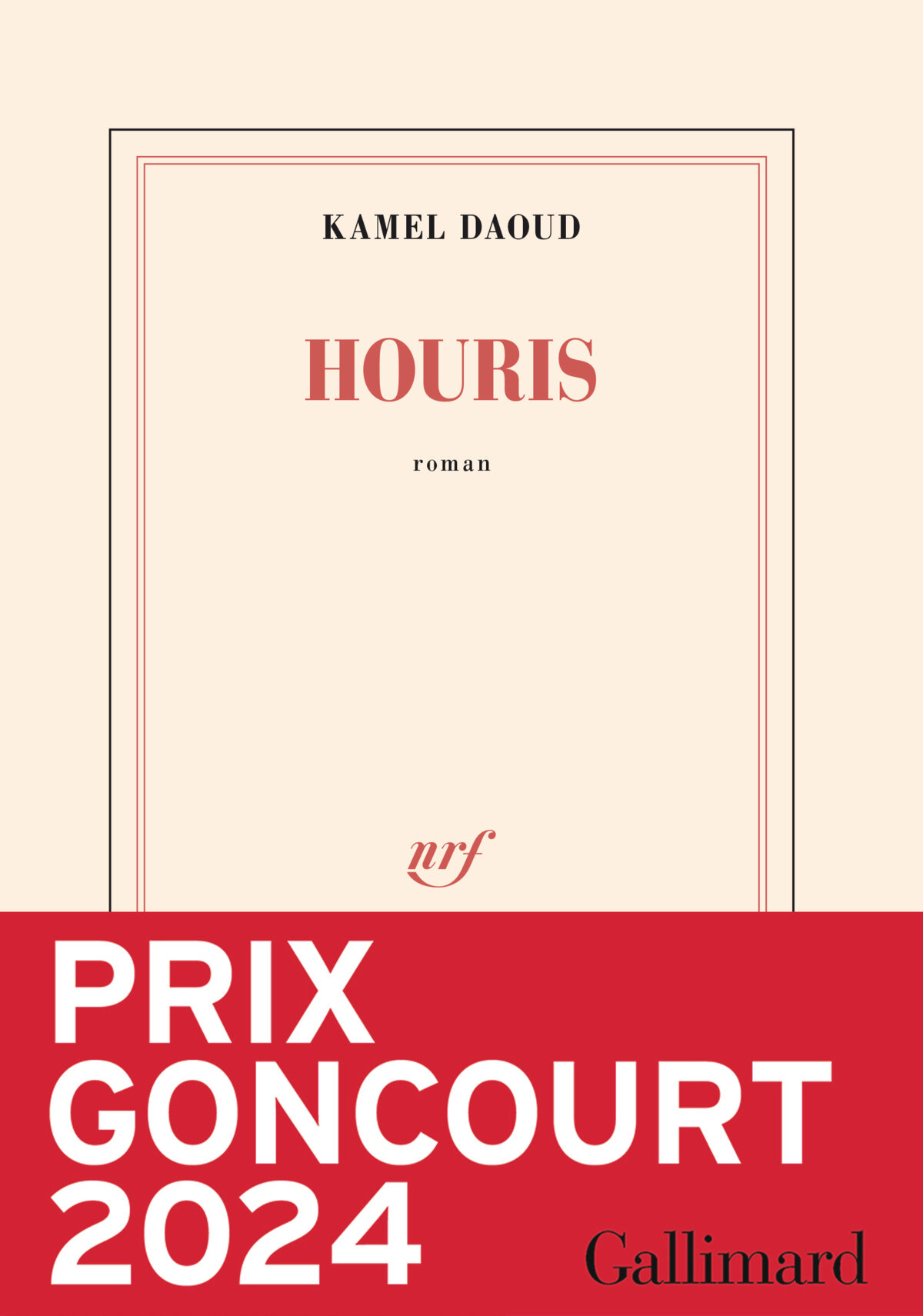
Agrandissement : Illustration 1
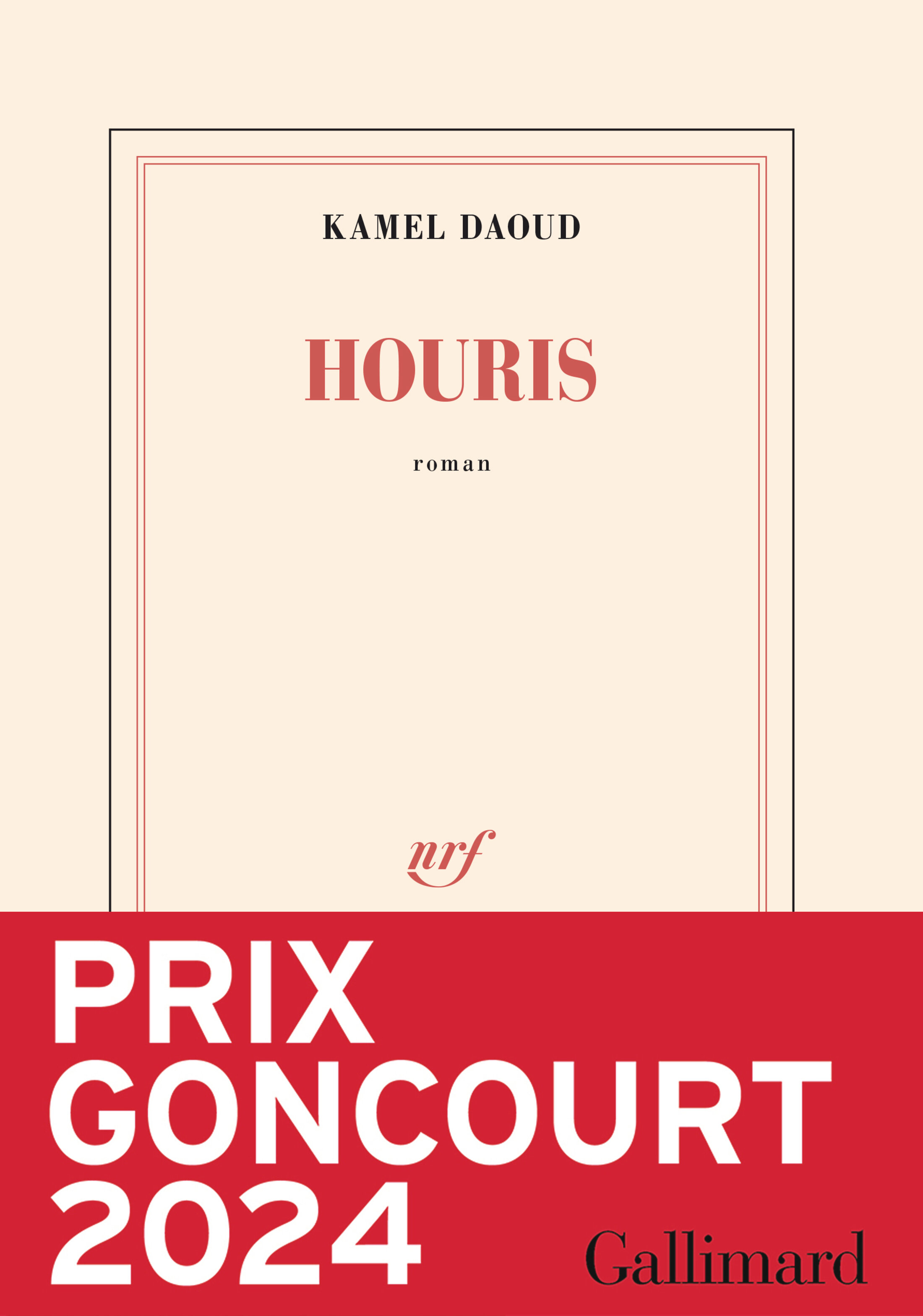
Houris, un livre obsédant. Allez-y, Kamel Daoud au sommet de son art ! C'est limpide. Un réquisitoire implacable contre ce scandale absolu en terres d'islam : le sort réservé aux femmes. La violence du déni de l'événement monstrueux qu'a été la « décennie noire » et la monstruosité de cette décennie. Qu'on traverse avec effroi. Mais qu'on traverse. Et puis, plus souterraine et déjà annoncée dans Zabor, ou les Psaumes, la négociation d'une vie avec la blessure qui l'imprègne.
Ce chemin, le lecteur qui ferme le livre n'en dira rien à son prochain explorateur. En quelque sorte, c'est l'obsession de chacun : guérir. Car, si Zabor compte des pages à tonalité très psychanalytique, ce n'est pas le cas ici, mais c'est bien de résilience dont il est question, que Daoud tente de cerner au plus près. Dans une trame narrative pas du goût de tout le monde, un récit heurté comme la mémoire. Une grande réussite.
Le talent de Daoud passe par un tour de force inouï, si je peux me permettre, venant d'un homme « arabe » : parler pour une femme (pas « à la place de », mais « à destination de »). C'est ce que lui refuse la chroniqueuse littéraire Lucile Commeaux (« Houris : la langue d'une femme, la parole d'un éditorialiste ») parce qu'ici s'effondre la défense de son idéologie relativiste : elle ne croit que les récits à la première personne, surtout s'agissant d'une femme. Mais alors, comme dit Isabelle Barbéris, « quand il n'y aura plus de témoin pour témoigner, la littérature finalement se taira. On n'en parlera plus. Ainsi conçue, la littérature ne survivra plus à la mort des “concernés” » (Censures silencieuses, p. 194).
Ce que lui refusent aussi des thérapeutes et des associatives algériennes traitant des violences (entre autres sexuelles) envers les femmes durant la dite « décennie ». La subjectivité est une discussion encore neuve de l'autre côté de la Méditerranée, mais il faut lire leur papier, « Le prix de la trahison », diatribe contre Daoud adossée au témoignage de la femme « outragée » d'avoir inspiré le personnage d'Aube dans le roman, et bourrée de contre-vérités, de réécriture de l'histoire (les agressions à Cologne n'ont pas eu lieu, puisqu'on efface leurs auteurs*), d'atrophie paranoïaque et orgueilleuse, de mépris de l'écrivain et de son livre (à quoi bon le lire en entier ?), pour comprendre l'adversité redoutable à laquelle Daoud a à faire face, et combien les élites algériennes sont complices de l'impasse où le régime mène le pays, ayant la haine de la France pour seuls boussole et horizon. Au fond, ici, tout se passe comme si le lecteur français avait dépossédé la mémoire de l'Algérien. On nage en pleine hystérie. Le vernis « décolonial » a creusé un gouffre entre la France et l'Algérie.
En Algérie, il n'y a pas que « le Genre » qui soit « intraitable », pour paraphraser la philosophe Nadia Tazi résumant les Politiques de la virilité dans le monde musulman, mais la mémoire aussi – ou à quel prix ! A l'intersection des deux, l'islamisme. En quelque manière, l'Algérie francise ses non-dits. Elle les externalise, dans l'opprobre et l'embastillement.
* Et on reprend la même ritournelle que la fameuse tribune de 2016 que j'avais commentée dans L’Autre Quotidien.



