Les séries sont aujourd’hui à l’image des romans publiés en feuilleton au XIXe siècle. Celles-ci mobilisent nos imaginaires, elles orientent nos façons de penser et de voir le monde. Les protagonistes des séries sont élevés en modèles ou antihéros pour nos sociétés. Une série peut devenir un lieu de réflexions profondes sur l’état de notre monde. C’est à partir de celles-ci que naissent et se développent de nouvelles luttes et contestations.
On peut donc concevoir certaines séries comme des lieux de débats publics. À titre d’exemple, Peaky Blinders nous pousse à réfléchir sur les conséquences de la violence industrialisée et mondialisée impliquée par la Première Guerre mondiale. Les dernières saisons de cette série nous poussent à actualiser nos connaissances sur les chemins qu’emprunte le fascisme, et comment celui-ci se fraye jusqu’au sommet du pouvoir.
Les séries sont donc éminemment reliées au temps, qu’il soit passé ou à venir. L’Histoire est souvent un élément-clé de ces productions, si ce n’est pour certaines leurs raisons d’être. L’historien et professeur Mickaël Bertrand s’est précisément concentré sur ces enjeux. Son ouvrage, L’Histoire racontée par les séries publié en 2022 aux éditions L’Étudiant, analyse les nombreux partis pris par les séries lorsque celles-ci mobilisent l’Histoire. L’Histoire peut alors prendre plusieurs visages. Il peut s’agir d’un simple cadre narratif où se déroule l’intrigue, à une réelle exploitation du contexte historique avec des personnages ayant réellement existé. Le souci de restituer l’Histoire le plus objectivement possible varie selon les productions et les pays où elles sont réalisées. Dans cet ouvrage, Mickaël Bertrand s’appuie sur plusieurs séries qu’il décortique avec précision. De Vikings à The Crown, L’Histoire racontée par les séries a beaucoup à nous apprendre.
Vincent Mathiot : Le monde des séries est vaste. Un tel sujet nécessite une longue préparation et de nombreux choix. Comment avez-vous élaboré ce projet ?
Mickaël Bertrand : Pour être tout à fait honnête, je n’ai pas tout de suite été convaincu par ce projet éditorial. Mon premier réflexe a été de considérer que la meilleure façon de parler d’histoire avec les séries consiste… à regarder des séries ! et non à lire un livre sur l’histoire racontée par les séries.
Il a fallu toute la force de persuasion de mon éditrice, Charlotte Sperber, ainsi que de mes proches, pour que je commence à esquisser quelques idées sur le papier. Après quelques nuits de réflexion, j’avais quasiment le plan de l’introduction où je développe les raisons pour lesquelles les séries, bien que populaires, ne doivent pas être considérées comme un art secondaire.
Le projet était alors lancé.
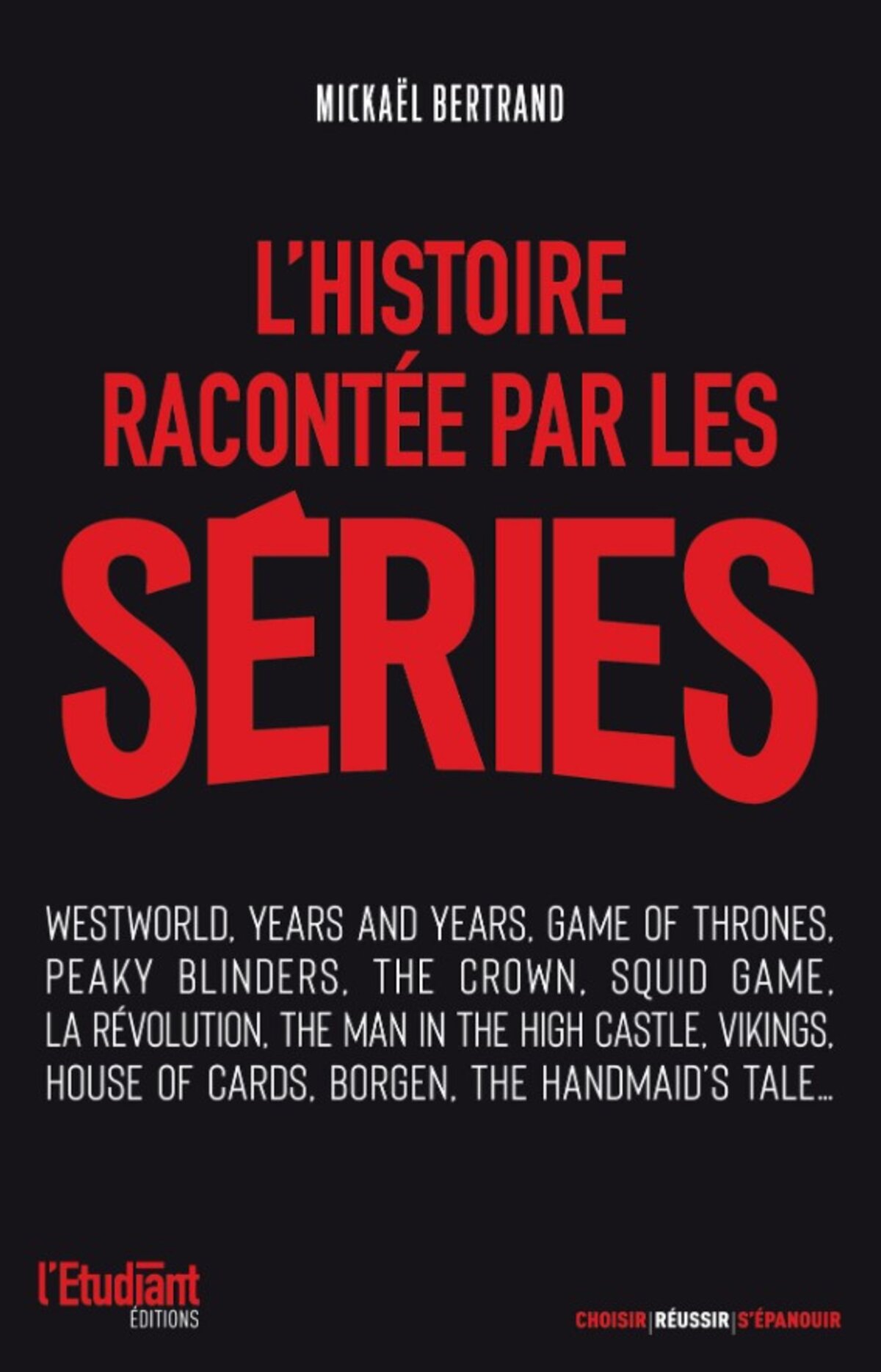
Agrandissement : Illustration 1
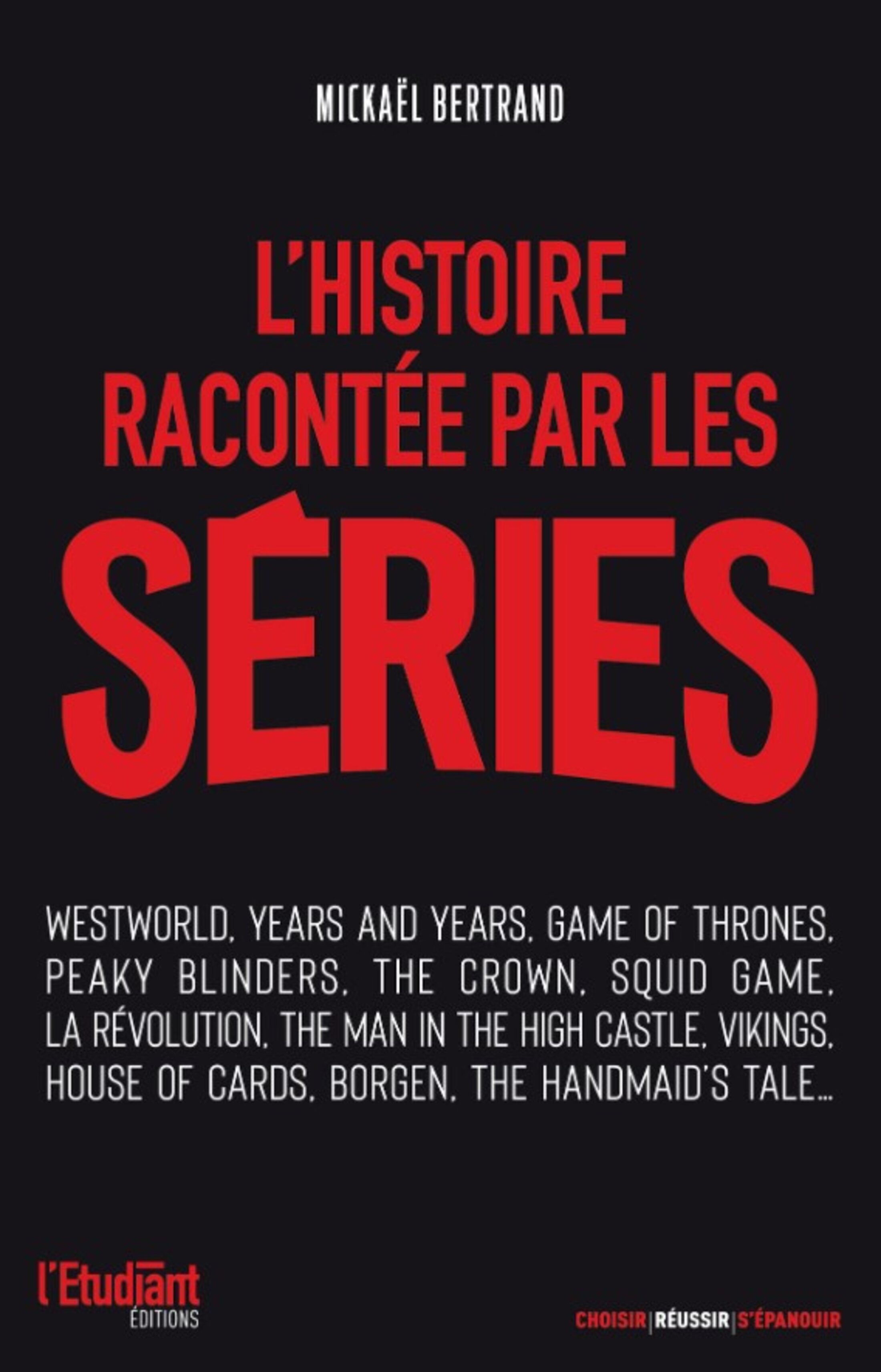
V.M. : L’Histoire racontée par les séries suit-elle une organisation particulière ?
M.B. : J’avais envie de traiter à la fois de séries particulières telles que The Crown, Game of Thrones... qui sont considérées comme des classiques incontournables, voire des chefs-d’œuvre inéluctables, mais aussi d’évoquer des séries plus anciennes ou moins connues qui constituent pourtant des propositions exigeantes.
La liste définitive n’a pas été facile à arrêter. Il y a certaines séries que j’avais déjà vues et d’autres qu’il me fallait encore visionner en urgence. Je tenais également à ce que la sélection soit relativement équilibrée en termes de périodes évoquées. Enfin, j’avais aussi à cœur de mettre en avant certaines productions françaises que l’on a trop tendance à sous-estimer.
Bref, il y aurait de quoi écrire encore deux ou trois tomes.
V.M. : Certaines séries portent en elles des messages profonds qui suscitent des réflexions sur notre société. Peut-on considérer que les séries ont une portée éducative ?
M.B. : Il ne faut pas attendre des séries ce qu’elles ne sont pas.
Je partage assez largement dans ce domaine les conclusions proposées par Romain Vincent sur l’usage des jeux vidéos à l’école. Dans ces travaux, cet enseignant-chercheur rappelle qu’il n’y a pas d’effet magique de ces supports qui sont certes considérés comme plus attractifs, mais qui n’ont pas de valeur pédagogique intrinsèque. Comme pour tout document ou outil, ce qui compte vraiment, c’est ce que l’enseignant en fait et comment il l’introduit dans un scénario pédagogique qui permettra aux élèves d’apprendre. J’ajouterais qu’il est par ailleurs impossible pour des questions de droits, mais aussi de neutralité commerciale, de demander aux élèves de regarder des séries que l’on utiliserait ensuite comme support en classe.
Cela n’empêche pas néanmoins de mobiliser des extraits, des images, ou bien d’évoquer une intrigue comme une porte dérobée permettant d’entrer dans des savoirs académiques parfois complexes. Ainsi, dans le chapitre consacré à la série Peaky Blinders, j’essaie de montrer qu’il y a derrière le scénario une thèse historiographique importante (bien que discutée) autour de la trivialisation de la violence de guerre et la brutalisation des sociétés européennes entre 1918 et 1945. Quant à The Crown, elle permet d’introduire les travaux passionnants de l’historien Ernst Kantorowicz sur Les deux corps du roi, que tout le monde connaît par l’intermédiaire de l’expression « le roi est mort ; vive le roi », et qui sont essentiels pour comprendre l’incarnation du pouvoir, y compris dans nos systèmes politiques contemporains.
Pour résumer, je dirais que les séries ne permettent pas nécessairement d’apprendre, mais elles donnent envie de savoirs et aident à mieux comprendre des phénomènes complexes. En cela, elles constituent déjà des objets pédagogiques qui méritent toute notre attention.
V.M. : Regarder une série est-ce faire preuve de civisme, d’implication démocratique ?
M.B. : En tant qu’enseignant d’histoire, géographie, mais aussi d’éducation morale et civique, il me semblait important d’aller à l’encontre de certaines opinions convenues considérant que les séries alimentent la défiance envers les hommes et femmes politiques. A mon sens, Baron Noir montre également de manière intéressante l’abnégation dont fait preuve une grande partie du personnel politique. Certains sont prêts à tous les sacrifices pour défendre leurs idéaux. Cette lecture est trop peu mise en avant alors qu’elle mérite d’être défendue aux yeux d’un jeune public qui semble perdre dangereusement confiance en la politique et délaisser progressivement les principes démocratiques.

Agrandissement : Illustration 2

V.M. : Les séries permettent-elles de faire germer une prise de conscience collective ?
M.B. : Dans certains cas, oui. J’évoque dans l’ouvrage l’importance de séries telles que It’s a sin ou encore Angels of America qui ont joué un rôle essentiel dans la connaissance et la compréhension de l’épidémie de SIDA dans les années 1980 et 1990.
D’un autre côté, je suis un peu plus perplexe sur l’impact de certaines séries qui ont peut-être été trop vite considérées comme l’incarnation d’une nouvelle génération (par exemple, Euphoria ou encore Generations). Je fais souvent le parallèle entre ces productions et celles que j’ai vues pendant mon adolescence en me disant que les jeunes d’aujourd’hui ne doivent guère s’identifier davantage aux héros et héroïnes de ces séries que je ne le faisais devant Beverly Hills ou Hartley, Cœurs à vif. On peut certes s’attacher à des personnages, mais rester tout à fait conscient de leur caractère utopique.
V.M. : Les séries peuvent nous pousser à avoir une prise de conscience civique. Un concept de série comme de The Crown serait-il transposable à un régime politique comme la Ve République ?
M.B. : Je propose au fil de l’ouvrage différents encadrés avec des propositions de séries qui n’existent pas encore. Une série sur la Ve République me passionnerait mais il faut reconnaître que les contraintes scénaristiques et juridiques sont fortes. Les scénarios ont en effet besoin de s’attacher à des personnages alors que les présidents qui incarnent le régime politique se succèdent rapidement (à l’inverse de la monarque dans The Crown). De même, plusieurs acteurs sont encore vivants et pourraient intenter des procès. Je ne désespère pas cependant que des scénaristes talentueux parviennent à développer un scénario solide, en s’appuyant sur des conseillers historiques incontestables.
V.M. : On constate d’ailleurs que les gouvernements font appel à des équipes de scénaristes pour anticiper les différentes voies de notre avenir…!
M.B. : On croise en effet parfois les scénaristes dans des projets surprenants. Le ministère de la Défense fait appel à eux pour anticiper les potentielles guerres de demain. A titre personnel, je trouverais intéressant que ce qui se fait dans le domaine militaire puisse être également décliné dans d’autres ministères : ne pourrait-on pas aussi mettre des historiens, des sociologues, des philosophes et des scénaristes autour d’une table pour imaginer ce que sera la famille ou encore le travail dans un siècle ? Cette méthode qui semble évidente pour préparer la défense du pays n’aurait-elle pas tout autant d’intérêt pour imaginer les politiques économiques et sociales des prochaines décennies ?
V.M. : Certaines productions de séries reçoivent aujourd’hui plus d’investissements que la production d’autres films. Vous montrez dans votre ouvrage que la qualité des scénaristes ainsi que des producteurs est de plus en plus présente dans les séries. Assistons-nous à la naissance d’un art sériel ?
M.B. : Les séries se rapprochent finalement de plus en plus d’autres arts reconnus tels que le cinéma et la bande-dessinée. Il n’est d’ailleurs pas anodin de constater que de grands cinéastes comme Quentin Tarantino ou encore Xavier Dolan se confrontent à cet exercice. Les moyens mis à disposition de la production de séries permettent désormais de développer des contenus, mais aussi des histoires et des thèses qui ne pourraient pas être développées au cinéma.
La suite de notre conversation sera partagée le mercredi 11 janvier 2023.
À bientôt !



