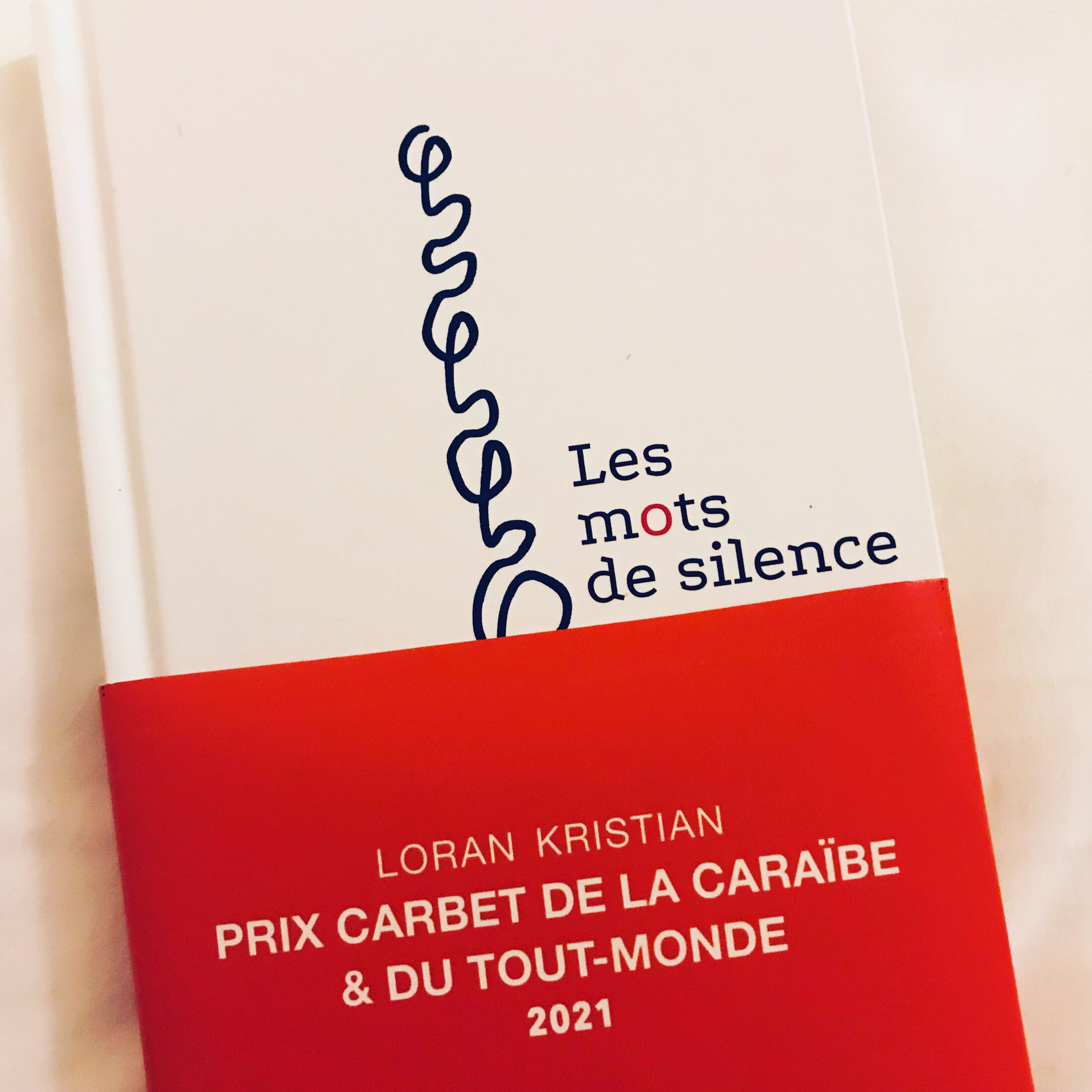«Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche»
La littérature antillaise est née d’une opposition. En s’opposant à la doxa littéraire de l’Occident des années 1930, la langue française s’enrichissait de nouvelles voix. Ses figures iconiques sont celles d’Aimé Césaire, Maryse Condé, Frantz Fanon… Ouvertement engagés contre la politique coloniale, ces écrits permettaient de mettre des mots sur une situation encore trop ignorée. Le Cahier d’un retour au pays natal de Césaire est un point de départ de cette littérature de l’émancipation. Ces mots parlent d’eux-mêmes : «Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir.» À cette recherche de l’esthétique littéraire, ces auteurs et autrices convergent vers une quête de l'affranchissement. Le concept de négritude défini par Césaire, Damas et Senghor dans la revue Tropiques montrait les limites du mythe civilisateur. La culture antillaise était en partie structurée par son héritage africain. Celui-ci, jusqu’alors mémoriel, s’incarne consciemment dans les cultures afro-américaines.
Au carrefour des cultures
La façade Atlantique du continent américain est un carrefour culturel. La culture occidentale s’imposa rapidement aux cultures autochtones, sur l’ensemble du continent. Le commerce triangulaire a ensuite renforcé ce brassage de cultures pendant plus de quatre siècles. Après la lente abolition de l’esclavage, les propriétaires terriens de la Caraïbe cherchaient une main d’œuvre de substitution. Ce fut vers l’Asie du Sud-Est (Inde, Sri-Lanka) qu’ils se tournèrent. Les Antilles devinrent la première région mondiale à réunir les cultures des cinq continents. Ce métissage culturel résulte de souffrances séculaires.
Une littérature des luttes
La littérature antillaise se caractérise par ses revendications. Elle cristallise de nombreuses luttes, notamment égalitaires. Dans le Discours sur le colonialisme, prononcé en 1950, l'écrivain montrait comment le système colonial étouffait tous les territoires dominés. L’auteur décrivait ces colonies comme réduites à de vulgaires outils de production. Il déplorait également les inégalités qu’il générait dans ces territoires. Un racisme latent (ou non) était durablement instauré ; la devise républicaine difficilement vérifiée. Ces considérations furent approfondies par Frantz Fanon dans son ouvrage Peau noire, masques blancs. Il dénonçait les conséquences sociologiques du système colonial. Celles-ci, profondément ancrées dans nos structures mentales, nous mettaient (schématiquement) dans la position du dominant, ou du dominé. La couleur de peau structurait ces complexes de supériorité, ou d’infériorité. En 1958, Édouard Glissant écrivait La Lézarde. Ce roman obtenait le prix Renaudot la même année. Cet ouvrage réunit poétiquement les différentes luttes de la société antillaise des années 1950. En effet, l’emprise coloniale était encore marquée et empêchait toute forme d’émancipation. Le style exubérant de Glissant montrait également les potentialités de la langue française. Elle s’enrichissait de voies nouvelles jusqu’alors décriées.
Concentrant des luttes, ces écrits engagés témoignent des inégalités du monde. La colonisation et son influence sur les mentalités est encore perceptible aujourd'hui. Il en est de même pour les questions économiques et sociales. À l’échelle de la France, les territoires d’outre-mer sont les plus pauvres du pays. Ces îles sont encore trop souvent sous la “perfusion” de la métropole et vivent en décalage profond avec Paris. Cette incompréhension mutuelle rassemble aujourd’hui de nombreuses contestations. Celles-ci s’opposent souvent aux décisions imposées par le gouvernement, car jugées en décalage avec la réalité. Les importantes émeutes guadeloupéenne et martiniquaises des dernières semaines sont révélatrices de ces tensions. Des alternatives existent cependant. Proposées localement, elles sont conscientes des réalités dans lesquelles ces îles s’inscrivent.
Des territoires ignorés
Les territoires d’outre-mer souffrent d’un manque d’écoute et de considération de la part de la France métropolitaine et de l’Union Européenne. D’importantes aides sont apportées et souvent justifiées par l’État pour montrer que ces territoires ne sont pas des départements oubliés, mis sous silence. C’est en revanche un manque de compréhension qui est décrié par les habitants des territoires ultra-marins. Cette absence de valorisation s’illustre particulièrement dans le domaine culturel, dont l'éducation. L’enseignement de la littérature et de la philosophie est exclusivement centré sur la pensée de l'hexagone. C’est toute une partie de notre culture partagée qui est trop ignorée. La culture antillaise doit être reconsidérée. Les différents aspects de notre culture humaine ne doivent pas se construire en opposition les uns des autres. C’est par leur complémentarité que notre culture s’enrichit.
Une culture à comprendre
Pourtant, les grand.e.s écrivain.e.s antillais.e.s d’hier et d’aujourd’hui souffrent de sous-représentation. Dans nos formations littéraires débutant au collège, ces auteur.e.s sont à peine mentionnés dans nos programmes scolaires. Leurs études se développent à peine au lycée et sont épisodiques dans les études universitaires. Césaire est plus étudié en Allemagne qu’en Martinique. Trop de français.e.s ignorent ces écrits de tolérance et d'espoir. La notion de métissage culturel, définie par Édouard Glissant dans ces écrits, mériterait d’être étudiée dans la période de repli identitaire que nous traversons.
Tout-Monde et créolité
Sortir de ces schèmes réducteurs implique d’apprendre à se connaître. Pour ce faire, notre connaissance individuelle doit se détacher de toute influence inculquée. Le philosophe et poète Édouard Glissant définissait alors la notion de métissage culturel dans le Traité du Tout-Monde et le Traité de la Relation. Chaque individu est culturellement unique et concentre en lui un multiplicité d’influences culturelles. Il ne se réduit pas à une simple définition en fonction de son lieu de vie et de son entourage. Chacun peut être, en son lieu, au contact du monde. La philosophie glissantienne est alors un appel à la tolérance mondiale, de l’humanité à l’individu. Ce courant philosophique est une des émanations de la littérature antillaise qui est aujourd’hui incarnée par Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et feu Jean Bernabé. Ces trois auteurs étaient les fondateurs du mouvement littéraire de la créolité. Ce courant vise à défendre et valoriser la culture créole.
Actifs aux quatre coins du monde, les auteurs caribéens sont réunis chaque année par le Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde, organisé par l’Institut Tout-Monde. Ce dernier, dirigé par Sylvie Glissant, participe activement à la valorisation de ces artistes et de leurs pensées, si essentielles. Loran Kristian, auteur du recueil Les mots de silence, est le lauréat du Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde 2021. Nous avons pu nous entretenir avec lui.

Agrandissement : Illustration 1

Entretien
Vincent Mathiot : Cette première question peut vous paraître banale, mais pouvez-vous nous décrire les émotions qui vont ont traversées en apprenant votre nomination comme lauréat du Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-monde ?
Loran Kristian : J’ai pour habitude de me tenir en rupture de ban ou d’arrière-ban, donc j’accueille avec attention ce qui peut sembler banal. Figurez-vous un homme, un soir, portant des cartons remplis d’objets pour un déménagement entre deux habitations. Un homme en pleine activité entre le plafond de son monde domestique, une lune quasi-pleine et la musique de la nuit antillaise. Un type qui au détour d’une pause, découvre un nombre anormalement élevé d’appel de son éditeur sur son téléphone et qui, entendant les messages sibyllins de celui-ci et de la directrice de l’Institut du Tout-Monde évoquant une grande nouvelle, une disponibilité pour partir à Paris rapidement, et caetera et caetera, croit comprendre ce qui se trame, sent ses forces l’abandonner, une faille s’ouvrir dans l’espace et le temps, et au milieu, surgir la lave brûlante d’une joie inconnue. Tout ça pour vous dire que cette annonce fut un voyage formidable, c’est-à-dire un superbe moment entre l’effroi, la surprise, l’impensable et le bonheur. J’ai compris l’honneur qui m’était fait, compte tenu du profond respect que j’éprouve pour la trentaine d’auteurs récipiendaires de ce prix, hommes et femmes du Tout-Monde que je regarde comme un nouveau-né observe les soignants qui l’ont guidé vers la lumière, avec une vision un peu floue, entre en noir et blanc.
V.M. : L’écriture est une expérience unique, singulière. Tout.e écrivain.e a un rapport particulier à sa plume. Quel est votre procédé d’écriture ? Écrivez-vous pour une idée, un but précis ; ou vous laissez-vous emparer par ces derniers ?
L.K. : Je suis parfois traversé par une nécessité, tantôt happé par une pulsion, ou alors chevauché par un thème, un événement, un sujet particulier qui me commande d’écrire ou de transcrire dans un flux, canalisé ou pas. Je suis à d’autres moments astreint par le besoin de dire ou décrire une expérience imaginaire du monde. Je forme sa réalité par le biais d’une écriture qui permet de mieux me situer, mieux voir l’entour et l’en soi, et puis tenter de flamber quelque images trop vives, quelques silences trop lourds. L’écriture est probablement, une expérience unique. Sans cet acte effectué, il n’y aurait autour de moi qu’un réseau discursif carcéral, fait de dispositifs de maîtrise, d’aliénation et de contrôle de l’esprit-corps. L’écriture est une machine de contention des imaginaires et des libertés que seul la création d’un langage interstitiel, un langage qui se tient dans la lézarde (méandres NDLR) d’une existence gouvernée, peut à mon avis détourner et dérégler, pour mieux se déprendre et déferler en tant qu’homme.
V.M. : Votre œuvre, Les mots de silence, récemment récompensée, est un recueil poétique. La poésie est une façon “d’habiter le monde”, de le saisir en s’écartant des prismes carcéraux de nos quotidiens respectifs. Pour reprendre vos mots prononcés au Palais de Tokyo, la poésie permet-elle de “transformer les silences en eau de vie” ?
L.K. : La poésie est un espace-temps hors du temps et de l’espace qui, heureusement, n’a plus rien à prouver. Je la compte comme à la limite de la connaissance ultime, celle qui ne se fige ni en science rationnelle, ni en expérience sensorielle. Je la tiens plutôt pour une possibilité de faire naître quelque chose de toujours neuf, à la jonction des éléments transversels ou transversaux de notre finitude humaine et de l’infini du divers. Une sorte d’asymptote cosmopoétique. La poésie est l’élément qui compose la matière noire de l’univers. Celui capable de dépasser la vitesse de la lumière. Ce sont, je l’admets, des prétentions grandiloquentes pour un exercice déchirant qui est surtout d’humilité et de quête de vérité. Le poète a la tête plongée dans un nuage insaisissable de mots qui toujours lui échappent, et que toujours, ils tentent de recomposer. Alors oui, la poésie, c’est aussi tenter de transformer les silences des mots ou des choses en eau de vie. En distillant des lignes et des entrelignes avec un chaos, avec tous les chaos traversant, les siens, les autres, les amoncellements, les éboulis individuels et collectifs, etc. Et puis c’est aussi tenter la surrection de l’émerveillement, dans l’espoir de produire une ou deux grandes révoltes de liberté, dans un monde gorgé de servilité et d’injustice constituantes.
V.M. : De ce fait, écrire, est-ce s’éloigner d’un destin commun ?
L.K. : Se mentir à soi-même, c’est s’éloigner d’un destin commun.
V.M. : Il semble alors essentiel de réveiller le conteur qui dort en nous pour (re)découvrir notre individualité ?
L.K. : Redécouvrir notre individualité, oui ! Étant entendu qu’il n’y a pas d’individualité, comme nous l’entendons généralement. L’origine du mot individu se trouve dans l’indivisible et l’indivision. Nous sommes, depuis la sortie d’un ventre matriciel et la première main tendue, tissés de motifs arachnéens qui nous lient au monde et aux autres, dans une traversée des temps et des espaces faite d’inconnu, d’imprévu et d’imprédictible. Nous avons le conflit et la guerre comme porte-drapeaux, certes, mais si vous évoquez la figure du conteur, rappelez-vous qu’elle est aussi cette toile arachnéenne. Cette toile tissée dans le calme de la nuit, la toile de nos lieux communs, de nos assemblées, et qui en fait un ciel étoilé ou un lieu de résistance active. Le ciel et le combat de lumières emplies par la mémoire et l’expansion de l’uni vers, comme du dit vers…
V.M. : Votre recueil, Les mots de silence, a été réalisé en étroite collaboration avec le plasticien Ricardo Ozier-Lafontaine. Quelles relations votre œuvre entretient-elle avec l’univers de cet artiste ?
L.K. : Ce sont des œuvres intriquées poétiquement, qui tracent des lignes qui s'évaporent, ou qui tentent de s’échapper par évasion des limites, par franchissement des frontières. C’est une prière de nègres, c’est-à-dire un hommage du difficile et de la blesse à la danse, au rythme, à la percussion, à la déviation, à la drive, à la création et aux flux libres. Tout cela en tissant au présent, un amas de lignes, de corps et d’esprits qui tentent d’abattre le Capital et le Colonial, responsables de l’extinction en devenir. C’est une Relation fraternelle et de sensibilités communes… C’est une Relation aux esprits du lieu que nous partageons, celui au centre d’un arc insulaire, petite île « remplie du bruit de l’univers ». Ce lieu qui a enregistré l’histoire comme la poétique volcanique la plus compète des « Petites Antilles », et que nous honorons et respectons tous les deux, par amour des vivants et des morts…
V.M. : Écrire, composer, réaliser une œuvre d’art est une question d’influences. Vous évoquez une “tribu poétique de la relation”, un totem que vous remerciez en décembre 2021. Vous inscrivez-vous dans la trace d’autres écrivain.e.s ? Ce 31e Prix Carbet, est-ce pour vous un flambeau ?
L.K. : En effet, je l’ai avoué lors de la remise du Prix Carbet : mon totem, mon CéFaGliChaCoMon, est un socle ancestral. C’est de là que je parle et que vient mon écriture. Césaire, Fanon, Glissant, Chamoiseau, Confiant, et Monchoachi sont les fabricants d’armes miraculeuses qui ont manufacturés mon devenir. Ils m’ont ramené avec assurance aux langues et aux lieux du monde depuis lequel j’écris. Ils m’ont permis, comme d’autres évidemment, de considérer que j’étais issu d’un continuum littéraire et marron. Que depuis les « soubresauts et les sursauts » dont parlait Edouard Glissant.
Ma littérature a transbordée sa poétique du discontinu vers l’accumulation, et qu’une région littéraire du monde comme celle des Antilles, actuellement, peut se réclamer de la Trace. Non pas une Trace aux racines ataviques et atrophiantes, mais une Trace qui ancre notre multiplicité dans l’argile et la blesse des rivières de chez nous. C’est-à-dire qui libère la création, en final de compte. Qui tisse sa relation avec l’intime et les aspirations scripturales personnelles. C’est la tribu poétique de la relation dont je parlais. Celle qui a patiemment déplié les horizons et les possibles pour nos peuples, en creusant la terre-mer, celle qui nous a redonné la vue. Je porte aussi ce combat-là : le combat contre l’asservissement, la déshumanisation, l’exploitation, l’aliénation, le mensonge d’Etat, le mépris national, la capture des initiatives et des énergies libertaires. Mais je le porte comme engagement dans un espace de liberté créatrice singulière, avec une poétique existentielle. Je porte ce flambeau-là, oui ! Depuis, au bas mot, 387 années maintenant !
V.M. : Selon vous, la littérature antillaise et du Tout-Monde mérite-t-elle plus de lumière ? Par la lumière nous ne parlons pas seulement de la lumière médiatique, nous pensons également à la lumière scolaire et universitaire.
L.K. : Sur un plan « central » ou « centré » hexagonalement, je dirai que nous naviguons toujours entre mépris, condescendance et hypocrisie. Nous continuons notre Chemin de confettis d’empire et de poussières d’îles infantilisées. Le tableau général français est rempli d’archaïsmes et d’exotismes de première classe sur ce plan. Souvenez-vous, par exemple, du ministre François Bayrou faisant introduire Aimé Césaire au programme en 1994, et le tollé qui s’en suivit à l’Assemblée nationale, dans le monde enseignant et celui des parents d’élèves. Césaire l’homme qui comparait colonialisme et nazisme, Césaire et sa syntaxe difficile, Césaire et ses références culturelles inacessibles aux élèves de France… que n’a-t-on pas entendu, si bien qu’il fut retiré des programmes en 1998 par décret ministériel.
De l’eau a coulé sous les ponts depuis. Mais le tableau général français est rempli d’absences, de ratures et de blanc, dès qu’il est question d’aborder le sujet des « lumières » et de la littérature produite dans cette région insulaire du monde. Il y a des arbres cachant la forêt ou le panthéon, mais la réalité est bien celle-là : en l'occurrence, pendant que l’extrême droite se décomplexe, l’Etat et l’Université française, à grand coup de colloque, se déclarent officiellement européocentrés, contre la déconstruction, le décolonialisme et la décolonisation en somme. Dans ce contexte, trouver aujourd’hui une mention du Prix Carbet 2021 dans un média hexagonal de référence relève effectivement de l’abstraction ou de l’impossible. Nous demeurons généralement dans la zone de la « petite littérature », de la « littérature mineure », « périphérique », comme tout notre corps social et politique d’ailleurs. Sur un plan qui multiplie les centres à l’infini, la littérature de création antillaise, comme les peuples ou les individus, elle, s’en fiche ! Elle est son « propre fondement », et lève ses propres plants. Qu’elle soit département de la Littérature française, francophone ou Littérature Antillaise, elle est Littérature souveraine…point. Le constat est juste lucide et clair : le monde scolaire français n’étudiera pas de si tôt les poètes, dramaturges ou romanciers caribéens dès le primaire ou le collège. Le lycée ouvre de timides fenêtres vers les « espaces francophones ».
Quant au monde universitaire, s’il est plus à l’écoute de cette région de la littérature, il la cantonne dans des chaires spécifiques ou des territoires particuliers. Heureusement, le monde ne se réduit ni à la France, ni à l’Europe. Rappelons nous que plusieurs universités dans le monde ont aussi des départements d’études consacrés à cette littérature, en particulier aux USA.
V.M. : Intéressons-nous à la Caraïbe. Dans la littérature antillaise, les lieux sont évocateurs de mémoires, de symboles. Ils donnent vie à des noms d'ouvrages comme La Lézarde (rivière martiniquaise NDLR) d’Édouard Glissant, ce même écrivain et poète qui plaçait la mangrove au cœur de son procédé scriptural. Césaire est souvent décrit comme un poète péléen. Et vous, quel est votre rapport au Lieu (de vie)? Concentre-t-il à sa façon ses imaginaires, ses stigmates, ses espoirs ?
L.K. : Les lieux sont évocateurs de mémoires et de symboles dans la Littérature, de manière consubstantielle, il me semble. Le rapport au Lieux qui me rapproche d’Aimé Césaire ou d’Edouard Glissant, c’est un paysage ou une matrice faite de champs de mort. Ce sont des plaines, des mornes, des sources, des lits et des embouchures de rivières chargés de plantations criminelles. Ce sont des savanes pétrifiées, des mangroves et des mers polluées par la grande épuration du Capital et le grand asservissement Colonial. C’est une nécropoétique du vivant et une poétique du dépassement. C’est une manière si efficace et scientifique, si magique, si zombifiante de faire prendre l’eau de moussache pour du lait, le poison pour de l’eau de vie, le fruit de la mort pour une source de richesse, et puis de vider la terre comme ses vivants de tout pouvoir de recomposition, de surrection ou de libération.
Voilà mon lieu de con-naissance mémorielle, symbolique et scripturale… La nuée ardente, la mangrove, l’en-ville, le morne ou encore la rivière me traversent de part en part, tout comme le froid, la neige, le fleuve ou les horizons sans mer qui furent mes visions natales. Je me situe en elles, sans fixité, tout autant qu’elles m’habitent.
Un regard à changer
Notre conception de la culture antillaise doit changer. Elle mérite d’être considérée avec admiration. Elle est unique et nous apprend que la richesse humaine est infinie. Nos consciences doivent converger. Nos regards davantage se croiser. Le partage de cette culture doit quitter son statut officieux. Est-ce volontaire de la part de nos dirigeants, ou est-ce le fruit de notre ignorance ? Concevons-nous encore inconsciemment ces territoires comme des territoires à exploiter ?
Ces questions, nous devons nous les poser afin d’agir plus consciemment. Une chose est certaine, nous avons collectivement beaucoup à apprendre de ces îles et territoires d’outre-mer. Cette connaissance débute à l’école. Pour comprendre le monde de demain, nous devons
connaître ces territoires aux carrefours du monde.
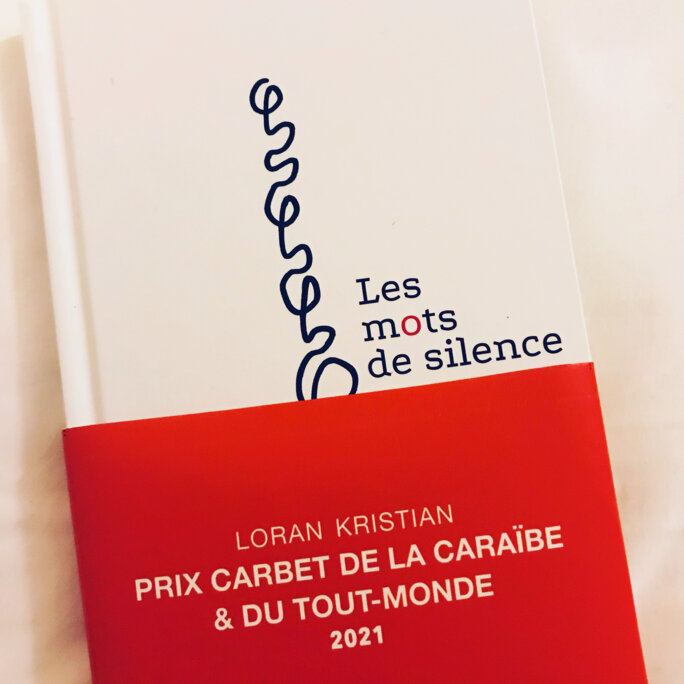
Agrandissement : Illustration 3