La pensée comme puissance du questionnement (Page 251-254)
Strauss et Arednt partagent partagent un constat : la reconnaissance de l'expérience dans sa diversité implique la contradiction.
La réponse de Strauss est qu'il faut s'écarter de l'expérience, qui, à l'exception de l'expérience naturelle du sens commun et de son prolongement philosophique, n'est jamais qu'historique.
La réponse d'Arendt est à l'opposé : il ne faut pas considérer le principe de non-contradiction comme un principe absolu et n'en faire usage décisif que lorsque l'objet du discours y autorise.
Cela signifie-t-il qu'aux yeux d'Arendt l'expérience ait une valeur entant que telle ?
Il faudrait plutôt dire qu'elle exige toujours d'être pensée : non pas en elle-même et pour elle-même, mais par asa mise en rapport avec les autres expériences et avec les conditions fondamentales de l'existence.
De ce pint de vue, la conception straussienne du sens commun évite la tentation fabricatrice de la rationalité technique, mais elle comporte le danger d'un enfermement du sujet rationnel dans son propre système.
La garantie proposée par Strauss est celle d'une évidence partagée : celle de la tendance naturelle de la raison au jugement absolu, en vrai ou en faux, en bien ou en mal.
L'historicisme échoue sans doute dans l'élaboration d'un universel concret ; mais n'avons-nous pas affaire avec Strauss à un universel abstrait ?
En effet une définition de la nature humaine ne semble pas apte à prendre en compte, par le biais d'une opération de totalisation, la dimension collective de l'existence.
Avec Arendt, nous voyons que la pensée comme compréhension, contre la perte du sens commun et l'appétit imaginaire ou faussement rationnel de cohérence, est celle qui reçoit l'expérience dans sa contradiction ; le point de vue du monde ne peut être totalisant.
L'idéologie peut être appréhendée comme une manière d'imposer à la réalité humaine un principe de non-contradiction qui lui est étranger, jusqu'à vouloir transformer l'homme lui-même, et Strauss a raison de penser que o'n échappe à ce danger qu'en renonçant au désir de fabriquer du réel.
Mais plus rien de l'expérience ne pourra être pensé si l'homme se réfugie dans l'expérience d'une raison "pure" dont le monde est absent.
Quelle est la bonne attitude dès lors pour penser ce qui nous arrive ?
Contre l'objectivité réductrice des sciences sociales, Strauss juge essentiel de ne pas s'interdire de parler de cruauté à propos des camps de concentration : s'y refuser est un acte de "malhonnêteté intellectuelle".
S'abstenir de tout jugement moral ne permet pas d'adopter un regard juste sur les évènements de ce monde.
Une connaissance purement descriptive des choses politiques est impossible et y prétendre fait manquer leur nature même.
Il n'y a pas de neutralité éthique possible ; on ne peut pas dissocier la politique de la morale, sans introduire, par un processus d'abstraction, une scission entre deux dimensions que la perspective sur le Tout montre dans leur continuité.
Dans l'esprit de la philosophie classique, il est nécessaire de penser l'unité du bien : une telle unité n'implique pas une absence de distinction entre les domaines, mais elle interdit la scission.
C'est l'évidence et l'immédiateté du jugement moral dans le sens commun qui ouvrent la pensée du Tout.
S'interdire ici de parler de cruauté revient donc à faire taire notre capacité rationnelle la plus naturelle et la plus philosophique.
Le penseur doit laisser l'histoire et la sociologie à leur juste place : en luttant contre les illusions modernes qu'elles induisent et en leur conférant un rôle d'outils en vue d'atteindre la vraie connaissance.
Il existe pour Strauss une hiérarchie des modes de connaissance : la connaissance philosophique est la plus haute dans la mesure où elle prend pour objet les natures et les principes, et non pas les faits.
Une science descriptive qui n'est pas guidée par la philosophie, c'et à dire qui s'en tient aux "faits", empêche tout processus de reconnaissance.
Seule une connaissance définitive et antihistorique aurait permis de reconnaître, dans l'avènement d'une tyrannie.
La reconnaissance n'est possible qu'à partir d'une connaissance authentique : si certains penseurs ont pu se laisser se laisser prendre au piège, c'est parce que la notion de tyrannie avait été oubliée, obscurcie par les voiles de la tradition, rangée au nombre des concepts techniques explicables par leur contexte d'émergence.
Autrement dit, si l'on se tourne vers l'origine de a philosophie, on prend conscience que les grandes notions auxquelles elle adonné naissance sont aptes à nous faire saisir la nature même des expériences, c'est-à-dire leur essence.
Seul un retour doit donc permettre de en pas être aveuglé par la nouveauté des expériences, qui n'est au fond jamais qu'une nouveauté .
Pour Arendt non plus l'objectivité scientifique n'est pas apte à appréhender le domaine des affaires humaines.
Adopter sur les activités humaines le point de vue de la science revients à considérer l'homme comme un élément parmi d'autres de l'univers, dont le comportement pourrait être expliqué par les lois nécessaires, autrement dit à manquer le caractère relationnel du sens.
La règle de la pensée n'est donc pas l'objectivité, mais plutôt la phénoménalité.
C'est pourquoi, si, au lendemain de la défaite de l'Allemagne nazie, il n'est pas encore temps d'appréhender les faits sine ira et studio, le processus de compréhension peut néanmoins débuter.
Comprendre l'évènement comme tel, c'est à dire comme évènement politique, en tant qu'il concerne tous les hommes, implique précisément de en pas espérer avoir une connaissance "objective".
Penser l'évènement suppose de penser en même temps le rapport des hommes avec cet évènement.
Il ne s'agit donc pas, comme chez Strauss, de fonder la connaissance sur le jugement moral, naturel et philosophique, mais plutôt de renoncer à lutter contre une certaine forme de sensibilité à l'évènement.
Comprendre suppose de ne pas abstraire en l'homme l'une des facultés au mépris des autres.
De même qu'un évènement par définition concerne tous les hommes, il serait faux de considérer qu'il ne touche en l'homme qu'une seule de ses dimensions.
Il faut donc faire droit, dans le processus même de compréhension, aux différentes dimensions de l'existence.
La compréhension, à la différence de la connaissance, autorise cette attitude.
L'important donc n'est pas d'établir une hiérarchie entre les modes de connaissance, pour que la raison remplisse le plus parfaitement possible son rôle, mais de n'écarter aucun moyen de comprendre.
C'est au même moment que peuvent se déployer les discours de l'historien et du spécialiste de sciences politiques, et le mouvement de la compréhension.
La condition impérative de la compréhension reste le respect des vérités de fait ; pour le reste, le processus est infini, toujours à poursuivre.
La liberté de le mettre en route provient de l'urgence : in ne serait pas humain d'attendre que l'on puisse en avoir la connaissance définitive.
Le mouvement de la pensée en effet n'importe pas seulement pour ses résultats.
L'impératif d'établir un savoir certain sur lequel s'appuyer pour être sûr de ne pas s'égarer est une préoccupation de penseur professionnel ou de philosophe - de celui dont l'activité correspond à l'expérience fondamentale de la philosophie.
La pensée a du sens par son mouvement même.
Elle doit accompagner l'évènement comme elle accompagne au demeurant l'action.
Il n'y a pas un seul moment pour la pensée - celui de la délibération -, qui précède l'action ; de même, il n'y a pas d'évènement, en soi, puis une démarche au terme de laquelle la raison, qui serait restée seule avec elle-même, donnerait sa vérité.
La compréhension n'est pas une affaire de professionnels, mais d'hommes : "elle commence avec la naissance et prend fin avec la mort."
A proprement parler, le phénomène totalitariste ne peut pas être reconnu dans sa nature, parce qu'il est nouveau.
Précisément, en tant qu'évènement il manifeste l'impuissance de nos catégories traditionnelles, et non pas, comme chez Strauss, l'impuissance de notre façon moderne de penser.
En revanche, sans doute ne pensons-nous pas suffisamment ce qui nous arrive.
Notre incapacité à identifier qui que ce soit de connu dans l'évènement totalitaire montre que la recherche philosophique de la vérité n'est pas apte à saisir la dimension d'évènement de l'évènement.
L'intemporalité de la vérité philosophique vient de ce qu'elle exprime bien davantage l'expérience de la philosophie que l'espéreince de la politique.
La reconnaissance n'aurait satisfait que les philosophes, et elle n'est de toute façons pas orientée au combat ; si la compréhension n'et pas soumise à l'action, elle montre cependant qu'il n'est pas besoin de connaître ou d'identifier une chose pour la combattre.
La seule reconnaissance dont il faut nous rendre capables est la reconnaissance de l'évènement en tant que tel, c'est à dire de l'obligation dans laquelle il nus place de ne plus satisfaire des réponses toutes faites.
C'est cette reconnaissance qu'empêche l aperspective strictement historique, qui ne voit dans la succession des évènements qu'une succession d'étapes, vers le mieux ou vers le pire.
Ce n'est pas la perte de notions communes, mais la vision totalisante de l'histoire qui, en concevant le cas échéant l'enfer comme la fin des temps et non pas comme un phénomène de ce monde, nous a rendus incapables de reconnaître le véritable enfer lorsqu'il se produit sous nos yeux.
Comprendre ne peut consister à recourir à des notions anciennes dont il faudrait réaffirmer la pertinence : ce processus doit conduire à l'inverse à envisager de nouveaux concepts, à condition qu'ils désignent une réalité d'expérience et non pas une abstraction.
En ce sens, l'"invention" du concept de totalitarisme établit pour la pensée la reconnaissance de l'évènement.
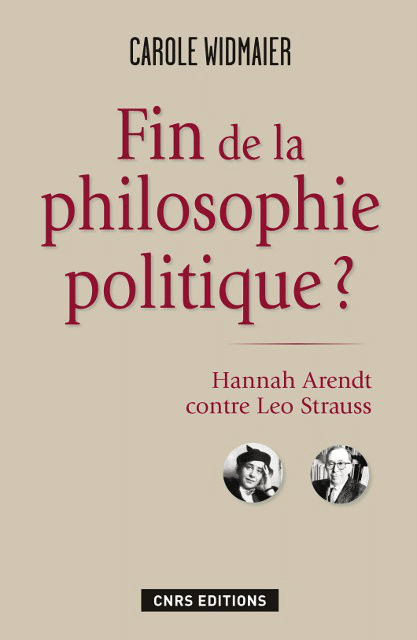
Fin de la philosophie politique ?
Hannah Arendt contre Leo Strauss
https://www.agoravox.tv/actualites/politique/article/eloge-des-valeurs-hannah-arendt-37212



