Pages 277-278
Dans sa critique du positivisme de Weber, Strauss dénonce tout particulièrement, comme nous l'avons vu, la définition de la liberté qu'il implique : liberté et dignité résideraient dans l'autodétermination, c'est à dire dans la détermination par le sujet de ses propres valeurs ou idéaux, indépendamment de la question de leur valeur.
La liberté ainsi conçue est aux yeux de Strauss une coquille vide que l'individu vient remplir comme il el désir et non pas comme le lui indique la raison.
Il s'agit donc d'une conception faible de la liberté de penser.
A cette conception faible Strauss veut opposer une conception forte, celle de la liberté philosophique de penser.
La véritable expérience de la liberté est donnée dans. la pratique philosophique.
Arendt ne s'intéresse pas avant tout à la liberté de penser, mais aux expériences politiques de la liberté ; c'est donc son attention première à la politique qui la conduit à envisager le rôle de la liberté de penser, mais celle-ci se trouve définie par l'usage public de la raison.
Ce n'est donc pas la nature des normes du jugement qui fait la part entre servitude et liberté : nous n'accédons à la liberté, qui ne peut être déterminée à partir de la nature humaine, qu'en entrant dans l'espace public des opinions.
Si Strauss et Arendt se retrouvent donc dans une critique de l'idée de société, c'est au fond pour des raisons différentes : Strauss refuse que telle société donnée confère ses n ormes à la raison ; Arendt voit dans le concept de société l'expression de l'indistinction entre les différentes activités et de l'inexistence d'un domaine proprement politique.
La liberté au sens de Strauss est donc essentiellement la liberté de penser au-delà des idéaux de la société, c'est -à-dire la liberté de maintenir l'écart entre la raison et el domaine politique.
La liberté selon Arendt tient à la possibilité pour l'homme d'avoir à l'égard du monde des rapports pluriels, c'est à dire de se manifester comme un "qui" dans le monde plutôt que d'exprimer, par son activité, son inscription dans une mécanique qui le dépasse.
L'homme pour Strauss ne peut être libre qu'en réalisant ce qui le définit en propre et qui est aussi ce qu'il possède de plus élevé.
La liberté selon Arendt réside dans l'accès aux modalités plurielles de son existence.
Quant à la liberté politique, elle est correspondance à la conditions de pluralité : elle ne peut exister qu'au milieu d'hommes au pluriel.
C'est pourquoi Arendt jugerait le concept sartrien d'intersubjectivité encore trop abstrait, dans la mesure où il s'accompagne d'une identification de l'individu à la liberté.
La liberté chez Sartre n'existe certes pas en dehors des actes et donc en dehors du monde, mais la notion d'engagement en fait encore une affaire personnelle : c'est la situation qui pousse à l'exercice de a liberté et de l'insertion dans le monde, mais cette liberté réside au fond dans ce qui se dit de l'individu devant l'humanité entière dans son abstraction.
Arendt montre au contraire que par ses actions et ses jugements l'homme n'existe pas seulement au sein d'un espace politique déjà donné, mais qu'il crée toujours en même temps cet espace.
La liberté sartrienne est encore morale et philosophique : elle est la manifestation d'un "je" et non pas d'un "qui".
Lorsque Arendt dit que la liberté politique est la révélation d'un "qui", cela signifie surtout qu'elle est le moment où le "je" se voit sous les traits d'un "nous" : autrement dit, elle en fait pas exister l'homme au sein de l'humanité, mais au sein de la communauté.
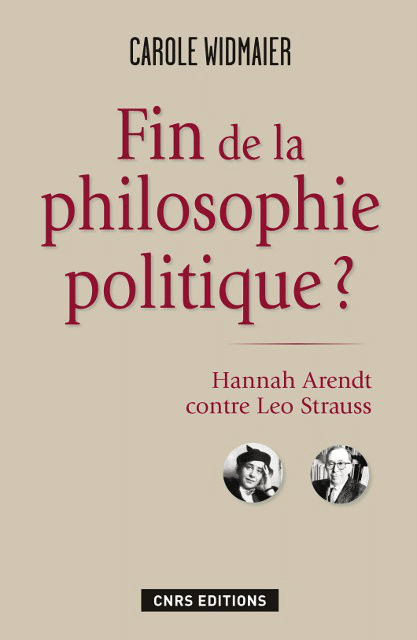
Fin de la philosophie politique ?
Hannah Arendt contre Leo Strauss
https://www.agoravox.tv/actualites/politique/article/eloge-des-valeurs-hannah-arendt-37212



