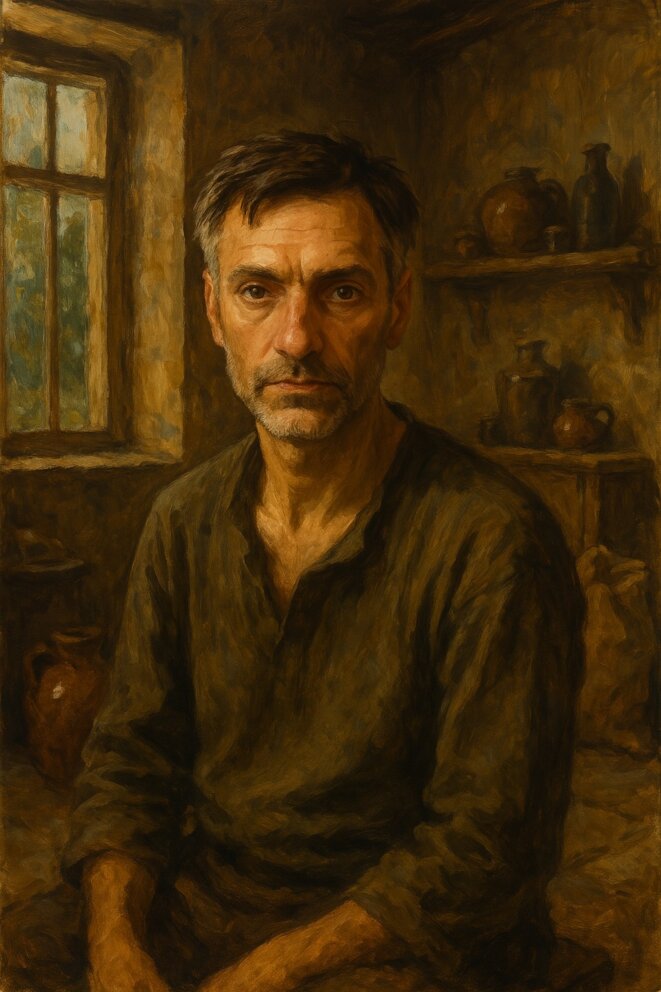Et en ce sens c'est l'affaire de toute la communauté des hommes.
Israël fonctionne comme une “réserve indienne inversée”: un espace à part, préservé, défensif et en extension agressive comme un cancer, destiné à garantir à un peuple un espace de survie, mais qui, ce faisant, le coupe du reste du monde et le prive du mouvement universel de mélange, d’interpénétration, de métissage. Sa survie est pathologique et met en danger le reste de l'humanité, le projet sioniste aussi légitime puisse-il avoir été dans son intention est une ânerie monumentale.
Comment ne pas penser à Frantz Fanon, à sa socio-thérapie (ou social therapy), qui regarde les pathologies collectives nées de l’histoire coloniale, des traumatismes, des aliénations psychiques. Fanon analysait comment le colonisé, dans son rapport avec le colonisateur, développe des troubles profonds d’identité, de désir, de projection vers l’avenir.
On peut dire qu’Israël, historiquement, est une création refuge, une réponse au traumatisme immense de l’extermination des Juifs d’Europe (Shoah), mais aussi des persécutions plus anciennes (pogroms, exclusions, diaspora forcée). Dans une grille fanonienne, cela peut être vu comme une tentative de reconstruction d’une liberté collective abîmée, mais qui reste hantée par le passé.
Là où ça devient intéressant (et délicat), c’est si soutien qu’Israël incarne une version pathologie de cette liberté :
c’est-à-dire une liberté construite non pas en ouverture à l’autre, mais contre l’autre. Fanon dénonce souvent le risque que le colonisé libéré se mure dans une reproduction des schémas de domination, parce que ses blessures ne sont pas guéries. Israël, dans ce cadre, pourrait être vu comme une société qui s’est enfermée dans un récit défensif, crispé, identitaire, pour éviter de se dissoudre dans le métissage ou la coexistence.
Une "tour substantialisée du passé"
Fanon parle de la nécessité de se désaliéner du passé, de ne pas être prisonnier de ses blessures, de ses mythes. Une société qui se « substantialise » dans son passé — c’est-à-dire qui fait de son passé une essence indépassable — risque de devenir incapable d’inventer une humanité nouvelle. Si Israël est structuré comme un projet de préservation pure, en opposition constante, cela peut effectivement bloquer la réconciliation.
Une coexistence séparée, sans rencontre réelle, sans mélange, sans reconnaissance mutuelle, est une paix fausse, fragile. Et de paix il n'en est évidemment récemment aucunement question, quand Israël entreprend un génocide.
Fanon dirait sans doute qu’une vraie guérison collective ne peut venir que d’une transcendance de l’histoire, où chacun accepte de se transformer au contact de l’autre. Ce n'est évidemment pas le projet de l'extrême droite messianique sioniste.
La disparition d'Israël : "Le grand pardon"
Fanon n’appelle pas à l’effacement des entités, mais à leur dépassement. Ce n’est pas tant la « disparition physique » de l’État d’Israël qui permettrait une réconciliation, mais peut-être la fin de sa logique identitaire exclusive, de son enfermement, de sa crispation. Une réconciliation véritable supposerait aussi que l’autre partie (les Palestiniens, les Arabes, les voisins) fassent également un travail d’ouverture.
Dans Fanon, le pardon n’est jamais passif, il est une reconstruction active.
Il suppose que les anciens adversaires cessent de se définir uniquement par leur blessure et par leur revanche. Si Israël, dans son architecture politique et symbolique, pouvait se réinventer, s’ouvrir, se désessentialiser, oui, quelque chose de nouveau pourrait naître. Mais cela demanderait aussi aux autres acteurs de renoncer à la pure logique de vengeance ou d’effacement.
Alors oui à un nouvel Etat, non juif.