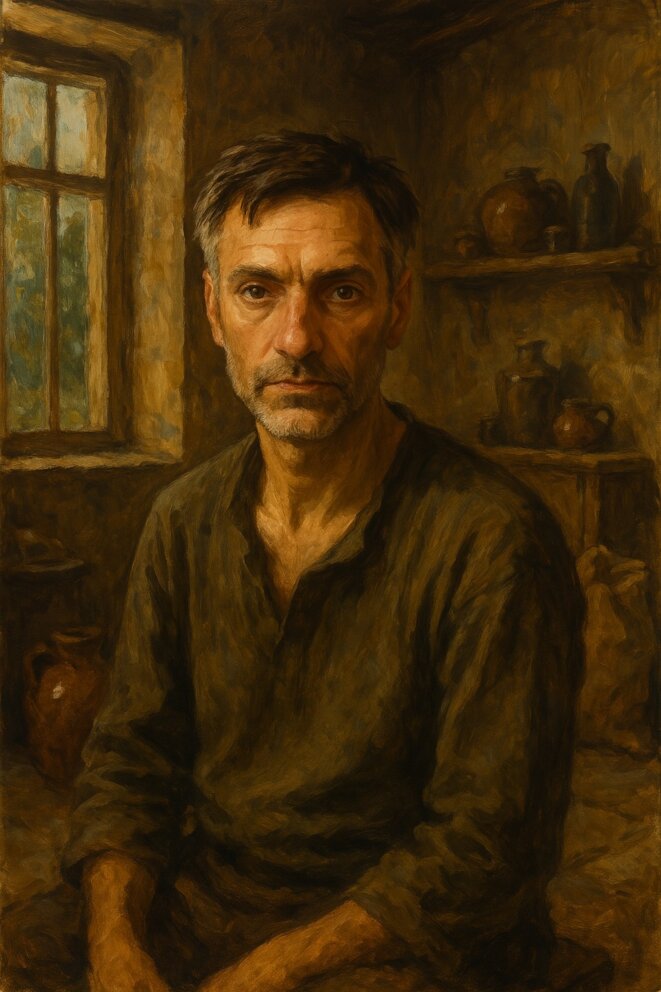L’affirmation selon laquelle « rien ne sera possible en France tant que la dépense publique augmentera plus vite que l’activité économique » repose sur une base réelle, mais biaisé et gagne à être replacée dans un cadre plus large, notamment en tenant compte des transformations structurelles de notre modèle économique et social.
Sur le plan strictement comptable, il est vrai qu’en France, depuis un moment, les dépenses publiques se sont épanouies plus rapidement que le produit intérieur brut (PIB), entraînant un alourdissement du ratio dépenses/PIB.
Une part importante de l’augmentation de la dépense publique ne provient pas seulement d’un excès arbitraire ou incontrôlé de l’État, mais résulte en réalité de la nécessité croissante de prendre en charge les coûts que le système économique dominant, souvent qualifié de néolibéral, tend à externaliser.
En d’autres termes, l’État intervient de plus en plus pour réparer ou compenser la casse d’un modèle qui privatise les profits tout en socialisant les pertes. (Les externalités négatives du capitalisme)
Prenons l’exemple de l’agriculture industrielle chère à la FNSEA : Intrants chimiques financés par des groupes privés, dégradation des sols et pollution des nappes phréatiques, maladies chroniques liées à l’alimentation, perte d’emplois paysans au profit de filières industrielles...
Du coup, l’État doit soutenir les agriculteurs ruinés, payer le traitement de l’eau potable, assurer les soins de santé et subventionner des filières de reconversion...
La saloperie de loi Duplomb ne fera que plomber davantage les finances publiques.
Et les exemples ne manquent pas au sein des soit disant "réussites françaises" que l'on décore avec des médailles en chocolat...
Ainsi, la montée en puissance de la pollution, de la dégradation des ressources naturelles, des maladies chroniques liées à des modes de vie pathogènes ou encore de la précarisation de l’emploi n’est pas sans lien avec les stratégies d’optimisation à court terme des entreprises, souvent poussées par la logique concurrentielle mondiale que kiffe Bielderberg. Ces stratégies ont des conséquences sociales et environnementales lourdes, qui se traduisent par une augmentation des dépenses publiques. L’État finance la dépollution des sols, la santé publique confrontée à la croissance des pathologies chroniques, l’indemnisation du chômage de masse ou encore les aides à la reconversion dans des territoires sinistrés par les délocalisations ou les fermetures d’usines.
Du coup, dire comme le petit bonhomme Ecalle dans le figaro que la dépense publique est la cause du mal, c'est fichtrement discutable, et plutôt le symptôme d’un système économique qui transfère ses coûts cachés à la collectivité.
Il devient alors injuste, voire idéologique, de présenter la dépense publique comme un simple obstacle à la prospérité nationale. Elle est aussi un indicateur du rôle réparateur et stabilisateur de l’État (de moins en moins) dans un contexte où les mécanismes du marché, laissés à eux-mêmes, génèrent des déséquilibres majeurs. Cet Etat qu'on veut massacrer à la tronçonneuse...
Par ailleurs, comparer la croissance de la dépense publique à celle du PIB suppose que ce dernier soit un bon reflet de l'activité économique réelle. Or le PIB ne prend pas en compte la qualité de la croissance ou la soutenabilité de la production.
Tant que l’on ne remettra pas en cause le modèle qui engendre ces externalités négatives la dépense publique continuera mécaniquement à augmenter, non pas à cause d’un excès d’État, mais parce que ce dernier reste la seule instance capable d’amortir les chocs et de garantir un minimum de cohésion.
C'est pourquoi je répète : si ça continue faudra qu' ça cesse !