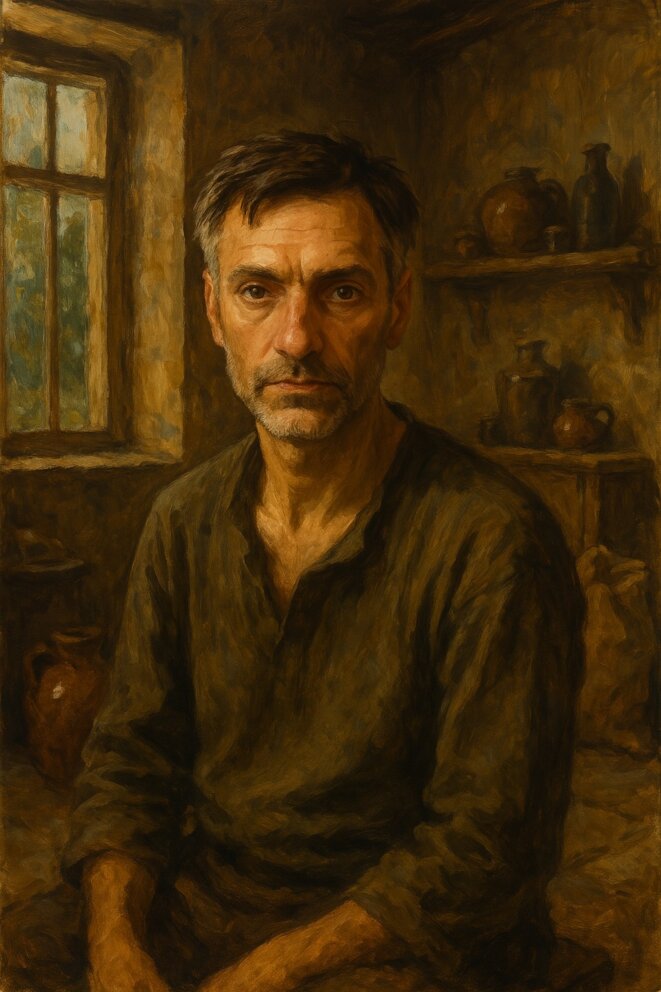La jaunisse de la betterave, transmise par des pucerons, a fait la une en France lorsque le gouvernement a voulu réintroduire les néonicotinoïdes pour sauver la filière sucrière [2]. La cercosporiose, champignon qui ravage les plantations de bananes notamment en Martinique, entraîne à chaque flambée un recours accru aux fongicides, avec des conséquences écologiques et sanitaires majeures [3]. L'agriculteur va même jusqu'à comparer ce champignon à un "cancer" de la banane, confirmant lui même notre intuition.
Ces maladies ne sont pas des accidents, loin de la. Elles sont la conséquence logique d’un système fondé sur la monoculture : une seule espèce, cultivée à grande échelle, sans diversité génétique ni rotation des cultures, crée un environnement idéal pour les épidémies. Pour maintenir cette agriculture artificielle en vie, on injecte des intrants chimiques toujours plus puissants [4]. En Martinique, c'est la Cavendish qui est produite en monoculture.
La santé mentale en Occident : les symptômes d’une monoculture de l’esprit
Le parallèle est frappant avec la santé mentale dans les sociétés occidentales. Burn-out, anxiété chronique, dépression, troubles du comportement : ces pathologies explosent dans des environnements marqués par la compétition, la perte de sens, l’individualisme et l’accélération permanente [5].
Comme en agriculture, ce sont les symptômes d’un appauvrissement structurel.
Des humains aliénés, des cultures uniformisées, des liens sociaux déstructurés. Une seule logique de développement : productiviste, compétitive, financiarisée. Recours massif aux béquilles chimiques pour survivre : antidépresseurs, anxiolytiques, stimulants, somnifères... Du coup, ...empoisonnement progressif des corps et des psychés...
Vulnérabilité extrême aux crises (burn-out, suicides, addictions, polarisation politique, etc.)
Le modèle unique de réussite, fondé sur la performance économique et l’autonomie individualiste, agit comme une monoculture de l’esprit. Il élimine les diversités de récits, de temporalités, de valeurs, d’attaches communautaires. Il produit une humanité déracinée, coupée de ses liens, réduite à son efficacité marchande [6]. Les psychotropes deviennent alors les "intrants chimiques" nécessaires pour tenir, à l’image des pesticides dans les champs [7].
Intrants chimiques : illusions curatives dans un système toxique
Dans les deux cas, les intrants — pesticides et psychotropes, antibiotiques ou chimiothérapies médecine occidentale — ne soignent pas les causes profondes juste les symptomes annoncés. Ils masquent ces symptômes et permettent de prolonger artificiellement un modèle insoutenable.
Leur usage crée une dépendance : les sols comme les corps deviennent réfractaires à toute résilience [8]. (Moulier-Boutang décrit un système où la production de valeur repose de plus en plus sur l’intelligence, la créativité, la subjectivité, la communication — bref, sur le cerveau humain comme force productive.)
Plus grave : ces traitements empoisonnent à long terme les milieux. Les nappes phréatiques sont contaminées, la biodiversité s’effondre, la santé humaine se dégrade [9]. De même, les médicaments psychiatriques ou les antidouleurs chroniques altèrent les équilibres internes, déconnectent du ressenti, engendrent des effets secondaires et parfois des dépendances [10]. Ces molécules se retrouvent également dans l'eau de notre robinet.
Ce qui vaut pour l’agriculture vaut pour nos sociétés malades et fragiles.
Sortir de la monoculture implique de restaurer la diversité : des variétés végétales dans les champs, des récits de vie dans les sociétés, des formes de soin adaptées à chaque contexte humain. Il faut retrouver une écologie de la relation : au sol, à soi, aux autres [11].
L’agroécologie propose d’écouter les sols, de travailler avec le vivant [12]. La médecine intégrative propose de soigner l’être entier, en lien avec son milieu [13]. L’économie sociale et solidaire cherche à redonner sens et justice aux activités humaines. Ensemble, ces alternatives dessinent une civilisation post-monoculturelle, plus résiliente, plus juste, plus vivante [14]. Nom de Diou!
[1] Shiva, Vandana. La guerre des graines, Actes Sud, 2014. [2] Ministère de l'Agriculture, "Plan d'urgence betteraves", 2020. [3] CIRAD, "Cercosporiose noire : enjeux pour les bananeraies tropicales", 2021. [4] Altieri, Miguel. Agroécologie : les bases scientifiques de l’agriculture durable, 2003. [5] Ehrenberg, Alain. La fatigue d’être soi, Odile Jacob, 1998. [6] Rosa, Hartmut. Accélération, La Découverte, 2010. [7] Illich, Ivan. Némésis médicale, Seuil, 1975. [8] Boutang, Yann Moulier. Le capitalisme cognitif, Amsterdam, 2007. [9] WWF, "Rapport Planète Vivante", 2022. [10] Whitaker, Robert. Anatomy of an Epidemic, Crown Publishing, 2010. [11] Morin, Edgar. Fayard, 2011. [12] Mollison, Bill. Permaculture: A Designers’ Manual, 1988. [13] Huron, David. Médecine intégrative et société, 2017. [14] Latouche, Serge. Petit traité de la décroissance sereine, Mille et une nuits, 2007.

Agrandissement : Illustration 1