Une figure spectrale hante la fiction contemporaine : celle de Karl Marx.
….
Bon, non, pas vraiment, OK, faut pas exagérer.
Mais quand même, on peut signaler deux romans parus cette année et qui ont – entre autres – Marx comme personnage plus ou moins important. C’est pas tous les jours.
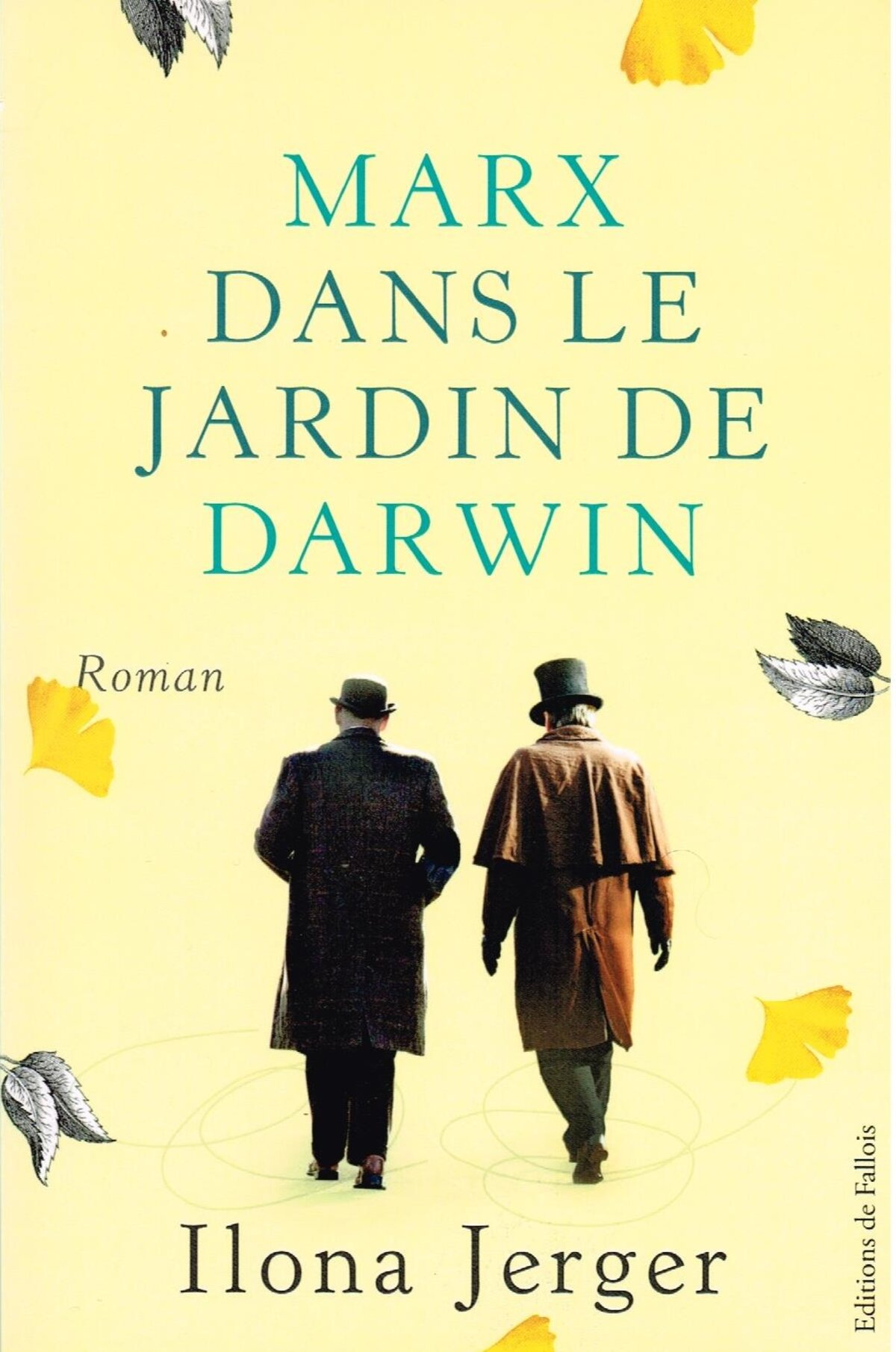
Agrandissement : Illustration 1

Le premier d’entre eux, Marx dans le jardin de Darwin[1], a des petits airs de fantasme absolu pour le rédacteur d’un blog intitulé La faucille et le labo . L’histoire d’une rencontre entre Marx et Darwin, pour vous donner une idée, c’est un peu comme si en Heroic Fantasy on s’amusait à imaginer un crossover qui mettrait en scène Conan le Cimérrien dans une histoire où il quitterait son univers de l’Age Hyborien pour aider Daenerys Targaryan à conquérir Westeros.
Le fantasme absolu, je vous dis.
Et donc, là, imaginons que Marx ait rencontré Darwin, ce qui est géographiquement et temporellement plausible, à défaut de l’être socialement et politiquement. L’idée de l’auteure, la militante écologiste allemande Ilona Jerger, est que Marx et Darwin auraient eu sur la fin de leur vie le même médecin…
Le livre a de nombreuses qualités qui le rendent tout à fait agréable à lire. La scène d’ouverture décrit avec empathie le désarroi de Darwin après que son laboratoire ait été saccagé par les fanatiques chrétiens vexés dans leurs croyances, ce qui évoque irrésistiblement la situation contemporaine dans un laboratoire de biotechnologies après un passage de Faucheurs Volontaires – bien que je ne suis pas sûr que ce soit ce que l’auteure ait voulu faire. L’ouvrage est globalement bien plus centré sur le personnage de Darwin que sur celui de Marx, sans doute parce que l’auteure, en fonction de son parcours personnel, maîtrise bien plus l’univers de l’un que de l’autre. Elle réussit par exemple très bien à décrire les expériences que mène Darwin et les questions qu’il se pose à travers elles. L’écriture a un petit côté « pince sans rire », et la distance sous forme d’empathie saupoudrée d’ironie qu’elle prend vis-à-vis de ses personnages fonctionne bien… quand elle reste légère. De nombreux passages sont tout à fait plaisants, voire charmeurs aux yeux du lecteur matérialiste, qui est satisfait de voir que le rationalisme en plein développement à l’époque, et qui unit les deux figures historiques du titre du roman, est une partie du décor intellectuel plutôt bien mise en valeur. En témoigne par exemple cette évocation des travaux d’un célèbre cousin du grand Charles :
« L’auteur, Sir Francis Galton, s’était imposé d’aller fouiller, sur près d’un siècle, dans les biographies des membres masculins de la famille royale britannique, afin de savoir si leurs nombreuses prières publiques avaient eu un effet. Résultat accablant : aucun effet. Dans la famille royale, on se faisait même moins vieux que le commun des mortels. S’agissant des églises, le tableau était analogue : elles étaient frappées par la foudre tout aussi souvent que les autres bâtiments. Le Dr Beckett ne pouvait s’empêcher d’arborer une mine triomphante quand il citait cet essai dans le cadre de l’hôpital. »
Le lecteur tiquera peut-être en constatant que le héros du livre, ce Docteur Beckett, est à la fois rationaliste et homéopathe. Mais attention à ne pas jeter un regard anachronique sur cette situation, qui est certainement tout à fait plausible à une époque à laquelle la science et l’homéopathie n’étaient pas encore aux antipodes l’une de l’autre.
En matière d’anachronismes, je me demande si le fait que le docteur incrimine la consommation du tabac comme cause de la bronchopathie de Marx en 1881 en est un[2], mais je suis sûr que c’est le cas en ce qui concerne la scène p. 22 au cours de laquelle Darwin mobilise dans ses pensées la notion de « patrimoine génétique » : le mot gène est assurément entré dans le vocabulaire scientifique très longtemps après la mort de Darwin en 1882, et les expériences de Mendel de 1865 qui pouvaient permettre de postuler leur existence n’avaient eu aucun retentissement, jusqu’à la « redécouverte » du phénomène en 1900.
Mais les faiblesses du livre, qui le rendent au final un peu décevant malgré son charme, sont en fait ailleurs. Pas tellement dans la documentation, qui est tout à fait solide, même si l’histoire de l’exemplaire dédicacé du Capital envoyé par Marx à Darwin est en fait apocryphe. Elles sont un peu dans certains tics d’écriture illogiques, comme ce choix de mettre parfois dans la bouche de Marx des mots en italique en anglais au milieu du français… au cours d’une conversation qui en fait devait se dérouler toute entière en anglais ! Mais surtout, alors que la préparation et la mise en place sont plutôt bien faits, on est très déçus du morceau de bravoure attendu, celui de la rencontre et du débat entre les deux héros. En effet, alors que l’on salive longtemps à la pensée de la lecture prochaine de cette discussion entre monstres sacrés du matérialisme, la scène fait complètement flop et vire même un peu au ridicule, du fait notamment de la représentation clownesque d‘un Marx vraiment grossier (dans tous les sens du terme).
Quel dommage !
Il semble ainsi bien difficile pour la romancière de peindre Marx de manière crédible, malgré son empathie pour la plupart de ses personnages, dont celui-là.
Que dire alors du traitement encore bien plus grossier qui est celui auquel se livre Sébastien Spitzer dans le second roman que je voudrais aborder : Le cœur battant du monde.[3] ?
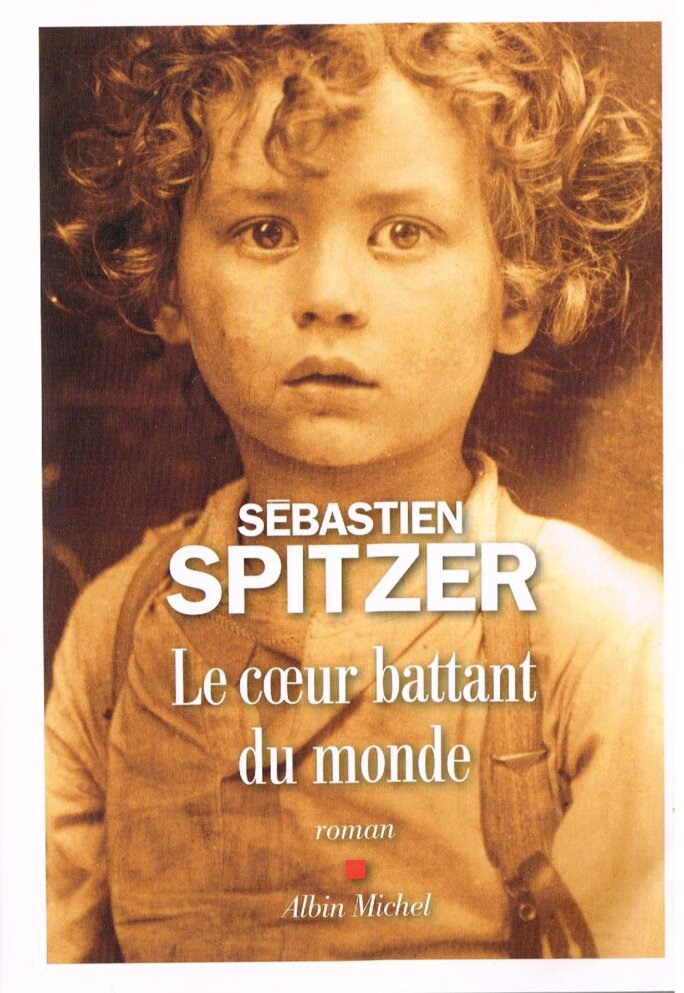
Agrandissement : Illustration 2
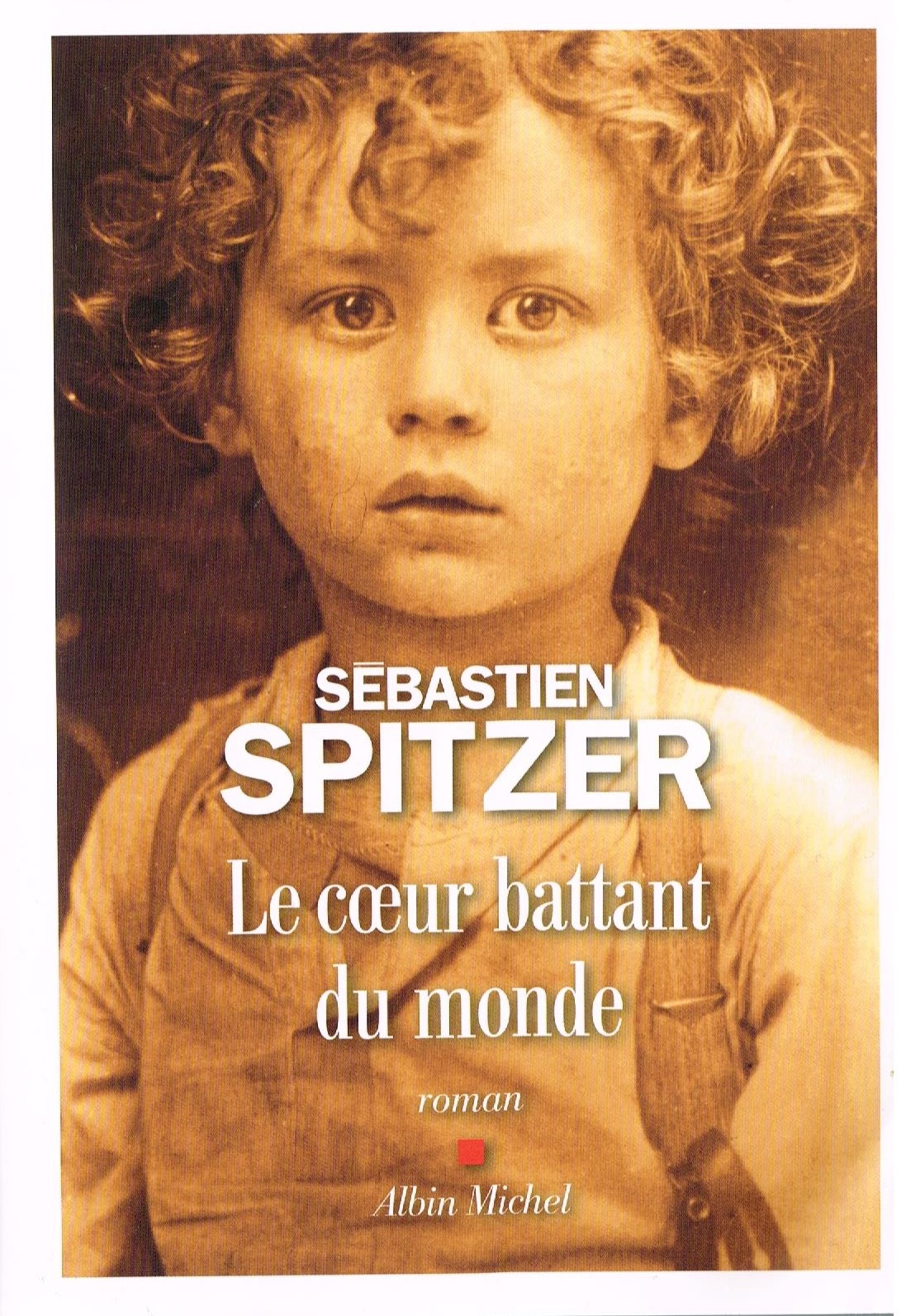
Ce roman se penche sur le cas d’un personnage historique lié à la famille Marx, puisqu’il s’agit de Freddy Demuth, le fils « naturel » d’Helen Demuth, qui était la femme de ménage de Karl Marx. Freddy est né de père officiellement inconnu, mais il est possible – et même certainement « probable », selon les points de vue – que Marx en soit le père biologique.
En abordant cet ouvrage consacré au destin de cet enfant, on pense d’abord se plonger dans un roman victorien « à la Dickens », comme le laissent supposer les premières pages, que l’on trouve plutôt bien écrites et a priori bien documentées. On croit alors plonger dans l’East End londonien de 1851 à la manière de l’autre grand Charles, mais on se rend progressivement compte que loin d’être dans Dickens, on est plutôt dans un soap opera british façon Eastenders ou Coronation Street, tant l’auteur multiplie les hypothèses improbables et tordues pour faire dans le dramatique et le pathos. Au point que, au lieu d'une histoire astucieuse qui s’amuse à combler avec l’imaginaire les interstices inconnues de l’Histoire connue, le roman se révèle rapidement être une réécriture balourde de toute cette Histoire, avec comme volonté manifeste de peindre ses héros les plus célèbres sous les jours les plus négatifs possibles. A la limite, on aurait pu adhérer à l’entreprise, si elle s’était présentée comme une sorte d’uchronie où le point de divergence aurait été la naissance de Freddy, fils de Marx, événement qui aurait complètement bouleversé les personnages au point de faire complètement dévier leur destin et leur psychologie. Sauf que, bien au contraire, l’auteur ose écrire dans ses remerciements, dans lesquels il présente ses sources, que : « Dans ce livre, tout est vrai, ou presque ». On a plutôt envie de penser que le jugement de Spitzer sur ce qu’il appelle « la faute ontologique » ( ?) de Marx l’a aveuglé au point que dans son roman, tout est faux ou presque.
Avant de voir ça point par point, je vous fais le résumé du roman, pour mesurer tout ce que son intrigue doit à la glorieuse tradition narrative des télénovellas brésiliennes. Accrochez-vous, c’est parti :
Alors que sa femme Jenny est en voyage, Marx couche avec la bonne – qui le déteste ; du coup, on se demande….-, et celle-ci accouche 9 mois plus tard d’un petit garçon. Jenny, furieuse, a tout compris, et exige que des mesures soient prises (mais elle ne licencie pas la bonne, qui pour sa part déteste Marx mais ne s’en va pas non plus). Comme Marx plane à 3 000 et ne sait rien faire dans la vie, Engels – un copain capitaliste qui vit avec la sœur de son ex qui le déteste lui aussi, et qui par ailleurs est secrètement fou de désir pour la femme de son ami Marx -, Friedrich donc est appelé à la rescousse, et il confie le gosse à un toubib, qui le confie à Charlotte, une femme aimante et d’origine irlandaise qui se prostitue pour vivre et élever Freddy (le gosse en question). Quand le gosse devient ado et qu’il rencontre toutes les 3 pages par hasard la famille Marx, Jenny n’en peut vraiment plus, d’autant plus que la plus jeune des filles de Marx tombe amoureuse de Freddy dont elle ne sait pas que c’est son demi-frère malgré la ressemblance frappante de celui-ci d’avec son père. Du coup, avec la complicité plus ou moins passive d’Engels et surtout pleinement active de son frère Ferdinand – qui nourrit pour elle une sorte de désir incestueux. Décidément….–, Jenny fait mettre sur la piste de la mère adoptive et de l’enfant un tueur qui rate le môme mais assassine la mère par erreur. Freddy, devenu jeune homme, est alors secrètement confié par la « compagne » d’Engels à des Fénians d’irlandais, et là il fait un peu la révolution au pays d’origine de sa mère adoptive - contrairement à ce poseur de Marx qui lui vit dans les livres et ne s’est jamais battu pour de vrai. Freddy est arrêté par l’armée anglaise, mais après une évasion rocambolesque digne des meilleurs téléfilms fauchés, il fait face, à quelques pages de la fin, à une surprenante proposition d’adoption par Engels sortie d’on ne sait où. Mais bon Freddy a sa dignité et il refuse.
Voilà, voilà, voilà….
Je vous propose donc maintenant de confronter point par point ce récit absurde mais dans lequel en théorie « tout est vrai, ou presque » à ce qu’en disent les historiens, et notamment la dernière en date des biographies de Marx, celle qui est citée par Spitzer en premier dans la liste des trois biographes de Marx qu’il a lues, et qui est signée de Jonathan Sperber[4].
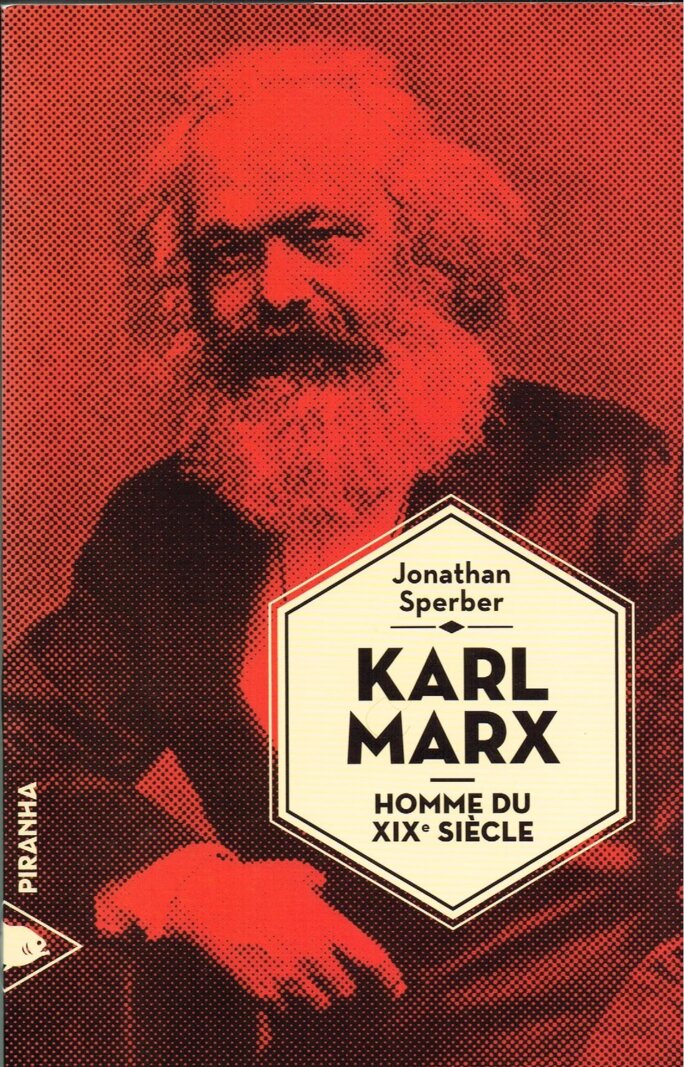
Agrandissement : Illustration 3
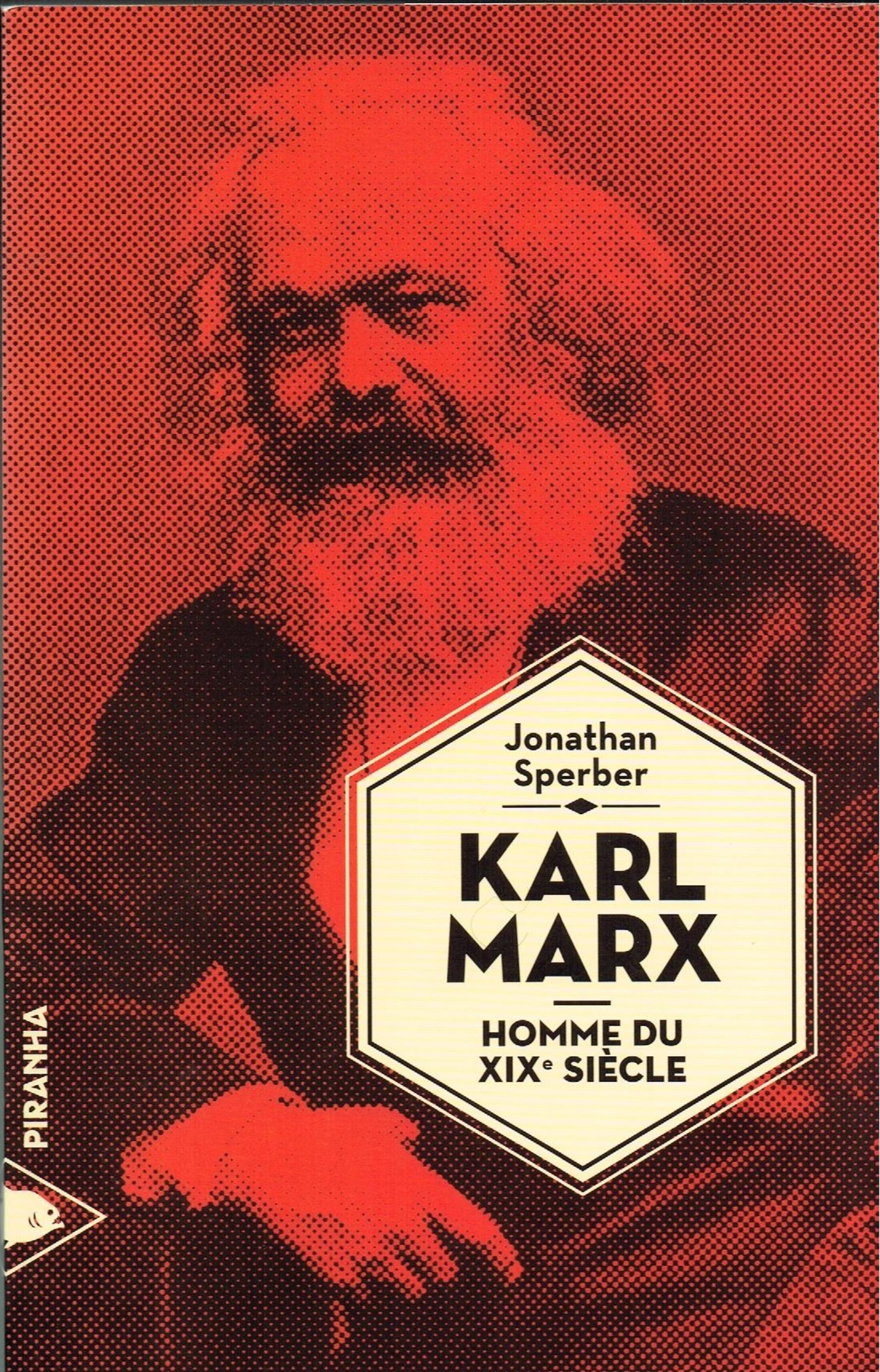
On complètera l’information avec la biographie d’Engels publiée par Tristram Hunt en 2009[5]
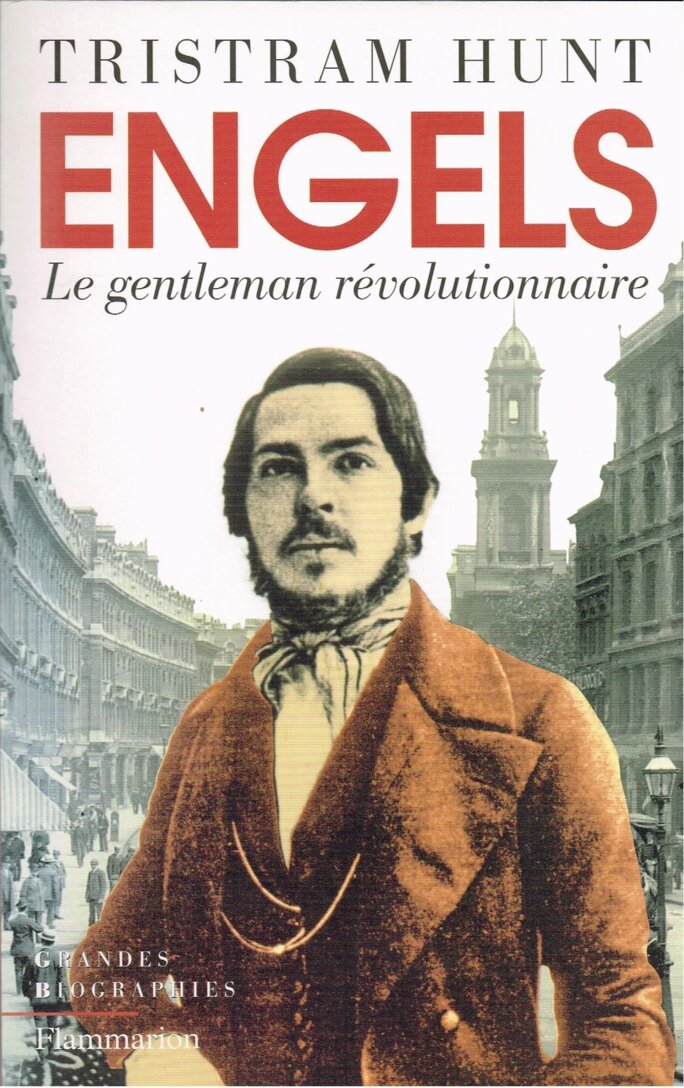
Agrandissement : Illustration 4

Commençons par évoquer le cas de la femme de ménage, Helene Demuth, également connue sous les surnoms affectueux de « Nim » ou « Lenchen », et à qui une courte mais instructive notice Wikipédia[6] est consacrée. Dans le roman, elle déteste profondément Marx. Mais alors vraiment très très très beaucoup. Voici des extraits de ses propos tout en nuances aux pages 103-105 du roman :
« C’est un vaurien, incapable de mettre un seul penny de côté. L’argent lui brûle les doigts. Il ne sait pas compter. Ni travailler d’ailleurs (…). C’est tout ce qu’il sait faire; réclamer de l’argent à ses amis. Et quand ils refusent, il hurle comme un cochon que l’on saigne. Une bête, je vous dis[7] ! (…) Saleté de bon à rien. (…) Ce sagouin. Pouah ! Il me dégoûte ! Qu’il crève de ses furoncles au cul ! »
Sobre.
Mais efficace.
En vrai, Nim est restée toute sa vie dans la famille Marx, où elle est était considérée comme une amie et une partenaire de discussions politiques, et ce de 1846 jusqu’à sa mort en 1890. Et si elle a au final été enterrée dans le caveau familial des Marx, c’est le fait de a volonté de…. Jenny, qui en avait fait la demande expresse avant sa mort, qui s'est produite peu de temps avant celle de son communiste de mari.
Voici comment, Wilhelm Liebcknecht, le premier biographe de Marx - et qui était aussi son contemporain et ami - , décrivait pour sa part la place d’Helen/Nim/Lenchen au sein de la famille Marx :
« Lenchen exerçait une sorte de dictature à laquelle Marx se soumettait comme un agneau. (…) Elle se serait sacrifiée pour lui, aurait donné cent fois sa vie pour lui (…) Il pouvait être de l’humeur la plus irritée (…) Lenchen entrait dans la caverne du lion et s’il grommelait, elle lui faisait des remontrances si énergiques que le lion devenait aussi docile qu’un agneau ».
Difficile d’être plus éloigné de ce que Spitzer imagine. Pour sa part, l’historien Sperber appuie la crédibilité du témoignage de Liebcknecht et y lit quant à lui « la reddition volontaire par Marx de son autorité patriarcale » (décidément, chacun peut imaginer un peu ce qu’il veut). A la mort de Marx, loin du « Qu’il crève de ses furoncles ! », Engels a trouvé Lenchen en pleurs lorsqu’elle lui a appris la nouvelle[8].
Nim/Lenchen est alors entrée au service d’Engels. Selon Tristram Hunt : « au matin, Engels passait en revue avec elle la correspondance de Marx, en buvant un verre nostalgique »[9]. Hunt évoque la mort de Lenchen et décrit les soins et l’affection d’Engels pour elle. Elle a donc été enterrée dans le caveau familial des Marx, et Engels a connu une sérieuse dépression à sa mort. Il semble bien que tout ce petit monde avait des relations infiniment plus cordiales et affectueuses que ce que Spitzer décide de faire exister dans son roman.
On l’a vu, dans le roman, le principal grief de Lenchen vis-à-vis de Marx tient à son rapport à l’argent. Dans ses remerciements, Spitzer ose écrire à ce sujet :
« Comme un chasseur pistant sa proie (sic), je faisais le tour de Marx grâce aux livres que lui ont consacré Jonathan Sperber, Francis Wheen et Jacques Attali (et oui !). Tous racontent la même chose sur son rapport à l’argent. Névrotique. (…). Son génie intellectuel et ses dépenses compulsives. Son mode de vie bourgeois et sa puissance de travail. Son attrait pour le luxe et l’incapacité qu’il avait à gagner le moindre sou, hormis grâce à quelques articles et des livres au succès très tardif. »
A peu près tout cela est de la pure affabulation, couronnée par l’emploi d’une caractérisation, « névrotique », qui relève du registre de vocabulaire propre à ces charlatans de psychanalystes. Je ne sais pas ce que racontent Wheen et Attali, que je n’ai pas lus, mais sur le rapport de Marx à l’argent, non seulement Sperber ne dit pas ce que Spitzer lui fait dire, mais il dit même en fait l’inverse.
Par exemple, dans le roman, autour de la page 351, la famille Marx déménage dans un quartier de Londres plus huppé, sur Maitland Park Road. C’est effectivement ce qui s’est passé en 1863. Dans le roman, cette considérable amélioration de la situation de la famille Marx s’explique par… le fait que Marx a spéculé sur les chemins de fer et a gagné en Bourse !!!! Et du coup, toujours dans le roman, les Marx en profitent pour donner à l’occasion de l’emménagement une luxueuse cérémonie avec valets en livrée, afin d’épater leurs nouveaux voisins bourgeois. Tout cela est évidemment n’importe quoi et n’a jamais eu lieu. En vrai, alors que la famille a très longtemps vécu dans des appartements exigus – à Soho, ils tenaient à 6 dans une seule pièce[10] - , sa situation s’est améliorée en deux temps : après 1853 lorsque Marx a pu exercer une activité irrégulière mais rémunérée de journaliste[11] – ce qui a facilité la tenue de pique-niques familiaux, à défaut d’orgies bourgeoises –, puis dix ans plus tard lors d’un double héritage providentiel[12]. En effet, entre temps, Marx avait en quelque sorte été « licencié économique » de son journal américain, en contexte de crise économique violente, et il n’avait ensuite pas réussi à se faire employer aux chemins de fer[13] (car il avait essayé d’être employé, et non de spéculer). On notera que la maison confortable de Maitland Park, si elle n’a jamais accueilli de grande fête bourgeoise, a par contre dans la réalité historique servi à tenir la réunion de fondation de l’Association Internationale des Travailleurs, plus connue sous le nom de Première Internationale. Mais on comprend que Spitzer trouve ça moins racoleur que ses fantasmes délirants de fastes bourgeois financés par la spéculation.
On pourrait multiplier les exemples précis de ce genre, mais c’est globalement toute la vision de Marx comme un dépensier compulsif qui est absolument fausse, et pas du tout assurée par les historiens, contrairement à ce que prétend le romancier dans ses « remerciements ». Pour tout dire, cette vision est même explicitement réfutée par Sperber, qui consacre deux pages à analyser le budget des Marx et son évolution, pour comprendre où se situe le problème structurel du ménage[14]. Il montre que même quand Marx parvient à trouver un emploi (ce qui n’est pas facile pour un émigré qui trimballe sa réputation[15]), une grande partie des revenus est consacrée à éponger les dettes accumulées en temps de vaches maigres, et, selon les mots de Sperber, cela ne permet à la famille que d’élever un peu sa sécurité matérielle dans le cadre de sa situation structurelle de « pauvreté digne ». Bref, le problème des Marx, comme de pleins de gens encore aujourd’hui, ce n’était pas l’excès de dépenses, mais bien le manque de revenus ! D’autant plus que Marx, contrairement à ce qu’affirme Spitzer, souffrait de devoir régulièrement faire appel à Engels ou à sa famille, et que son éthique l’avait poussé à plusieurs reprises à refuser l’aide économiques aux réfugiés politiques, alors que et parce que il avait contribué à mettre celle-ci en place[16].
Dans le roman, puisque Marx et sa femme Jenny sont issus de milieux petit-bourgeois (pour lui) et aristocratique (pour elle), tout leur comportement ne peut donc qu’être une caricature de celui de ces milieux d’origine, quitte à imaginer ces militants communistes comme souverainement méprisants avec les gens du peuple. On se demande bien d’où sort alors la formule de Marx selon laquelle « L’émancipation des prolétaires sera l’œuvre des prolétaires eux-mêmes », entre mille autres contradictions. Mais peut-être, ô subtile idée pleine de gros potentiel romanesque, la contradiction est-elle dans les personnages eux-mêmes, dont l’existence toute entière reposerait sur un décalage abyssal entre leurs engagements publics et leur vie privée ?
Il y aurait bien des phénomènes de cet ordre à explorer de manière féconde pour le romancier, à condition d’être un tout petit peu subtil –ce qui n’est manifestement pas la qualité première de Sébastien Spitzer. Ainsi, en lisant la biographie d’Engels par Tristram Hunt, on pouvait éventuellement être intéressé par le choix de l’historien de centrer le parcours biographique sur la situation d’un communiste qui choisit de conserver son existence - héritée et détestée - de capitaliste du coton, entre autres pour financer le mouvement révolutionnaire, et tout particulièrement les travaux de son ami Marx.
Pas de problème, il y a bien là matière à exploration romanesque. Mais n’est pas Flaubert qui veut, et les choix de Sébastien Spitzer ont donc des allures de désastre même du point de vue de ces présupposés articulés sur les contradictions dans les vies des familles Marx et Engels.
On peut ensuite pour la bonne bouche relever quelques autres bidonnages du roman qui sont en contradiction avec des données historiques avérées :
Spitzer imagine que Freddy est confié après sa naissance à une mère célibataire aimante. Selon Hunt, il fut « placé chez des parents d’accueil antipathiques dans l’est de Londres [17]».
Dans le roman, on ne sait pas trop pourquoi, mais Engels se met en tête d’adopter Freddy bien des années après sa naissance, quand celui est un jeune adulte. Il semble au contraire selon Sperber qu’Engels, qui avait visiblement un vrai sens du sacrifice, a reconnu l’enfant peu de temps après sa naissance, pour aider son ami à sauver son mariage[18]. Et Freddy, loin d’être complètement caché voire poursuivi pour être assassiné comme imaginé dans le roman, venait parfois visiter la famille Marx pour voir sa mère biologique, dont il connaissait parfaitement l’existence (contrairement à ce qui est rapporté dans le roman)[19]. Tristram Hun raconte[20] comment, sur son lit de mort, Engels a révélé à Tussy, l’une des filles de Marx, la véritable identité du père de ce Freddy qu'elle connaissait. On voit que s’en tenir un peu fidèlement à la réalité historique, ou ce que l’on peut en deviner, aurait déjà été suffisamment « romanesque » comme ça pour qu’il n’y ait pas besoin de rajouter comme le fait Spitzer des couches de pathos, au point d’en devenir ridicule, en plus d’être fantaisiste.
A propos de la relation entre Marx et Engels, le roman réussit le tour de force de ne jamais mettre en scène leur amitié ; sans doute pour éviter d’avoir à décrire quoi que ce soit de positif, il ne développe que des moments où Engels se lamente sans cesse du manque de reconnaissance et de la froideur de Marx à son égard. Et pourtant, dans le monde réel, parmi tant d’autres exemples, Marx écrivait ceci à Engels en 1866 à la sortie du Livre I du Capital : « Sans toi, je n’aurais pu mener cet ouvrage à son terme, et, je te l’assure, ce fut toujours pour moi un poids terrible sur la conscience que de te laisser, surtout à cause de ma modeste personne, gaspiller et rouiller dans le commerce tes formidables capacités et que de t’obliger [par-dessus le marché] à partager toutes mes petites misères.[21] »
Enfin, la fin du livre présente Marx en personnage obsédé par la célébrité, qui ne s’intéresse qu’à la rédaction de sa grande œuvre qui le ferait enfin passer à la postérité. Du coup on ne comprend pas pourquoi, si c’est tout ce qui l’intéresse, Marx a choisi la voie ardue du traité d’économie politique plutôt que celle du roman racoleur sélectionné pour le Goncourt et le Goncourt des lycéens (sic). Mais bon…
Mais surtout, on constate en lisant Sperber que Marx a au contraire été ralenti dans son écriture du Capital par la nécessité pour lui de faire du journalisme afin de nourrir sa famille[22], puis qu’il a refusé le poste de président de l’AIT en expliquant que celui-ci devait être tenu par un ouvrier[23], mais tout en s’occupant très prosaïquement de l’Internationale… au lieu d’écrire Le Capital[24] . Et si, malgré les pressions amicales d’Engels, il n’ jamais réussi à finir celui-ci de son vivant pour accéder enfin à cette gloire que Spitzer lui prête de désirer avant tout, c’est parce qu’il n’en finissait plus de travailler et de vérifier ses sources avant de rédiger - on ne peut en dire autant de tout le monde.
Signalons pour finir que la lourdeur de l’intrigue est parfois encore renforcée par celle du style de l’auteur, comme dans ces deux formules didierbarbeliviennes qui illustrent bien la sobriété de l’ensemble :
« Quand elle avait su qu’Evans allait faire d’elle une mère, elle s’était persuadée qu’elle ne se conjuguerait plus qu’à l’inconditionnel, qu’elle donnerait toujours tout. »[25].
« Un garçon et une fille. Deux indicibles qui se fondent. L’essence d’un sentiment. Bonne-maman avait tort. Aimer, ce n’est pas seulement quand on s’est perdus. C’est aussi se retrouver. [26]».
On a presque envie de rajouter :
Bref, si vous voulez vous plonger dans une fiction qui mette en scène Karl Marx, évitez absolument le livre de Spitzer, et préférez lui éventuellement celui de Jerger.
Mais surtout, regardez, si vous ne l’avez pas encore fait, le très chouette film de Raoul Peck Le Jeune Karl Marx, qui colle de très près à ce que l’on sait de la biographie de Marx et de la formation de ses idées communistes :
Yann Kindo
[1] Ilona JERGER, Marx dans le jardin de Darwin, Editions de Fallois, 294 p. 2019, 20 euros
[2] Sur l’histoire du tabac et la manière dont l’industrie qui le diffuse a tenté de cacher sa nocivité, voir cet article sur le site de l’AFIS :
https://www.pseudo-sciences.org/Quand-l-industrie-du-tabac-cache-la-verite-scientifique
[3] Sébastien SPITZER, Le cœur battant du monde, Albin Michel, 444 pages, 2019 ; 21,90 euros
[4] Jonathan SPERBER, Karl Marx, homme du XIXe siècle, Piranha, 2017, 568 pages ; 26,50 euros.
[5] Tristram HUNT, Engels, le gentleman révolutionnaire, Flammarion, 2009, 587 pages, 28 euros
[6] https://fr.wikipedia.org/wiki/Helene_Demuth
[7] L’animalisation est d’ailleurs un peu un leitmotiv de l’auteur, qui à plusieurs reprises décrit un Marx si poilu qu’il a une tête de sanglier.
[8] SPERBER p. 479
[9] HUNT p. 398
[10] SPERBER p. 233
[11] SPERBER p.270
[12] SPERBER, p. 314
[13] SPERBER p. 313
[14] SPERBER p. 271-272
[15] Dans un autre passage, p. 427-429, Sperber revient sur le rapport de Marx à l’argent et explique que les options de celui-ci pour en gagner étaient somme toute très limitées, dans le contexte de l’époque et de sa situation.
[16] SPERBER p. 234
[17] HUNT p. 272
[18] SPERBER p. 240
[19] SPERBER p. 241
[20] HUNT p. 467
[21] Cité par SPERBER p. 422
[22] SPERBER, p. 266
[23] SPERBER p. 323
[24] SPERBER p. 455
[25] SPITZER, p. 263
[26] SIPTZER, p. 274



