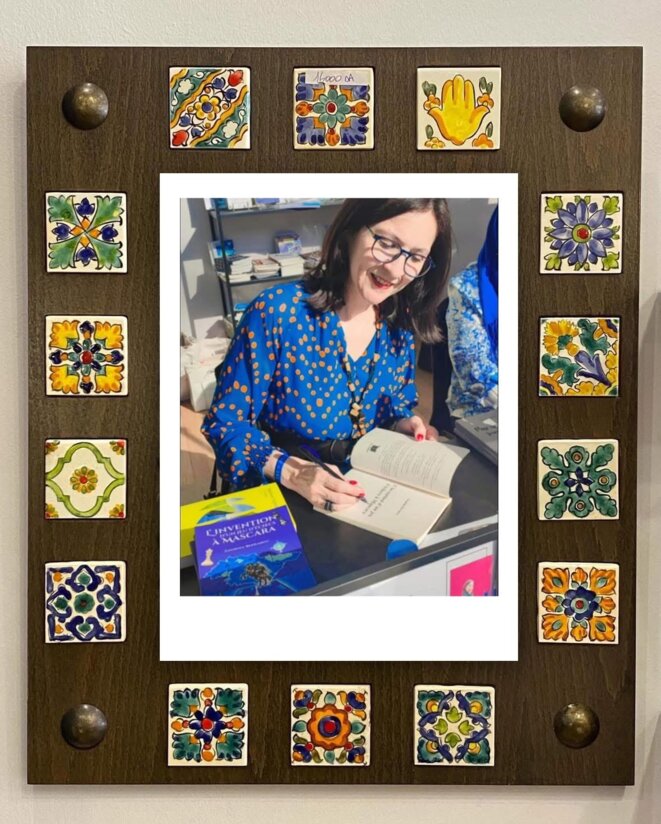Agrandissement : Illustration 1

Comparer n’est ni assimiler ni confondre. C’est distinguer en rapprochant, identifier des structures équivalentes dans des contextes différents. L’histoire de l’Algérie à l’aube de sa décennie noire, en 1991, peut, à ce titre, offrir un miroir troublant de la situation que traverse la France en 2024-2025. Ce rapprochement ne vise pas à réduire les différences historiques ou culturelles, mais à souligner des dynamiques similaires : la montée d’idéologies extrêmes dans une société traversée par une crise systémique — économique, politique, symbolique.
1. Deux extrémismes, une même logique
L’extrême droite française contemporaine, identitaire, catholique, réactionnaire, suprématiste, xénophobe, partage un fond doctrinal étonnamment similaire à celui de l’extrémisme religieux islamiste qui s’est emparé de la société algérienne à partir des années 1990. Ces deux formes d’idéologies opèrent un rejet radical de l’altérité, définissent leur légitimité par une sacralisation de l’origine (ethnique, religieuse ou culturelle), et organisent l’ordre social autour d’un idéal communautaire homogène, purifié de toute différence.
Le fascisme européen se constitue historiquement en réaction contre l’universalisme des Lumières et la démocratie libérale. Il en va de même pour le fissisme — terme proposé ici pour désigner l’idéologie véhiculée par le Front islamique du salut (FIS) en Algérie. Tous deux s’inscrivent dans une volonté de restaurer un ordre transcendant, moral, jugé supérieur à la souveraineté populaire et aux droits individuels.
Cette homologie se lit jusque dans la langue : « fascisme » et « fissisme » s’épaulent phonétiquement, s’interchangeant presque. Le parallèle devient ainsi heuristique.
2. Genèse des idéologies : entre crise économique et recomposition géopolitique
L’essor du FIS en Algérie ne peut être compris indépendamment de la crise économique déclenchée par la chute des cours du pétrole dès 1986, des émeutes d’octobre 1988, de l’effondrement du système communiste mondial et du reflux des idéaux modernisateurs. L’Algérie, précipitée dans une ouverture politique brutale, est rapidement envahie par des courants islamistes importés — Frères musulmans égyptiens, salafisme saoudien, djihadisme afghan — avec le soutien tacite ou explicite de puissances étrangères, au premier rang desquelles les États-Unis et certaines monarchies du Golfe.
Dans le même temps, la France de François Mitterrand offre l’asile politique à des militants islamistes tout en marginalisant les intellectuels algériens, pourtant souvent laïcs et démocrates. Cette contradiction contribuera à nourrir un ressentiment idéologique qui explosera dans les années 1990.
Or, la France contemporaine est confrontée à une configuration de crise semblable : gilets jaunes, précarisation accélérée, endettement public, délitement des institutions. À cela s’ajoute un contexte international déstabilisé par la guerre en Ukraine, le génocide à Gaza, l’instabilité syrienne, les conflits africains, et la dépendance renouvelée de l’Europe vis-à-vis des États-Unis. L’ancien équilibre de la guerre froide a cédé la place à une “guerre roide”, où l’affrontement se joue sur les terrains économique, culturel, religieux et mémoriel.
3. La religion comme catalyseur et alibi
En Algérie, l’idéologie fissiste impose progressivement ses normes à la société en ciblant notamment les femmes. L’imposition du voile islamique, sous peine d’agression, de bannissement ou de mort, relève d’un projet de purification de l’espace public par l’uniformisation religieuse. La femme non voilée devient le symbole d’un Occident honni, et donc à éradiquer.
En France, l’interdiction du voile dans l’espace public suit une logique inverse mais comparable : il ne s’agit plus d’imposer un signe religieux, mais de l’interdire. Cette prohibition est justifiée au nom de la laïcité, mais masque en réalité un projet identitaire. L’extrême droite catholique, bien que marginalisée sur le plan religieux, poursuit une “croisade sécularisée” contre une religion perçue comme étrangère et menaçante : l’islam.
Ainsi, l’universalité républicaine est instrumentalisée pour légitimer une politique d’exclusion. Le corps des femmes devient, une fois encore, l’objet d’un contrôle idéologique fondé sur le soupçon de différence.
4. Médias, capital et diffusion idéologique
Les deux extrémismes partagent également un rapport étroit avec le capital. Le FIS, dès les années 1990, se reconvertit massivement dans le commerce et l’import-export, finançant sa propagande par des réseaux économiques parfois transnationaux (Golfe, Europe, États-Unis). De même, le fascisme français contemporain s’appuie sur un complexe médiatique articulé autour de grands groupes privés — Bolloré, CNews, Musk, Hanouna — qui diffusent une idéologie de l’ordre, de la peur, et de la haine de l’autre.
Dans les deux cas, l’idéologie est portée par des médias aux financements opaques, souvent liés à des réseaux de corruption, de criminalité organisée ou de rente. Le capitalisme, loin d’être un rempart contre l’extrémisme, en devient ici le vecteur et le complice.
5. Cooptation, mimétisme, légitimation
Fascisme et fissisme accèdent au pouvoir non par un coup de force direct, mais par infiltration progressive des structures institutionnelles. Ils contaminent les partis existants, imposent leurs thèmes à l’agenda politique, captent l’opinion publique à travers des signifiants flous : sécurité, tradition, identité, morale.
Le pouvoir, pour survivre, finit par intégrer certains de leurs éléments rhétoriques ou programmatiques. C’est la logique de la cooptation, décrite par Max Weber dans sa typologie des formes de domination : la légitimité devient charismatique ou traditionnaliste là où elle était légal-rationnelle. La démocratie devient formelle, vidée de sa substance, car l’État reprend les discours de ceux qui veulent en finir avec lui.
6. Une société sous tutelle idéologique
En France, les discours critiques vis-à-vis d’Israël, les positionnements pro-palestiniens, les analyses historiques ou géopolitiques du 7 octobre divergentes sont criminalisés. Une nouvelle forme de sacralité politique se construit autour de la mémoire de la Shoah, au prix d’un renversement : ce n’est plus l’antisémitisme qui est combattu, mais l’islam et ceux qui en sont les porteurs culturels ou imaginés.
Ce processus rappelle la censure religieuse en Algérie dans les années 1990, où toute tentative de discuter du corpus de l’islam était assimilée à un blasphème, puni de mort. En France aujourd’hui, la parole critique d’Israel et de Netanyahu est menacée d’ostracisation, de censure,d’incarcération symbolique.
Plusieurs faits récents le confirment, une restriction croissante de la liberté d’expression dès qu’il s’agit de critiquer Israël. La suspension de personnalités engagées (comme François Burgat ), l’annulation de conférences universitaires sur la Palestine, ou encore l’interdiction de manifestations pro-palestiniennes montrent qu’une parole critique, même modérée, peut être réprimée. Cette logique de sacralisation politique rappelle les interdits imposés en Algérie dans les années 1990 par les islamistes, où toute remise en question de l’ordre religieux islamiste était punissable.
7. Vers une Israëlisation de la France ?
Il ne s’agit pas ici de comparer Israël à l’Algérie, mais d’observer que la France, dans sa lutte contre un islamisme souvent fantasmatique, tend à reproduire les formes idéologiques et politiques d’un État comme Israël : sacralisation d’un mythe national, stigmatisation d’une minorité, uniformité du discours pro Israël, criminalisation du soutien à la cause palestinienne.
Ce mimétisme révèle que le fascisme, en tant que logique politique, ne connaît pas de frontière idéologique ou géographique. Le fascisme religieux (fissisme) comme le fascisme laïque partagent une haine commune : celle de la liberté, de la diversité, de l’humanité complexe.
8. Une société face à son double
En somme, ce que fut l’Algérie en 1991 — une société tiraillée entre un État faible, une crise économique brutale, une jeunesse en colère et une idéologie religieuse conquérante — la France le devient aujourd’hui, mais sous des habits différents. Le risque n’est pas tant un retour à la théocratie qu’une assimilation de plus en plus grande aux modèles autoritaires capitalistes en émergence .
Le fissisme et le fascisme ne sont pas des accidents, mais les symptômes d’un capitalisme en crise, d’une modernité sans transcendance, d’un ordre international devenu cynique. Ce sont deux faces d’un même nihilisme.
9-Ordres autoritaires, mêmes schémas
Fissisme et fascisme partagent une même architecture mentale : hiérarchie des êtres, domination masculine, rejet des minorités sexuelles, glorification de la force, méfiance envers l’intellect. Derrière leur discours de rupture, ils servent souvent les intérêts des puissances économiques : le FIS, soutenu par des réseaux wahhabites et des fortunes du Golfe ; le RN, épaulé par des groupes industriels et des empires médiatiques.
Les deux mouvements s’appuient sur des figures-clés pour diffuser leur idéologie. Abassi Madani prêchait depuis les mosquées ; Cyril Hanouna, lui, prêche chaque soir sur les chaînes de Vincent Bolloré. Deux formes de populisme, deux canaux de diffusion — religieux ou télévisuel — mais une même logique : occuper l’espace symbolique, banaliser l’intolérance, disqualifier la pensée critique.
Dans les deux cas, le populisme est le vernis d’un projet de confiscation du pouvoir.