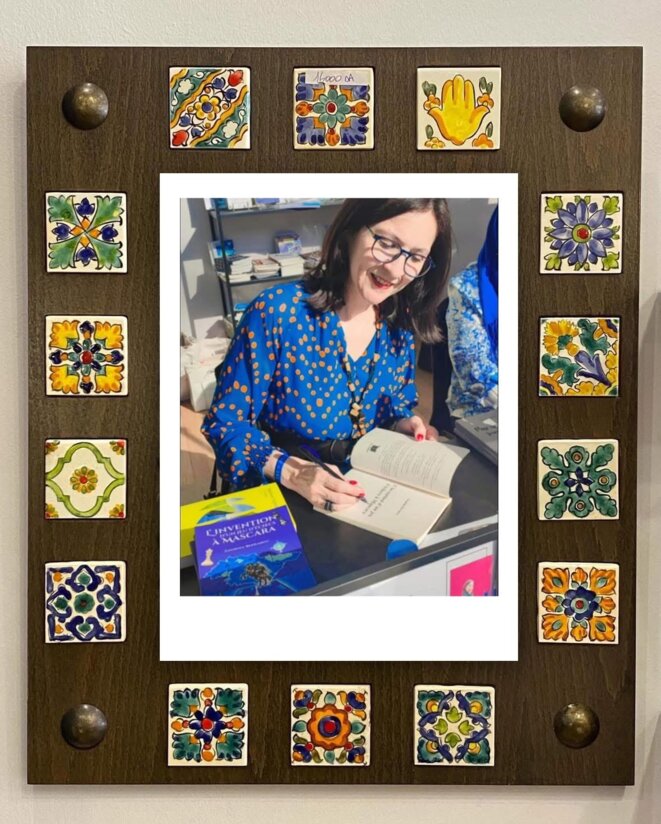Agrandissement : Illustration 1

Ma colère ne s’éteint pas. Elle ne cesse de croître, non pas dans la fureur aveugle, mais dans une segmentation lucide : elle s’analyse, se structure, se précise.
Comment, au XXIe siècle, les puissances occidentales – autoproclamées gardiennes de la démocratie – peuvent-elles à ce point manquer de courage moral ? Non seulement elles demeurent incapables d’exiger d’Israël qu’il mette fin à ce massacre de civils, méthodique et assumé, mais elles offrent en prime leur soutien sans réserve à un Premier ministre, Benjamin Netanyahu, à la tête d’un gouvernement d’extrême droite, raciste et xénophobe, sans même feindre d’en être gênées.
Est-ce là le visage des « nouvelles valeurs » de l’ordre international ?
Si Israël est une démocratie, alors la République Démocratique du Congo l’est aussi. Le mot démocratie a-t-il donc perdu toute substance, pour ne plus désigner qu’un régime ami de l’Occident, peu importe ses actes ?
Il semble que nous glissions vers une époque où Gengis Khan, Pol Pot ou Hitler ne sont plus perçus comme la lie de l’histoire, mais comme de possibles modèles – pourvu que les carnages servent des intérêts stratégiques.
Que reste-t-il de l’Histoire, sinon un catalogue d’atrocités oubliées ou instrumentalisées ? A-t-on vraiment tiré la moindre leçon des génocides passés ? Les Indiens d’Amérique, les Ukrainiens affamés par Staline, les victimes du Rwanda – où sont-ils dans notre mémoire collective ?
« La Shoah est devenue une religion civile de l’Occident. Mais dans cette architecture mémorielle, Gaza n’a pas de place. »
— Enzo Traverso
Oui, la Shoah est au centre de notre conscience historique – à juste titre. Mais son statut paradigmatique ne doit pas devenir une exclusivité qui obscurcit les autres crimes contre l’humanité.
Que fait-on de l’Indonésie au Timor-Oriental, du génocide arménien, de la disparition programmée des aborigènes d’Australie, des atrocités coloniales au Congo, à Madagascar, en Algérie ? De ces millions de morts anonymes dans les marges de l’histoire ?
Comparer n’est pas raison, dit-on. Mais il faut bien comprendre la raison de ces comparaisons : l’impunité.
Les massacreurs ne sont pas jugés ; les massacrés sont réduits au silence. Voilà pourquoi les violences se répètent.
La violence n’est pas une anomalie humaine. Elle est une part tragique de notre histoire. Rabelais croyait que le rire définissait l’homme. L’histoire, elle, semble préférer le bruit des armes.
Dès que l’autre résiste, on l’écrase. Et si cela ne suffit pas, on l’extermine. Depuis toujours, la domination s’exerce d’abord sur les plus faibles, au nom d’une supériorité qu’aucune morale ne justifie.
Les institutions internationales, censées garantir la paix et le droit, ont failli. Elles ont laissé s’installer une expression absurde : « Palestine occupée depuis 1948 », comme si l’occupation était un fait banal, une situation sans fin.
Elles n’ont pas su désactiver les vieux « logiciels » du XXe siècle : colonialisme, racisme, patriarcat, esclavage, impérialisme.
Et pourtant, nous avions cru à un monde nouveau.
Le mouvement des droits civiques, les luttes anticoloniales, l’émancipation des femmes, les soulèvements contre les dominations… Et récemment encore, le surgissement de MeToo, du Wokisme, de la critique des systèmes d’oppression et de leur impunité.
Mais Gaza, dans tout cela ?
Il ne s’agit plus seulement de dénoncer une injustice : il s’agit de constater une faillite morale globale.
Le drame de Gaza révèle une vérité brutale : la démocratie n’est plus un principe, elle est devenue un privilège. Le droit n’est plus universel, il est sélectif. L’histoire ne sert plus de leçon, elle sert de prétexte.
Ceux qui se proclament héritiers des Lumières se taisent face à l’obscurité, ou pire : s’y accommodent.
La mémoire des victimes du passé est brandie comme un talisman, pendant que l’on détourne les yeux des morts d’aujourd’hui.
À ce prix, que valent encore les mots “justice”, “liberté”, “dignité humaine” ?
Si Gaza est possible aujourd’hui, c’est que le monde a consenti à fermer les yeux — et que cette cécité sélective est devenue la matrice d’un ordre international fondé non sur le droit, mais sur la force.
Alors une question s’impose, crue, essentielle, universelle :
la démocratie peut-elle encore faire rêver les peuples qui y aspirent ?
Ou bien est-elle désormais le masque d’une domination, une promesse creuse dont la trahison quotidienne nourrit le désespoir, l’extrémisme et la colère des opprimés ?
Car ce n’est pas seulement Gaza qui est bombardée. Ce sont nos espérances. Notre foi en l’universel.
Et l’idée même d’un avenir commun.
PS/ Post du 29/04/2025https://blogs.mediapart.fr/zoubida-berrahou/blog/290424/gaza-la-democratie-et-le-mensonge-universel