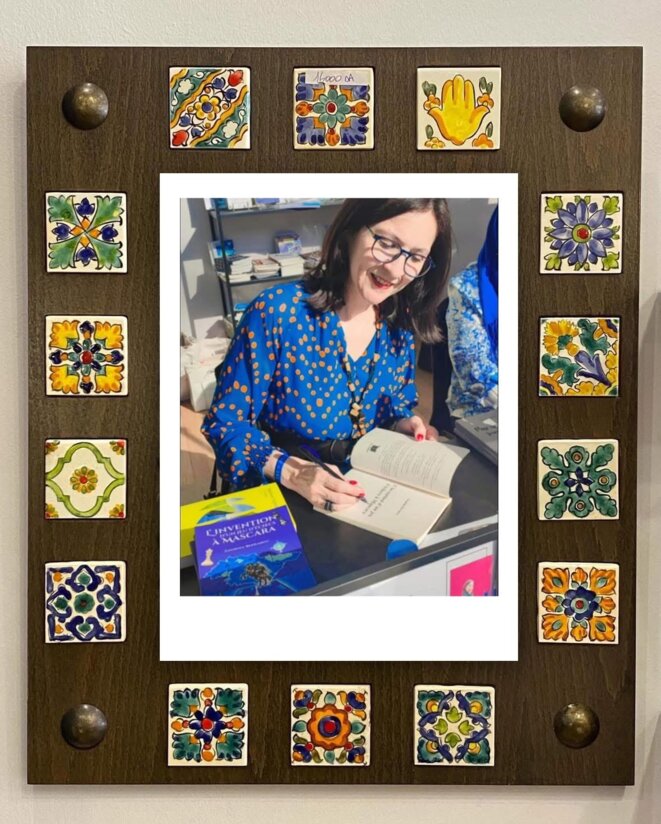Agrandissement : Illustration 1
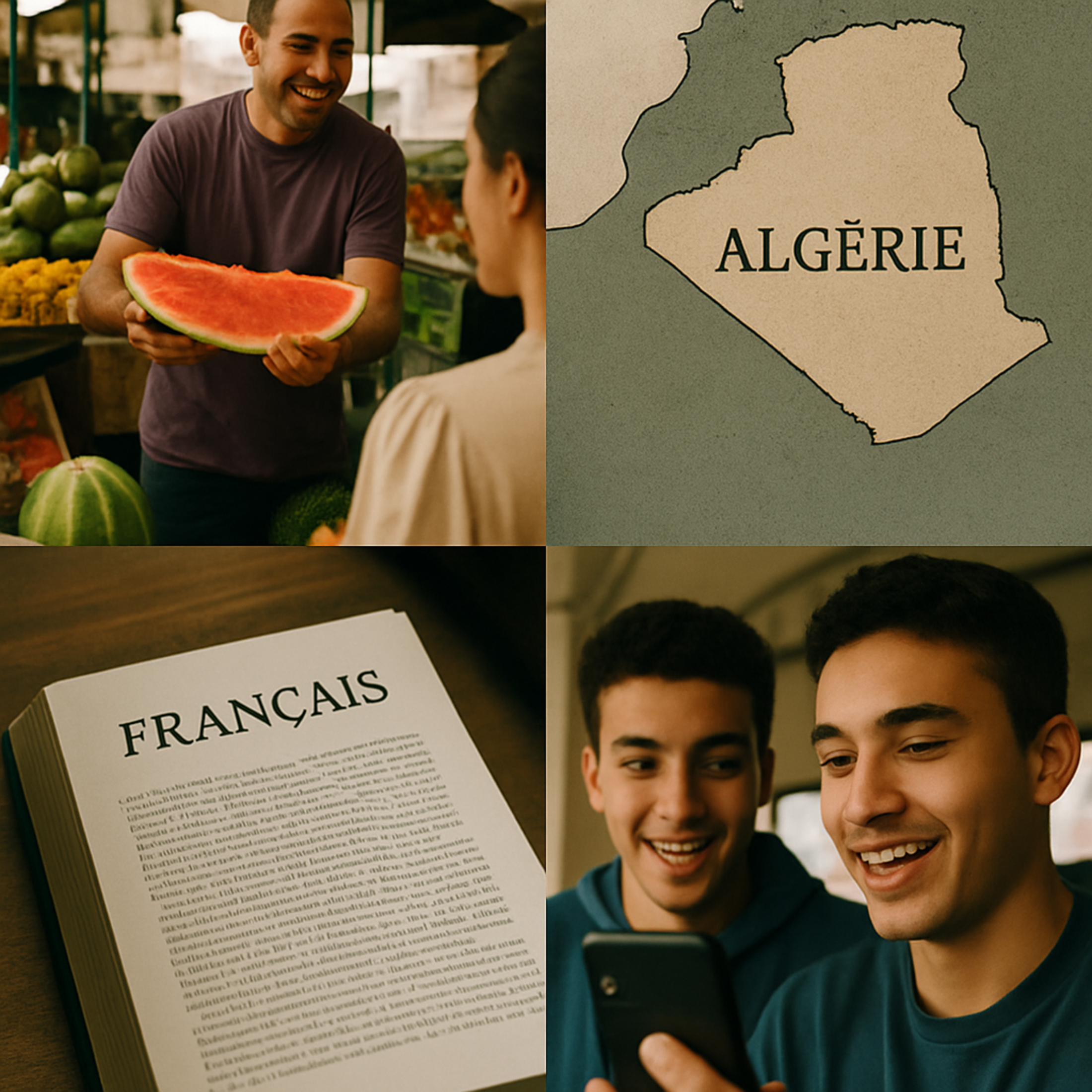
On pourra l’effacer des formulaires, le retirer des panneaux, le remplacer dans les amphis. On pourra multiplier les réformes en faveur de l’anglais. Mais si l’administration veut tourner la page, la rue, elle, continue de parler comme hier.
Sur un marché d’Alger, un vendeur lance : « Rahi sucrée la dela3a, madame! ». Dans un bus, un adolescent dit à son ami : « Cheft el match hier ? C’était chaud wallah ! ». Dans un salon familial, un appel vidéo avec la France alterne darija, français et éclats de rire : « Eh kho, t’es où là ? On t’attend pour le 3cha ! ». Ici, le français n’est pas une langue étrangère : il est un ingrédient du quotidien.
1. L’injonction à l’anglais… mais le français persiste
Depuis quelques années, l’État algérien met le cap sur l’anglais : universités, entreprises publiques, documents administratifs et même billets d’Air Algérie changent de langue. L’objectif est clair : s’ouvrir aux sciences et aux marchés mondiaux, réduire la dépendance au français.
Mais sur le terrain, le basculement reste partiel. Une langue ne s’efface pas d’un décret. Elle reste vivante dans les habitudes, dans les émotions, dans les mots qu’on glisse sans y penser. Le français ne se limite pas à un héritage scolaire : il vit dans les conversations de quartier, les réseaux sociaux, les blagues de café.
2. Une diaspora qui entretient la langue
La France abrite une diaspora algérienne historique, dense et active.
- En 2023, près de 892 000 personnes nées en Algérie vivaient en France.
- En comptant enfants et petits-enfants, on atteint environ 2,5 millions de personnes, voire 3,5 millions selon certaines estimations.
Ce lien humain crée un va-et-vient linguistique permanent. Le français circule dans les séjours estivaux, les mariages, les appels WhatsApp de minuit, les projets économiques entre cousins des deux rives. Chaque retour au pays apporte un mot nouveau, une expression, un accent.
3. Une deuxième “darija”
En Algérie, le français parlé a pris l’accent et le rythme du pays, parfois teintés de l’argot des banlieues françaises. Cette langue n’est pas l’apanage d’une élite francophone éduquée ou connectée aux sphères décisionnelles. Bien au contraire, elle est vivante dans les quartiers populaires, dans les banlieues, portée par des familles de travailleurs et de migrants qui ont souvent quitté ces mêmes quartiers pour tenter leur chance en France.
Dans la bouche de nombreux Algériens, le français se mêle à la darija pour former un langage hybride, parfois qualifié de « darija francaise » : « Nroho lel marché, w ba3d au café ».
Ce n’est pas un accident, mais une création collective. Une deuxième darija, nourrie par la musique, les médias et le sport. Des rappeurs comme Solkin ou Tif alternent français et darija avec une fluidité que les jeunes imitent naturellement. L’équipe nationale de football, composée à près de 80 % de joueurs français d’origine algérienne — souvent non arabophones — ramène aussi cette darija “made in France” dans l’espace public.
4. Étudier en France : un moteur puissant
Chaque année, l’équivalent d’une petite ville entière traverse la Méditerranée pour étudier en France.
- En 2023–2024, 34 269 étudiants algériens y sont inscrits, soit 8 % des étudiants internationaux et la 2ᵉ communauté étrangère.
- En 2022–2023, ils étaient 32 147 — une hausse de 4 %.
Avant même de partir, ces étudiants doivent passer le TCF, le DELF ou le DALF. Pendant des mois, ils reprennent une grammaire plus formelle, réapprennent à écrire avec précision. C’est une reconquête linguistique qui enrichit leur français.
5. Et après les études ?
Environ 30 % restent en France, mais 70 % reviennent au pays. Ceux qui rentrent ramènent un français affiné, teinté de nouvelles références culturelles.
Ceux qui restent continuent d’alimenter la langue en Algérie : visites, projets, investissements, collaborations professionnelles. Les mots voyagent avec les gens.
6. Une langue irréductible
On peut changer les manuels, repeindre les panneaux, imposer d’autres langues à l’école. Mais le français reviendra toujours, non comme un vestige figé, mais comme une langue vivante, métissée par l’histoire et la mobilité.
En Algérie, le français n’est pas un fantôme de la colonisation. C’est une mélodie que l’on reconnaît, même quand elle change de rythme. Une deuxième voix, qui cohabite avec l’arabe, le tamazight et la darija, et qui restera, parce qu’elle est déjà une part de nous.
7. Un avertissement aux décideurs
Avant de vouloir imposer l’anglais à marche forcée, il faut réfléchir à cette réalité incontournable : le français est déjà profondément ancré dans la société algérienne, dans ses voix, ses gestes, ses liens. Ignorer cette réalité, c’est courir droit à un échec programmé.
L’anglais ne remplacera pas du jour au lendemain une langue qui vit au cœur du quotidien, qui traverse les générations, les frontières et les classes sociales. La langue ne se décrète pas ; elle se construit, se transmet, s’incarne.
Aux décideurs, donc, ce message simple : avant de tourner la page, regardez bien ce que vous risquez de perdre.